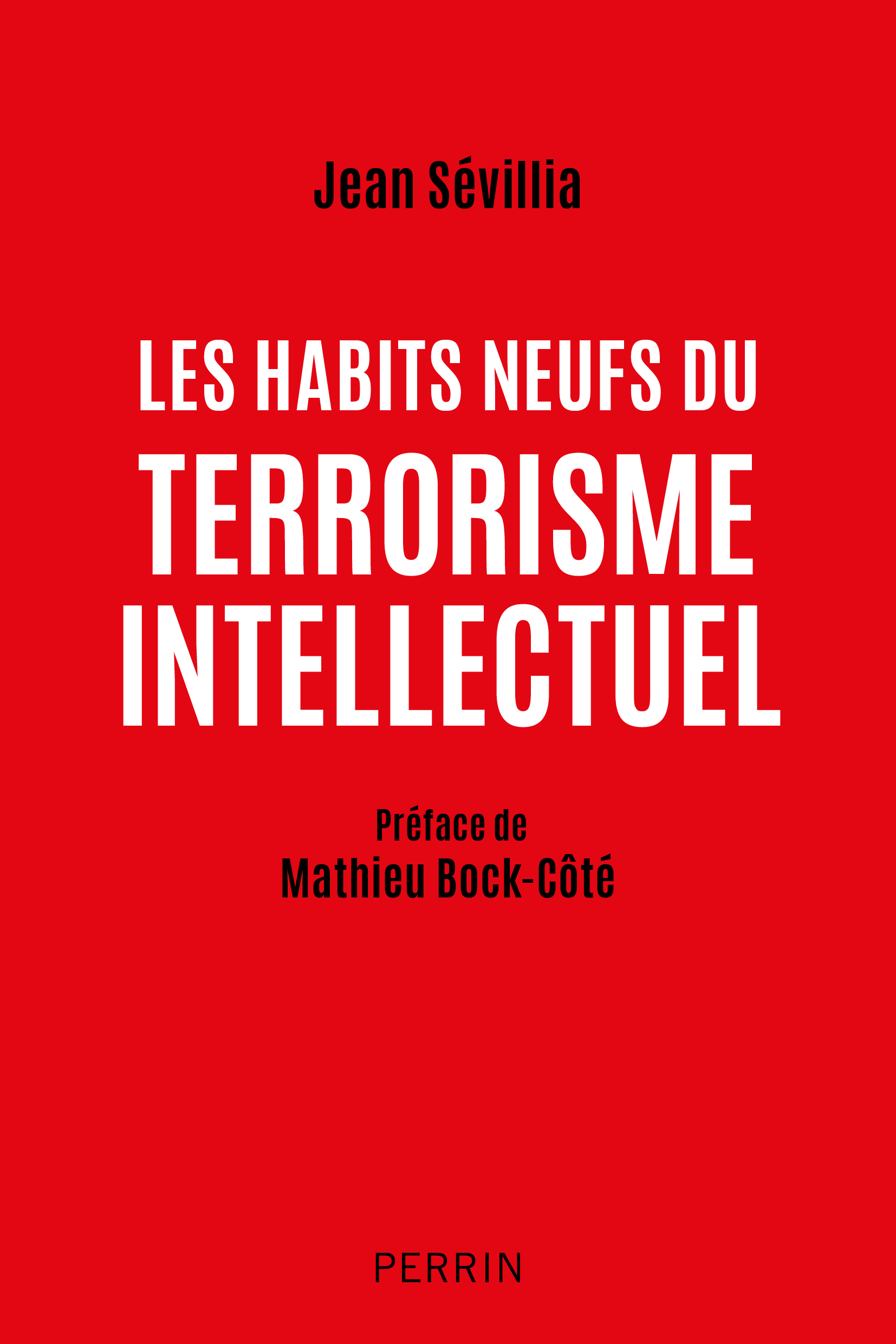Au XVIe siècle, le père Matteo Ricci, missionnaire chrétien et savant réputé, est invité d’honneur à la cour de Pékin. Portrait d’un passeur entre l’Europe et l’empire du Milieu.
Le 11 mai 1610 s’éteignait à Pékin, usé par la tâche, un homme de 57 ans qui portait le nom chinois de Li Madou. Missionnaire chrétien, le père Matteo Ricci s’était immergé dans le pays au point d’en épouser la culture. Peu après sa mort, l’empereur permettait son inhumation au pied de la Cité interdite : «Le plus grand honneur qui pouvait être rendu à un étranger en Chine», souligne Michela Fontana, une chercheuse italienne dont la biographie de Ricci (1) vient d’être traduite en français. Afin de célébrer cet anniversaire, colloques, expositions, sites internet (2) et livres mettent en valeur une figure méconnue.
Matteo Ricci voit le jour le 6 octobre 1552, à Macerata, près d’Ancône, en Italie. Fils d’un pharmacien, il est l’aîné d’une famille de treize enfants. A 19 ans, il entre chez les Jésuites. Il poursuit des études au Collège romain et à l’université de Florence : droit, philosophie, théologie, mathématiques, astronomie et sciences naturelles. Remarqué par le visiteur général des Jésuites pour les Indes orientales (l’Asie), il est envoyé parfaire sa formation à Coimbra, au Portugal, puis à Goa, en Inde. C’est là qu’il est ordonné prêtre.
En 1582, ses supérieurs envoient Ricci à Macao, comptoir portugais à partir duquel les Jésuites tentent de pénétrer dans l’empire du Milieu. En trois mois, il apprend les rudiments du chinois, langue dont il deviendra un expert, et se lance dans l’étude de la civilisation chinoise. Découvrant la suprématie de la caste des lettrés dans cette société, il se fixe pour objectif d’en faire partie, puis d’approcher l’empereur. Un pari un peu fou, qu’il va pour partie réussir. Ainsi que le remarque l’historien britannique Vincent Cronin, dans une biographie parue en français en 1957 et qui vient d’être rééditée (3), le missionnaire, «en donnant tout, avait appris à aimer les Chinois. Si violente que fût leur haine, si fréquents leurs efforts pour l’abattre, par amour, il leur vouerait sa vie».
En 1583, un mandarin l’invite chez lui, à Zhaoqing, à une centaine de kilomètres de Canton. Matteo Ricci y exerce son apostolat, avant de s’installer à Nankin. Après avoir adopté le nom chinois de Li Madou, il se vêt en bonze bouddhiste, puis en lettré confucéen, costume qu’il ne quittera plus. Surtout, il commence son travail intellectuel. En 1595 paraîtra son premier livre en chinois, Le Traité de l’amitié. Il traduit aussi Les Eléments, d’Euclide, compose un Traité sur les cieux et la terre, et réalise une mappemonde qui change la représentation de l’univers des Chinois, puisque leur empire n’y figure pas au centre.
Avant tout, il reste un chrétien désireux de faire partager sa foi. Mais l’entreprise passe par l’adaptation aux réalités linguistiques et anthropologiques locales. Afin de pallier l’absence de mots, le père Ricci traduit le nom de Dieu par « Seigneur du ciel » (Tiang-tchou) ou « Roi d’en haut » (Chang-ti), expressions qu’on trouve dans des textes anciens. Quant au culte des ancêtres prôné par le confucianisme, le jésuite conclut qu’il s’agit d’un honneur rendu aux ascendants, et non d’une pratique idolâtrique, et que les chrétiens chinois peuvent donc conserver ce rite.
En 1601, après dix-huit années passées dans le sud du pays, sa réputation est telle que Ricci est appelé à Pékin. Les cadeaux qu’il offre à l’empereur Wan-li font sensation : une épinette, une mappemonde et deux horloges à sonnerie. Le jésuite est autorisé à résider dans la Cité interdite, privilège sans précédent. Chargé d’enseigner les sciences au fils de Wan-li, il obtient la construction d’une tour pour la grande horloge à sonnerie dont il assure lui-même l’entretien, puis d’une résidence pour ses compagnons jésuites et lui-même, puis enfin d’une église…
Devenu une autorité, Li Madou initie les Chinois à la géométrie et renouvelle leurs connaissances en mathématiques, en astronomie et en cartographie. Musicien, il compose des airs dont les partitions se sont perdues, mais dont les paroles en chinois ont été conservées. Et il poursuit son œuvre de traducteur (les quatre premiers livres du confucianisme, un catéchisme, de multiples ouvrages apologétiques et scientifiques) et de lexicographe : c’est à lui qu’on doit le premier dictionnaire de chinois dans une langue occidentale (le portugais). Toujours édité, le Grand Ricci en sept volumes, dont il existe une version informatique, reste le plus grand dictionnaire chinois-français. Mais le père Ricci n’oublie pas l’Europe : il tient un journal et une correspondance qui sont une mine d’informations sur la Chine de l’époque Ming.
La querelle des rites chinois, ouverte trente ans après sa disparition, sur fond de rivalités entre congrégations catholiques, mettra un frein à l’évangélisation de l’empire du Milieu : il faudra attendre Pie XII, en 1939, pour que Rome autorise les chrétiens de Chine à pratiquer leurs rites ancestraux, avant que le communisme ne s’abatte sur eux. Matteo Ricci avait été un précurseur. Le 18 mai dernier, à l’occasion du quatrième centenaire de sa mort, Benoît XVI saluait ainsi sa mémoire : «Son exemple est encore aujourd’hui un modèle de rencontre entre les civilisations européenne et chinoise.»
Jean Sévillia
(1) Matteo Ricci. Un jésuite à la cour des Ming, de Michela Fontana, préface de Marianne Bastid-Bruguière, traduit de l’italien par Robert Kremer, Florence Leroy et Ugo Lumbroso, Salvator.
(2) www.matteo-ricci.org
Voir aussi le site de l’Institut Ricci-Centre d’études chinoises: www.institutricci.org
(3) Matteo Ricci, le sage venu de l’Occident, de Vincent Cronin, préface d’Elisabeth Rochat de la Vallée, traduit de l’anglais par Jane Fillion, Albin Michel.