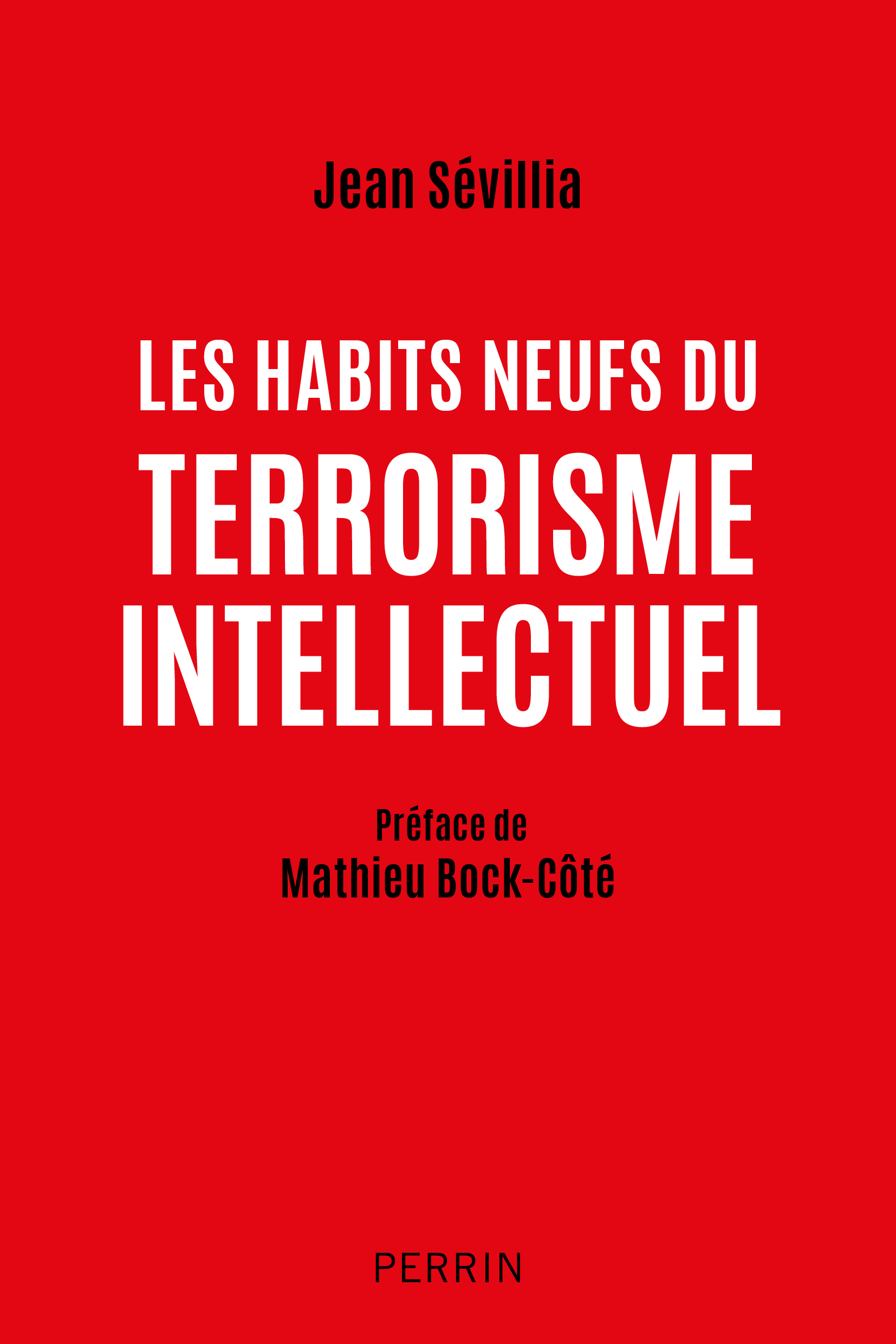Cherchant ses marques par rapport au Canada, confrontée à la mondialisation, la province francophone commémore sa fondation, mais s’interroge sur son avenir.
Le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, géographe du roi Henri IV, débarque sur la rive gauche du Saint-Laurent. Trois bâtiments entourés d’une palissade : la ville de « Kébec » est née. Le 3 juillet 2008, le Québec célèbre son 400e anniversaire. L’événement sera commémoré tout l’été : festivités populaires, démonstrations sportives, concerts, expositions. Mais la foule internationale accourue à l’occasion ne remarquera sans doute pas les livres ou les articles témoignant du débat qui agite la province : Le Québec sur le divan, Circus quebecus, Lettre à mes amis souverainistes. « Nous sommes parvenus à la croisée des chemins », souligne Argument, une revue d’idées, prenant acte des interrogations autour de l’identité du Québec.
En 1968, un an après le célèbre « Vive le Québec libre » lancé par De Gaulle à Montréal, René Lévesque fonde le Parti québécois. Militant pour l’indépendance, celui-ci gagne les élections en 1976. En 1980, toutefois, lors d’un référendum, la « souveraineté-association » est rejetée par 59 % des électeurs. En 1995, lors d’une deuxième consultation, la souveraineté est encore refusée, mais seulement par 50,6 % des suffrages, à 40 000 voix près. Un échec qui découragera les plus ardents.
En 2007, lors des élections à l’Assemblée nationale du Québec, le Parti québécois subit une défaite. Devancé par le Parti libéral, alors au pouvoir, il l’est aussi par l’Action démocratique du Québec. Cette formation, qui réclame « l’autonomie » de la province, a fait campagne, dans un style mi-conservateur, mi-populiste, contre l’Etat-providence et les excès du multiculturalisme canadien. La vie politique québécoise, pendant quarante ans, s’était organisée entre souverainistes, adeptes de l’indépendance, et fédéralistes, partisans du lien avec le Canada. La remise en question de ce clivage, l’an dernier, traduit les enjeux nouveaux qui se posent à un pays de 7 millions d’habitants (sur 32 millions de Canadiens), confrontés, comme partout, aux effets de la mondialisation.(br>
Depuis 1974, le français est la seule langue officielle du Québec, dont la Charte de la langue française, dite loi 101, adoptée en 1977, impose l’usage dans l’administration, l’enseignement, la justice et le monde du travail. « Remettre la loi 101 en cause, estime Jacques Beauchemin, professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, serait une des rares choses qui pourraient faire descendre les Québécois dans la rue. » Quelle que soit leur tendance, tous, ici, manifestent un attachement viscéral envers le français, ciment du pays. « Pour les anglophones, la langue est seulement un moyen de communication ; pour les francophones, elle est aussi un vecteur de culture », explique Yvan Lamonde, qui enseigne la littérature comparée à l’Université McGill, à Montréal. Esprit modéré, Jocelyn Létourneau, professeur d’histoire à l’Université Laval de Québec, juge quand même « humiliant » de constater que les Canadiens ne parlent pas français, dans un pays théoriquement bilingue. « C’est toujours à nous, Québécois, déplore-t-il, de faire l’effort ! »
En 2006, la Chambre des communes du Canada a reconnu que « les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni ». Cette motion, cependant, n’a pas de portée juridique. « Nous sommes une petite nation, au sens de Kundera, c’est-à-dire fragile », commente Antoine Robitaille, essayiste et journaliste au Devoir, un quotidien francophone. « Si cette petite nation se sent menacée, assure-t-il, elle peut se tourner vers l’indépendance ».
L’indépendantisme, en dépit de la déroute du Parti québécois, aurait-il alors un avenir ? Pour Joseph Facal, ancien ministre du gouvernement du Québec, aujourd’hui professeur à HEC-Montréal et souverainiste affirmé, cela ne fait pas de doute : « La majorité canadienne façonne un pays à son goût. L’indépendance est le seul moyen de transformer les minoritaires en majoritaires et de leur donner le sens des responsabilités, au lieu de chercher un perpétuel bouc émissaire dans la majorité. »
Au printemps dernier, un sondage a montré que 43 % des Québécois voteraient « oui » si on leur demandait de se prononcer à nouveau sur la souveraineté, alors même que le sujet n’est pas à l’ordre du jour. « Le sentiment souverainiste n’a jamais été aussi fort hors période électorale, analyse Jacques Beauchemin. Sans doute parce qu’il a perdu son aspect passionnel. La loi 101 assure le maintien du français, que parlent les immigrés et même la minorité anglophone, si bien que 94 % des Québécois sont capables de s’exprimer en français. A Montréal, nous avons une bourgeoisie francophone, ce qui n’était pas le cas naguère. Nous avons donc défendu le fait français sans la souveraineté. Si celle-ci ne se réalise pas dans les toutes prochaines années, elle deviendra une idée obsolète. » Une opinion que tempère Jocelyn Létourneau. « Si la société québécoise a été traversée par l’ambition de faire nation, affirme-t-il, cette idée n’a jamais été portée de la même façon par tous. Beaucoup veulent faire partie de la fédération canadienne, mais pas au point d’être assimilés, beaucoup veulent s’en distinguer, sans s’en séparer. Cette ambivalence est constitutive de l’identité québécoise. »
Officiellement, le Québec privilégie l’« interculturalisme » : un modèle de société ouverte, mais organisée autour d’une culture centrale. Dans la pratique, sur fond de mauvaise conscience historique – l’époque antérieure à la Révolution tranquille des années 60 étant disqualifiée comme « la Grande Noirceur » -, certains aspirent à liquider l’héritage du vieux Canada français.
Ce phénomène d’« ingratitude à l’égard du passé » choque Antoine Robitaille. « En classe, se souvient-il, nous apprenions Molière par cœur. Aujourd’hui, je connais une librairie, à Québec, où les écrivains français sont classés parmi la littérature étrangère !»
Dans un pays qui a été, jusqu’aux années 1960, un bastion du catholicisme, les églises sont désertes, et souvent vendues puis transformées en appartements. Les Québécois, cependant, d’après une étude de 2007, sont près de 85 % à se déclarer catholiques, et ils n’ont pas fait mauvais accueil au 29e Congrès eucharistique international qui vient de se dérouler à Québec. Mais à partir de la prochaine rentrée scolaire, tous les élèves du primaire et du secondaire devront suivre le cours obligatoire d’« éthique et de culture religieuse », qui remplace le traditionnel enseignement confessionnel catholique ou protestant. L’inspirateur de ce programme, le philosophe Georges Leroux, professeur à l’Université du Québec à Montréal, se justifie ainsi : « L’école doit préparer les enfants à la société dans laquelle ils vont vivre, et cette société n’est pas monolithique ».
Mathieu Bock-Côté, jeune et brillant essayiste conservateur, s’insurge contre ce qu’il nomme « la dénationalisation tranquille » du Québec : «On confond l’ouverture à l’autre et le reniement de soi. Comment intégrer les immigrants à la culture québécoise si l’Etat québécois lui-même renonce à assumer cette culture et à la transmettre ? » Joseph Facal, né en Uruguay de parents d’origine espagnole, n’est pas un franco-québécois de souche. « Fait partie du Québec, rappelle-t-il, quiconque veut venir ici. Le cœur de cette nation, ce sont néanmoins 80 % de francophones, qui voudraient qu’on leur reconnaisse le droit de dire « nous » sans les culpabiliser. On peut de même être agnostique et ne pas rougir du passé catholique du Québec. Le projet multiculturaliste à la canadienne, enfermant l’immigrant dans sa culture d’origine, mine la cohésion sociale. »
Un dernier point trouble les Québécois, toutes familles confondues. Le 17 octobre prochain, le XIIe sommet de la francophonie s’ouvrira à Québec. Nicolas Sarkozy y sera. On lui prête l’intention de modifier la doctrine française qui consistait à manifester « ni-ingérence, ni-indifférence » à l’égard des rapports entre le Québec et le Canada, et à se rapprocher d’Ottawa. Les souverainistes québécois le vivent mal. Et au même moment, les moins indépendantistes se demandent si la francophonie intéresse encore Paris. « Ce n’est quand même pas nous, s’exclame Jocelyn Létourneau, qui pouvons porter ce projet tout seuls ! A la France de jouer son rôle. »
De notre envoyé spécial, Jean Sévillia
Le choc des cultures
Au cours des dix dernières années, 400 000 immigrants sont arrivés au Québec, regroupés pour l’essentiel à Montréal. Aux termes d’un accord avec Ottawa, la province maîtrise sa politique d’immigration, volontairement orientée vers les pays francophones. Aujourd’hui, 40 % des immigrés proviennent du Maghreb. En janvier 2007, Hérouxville, un village de 1300 habitants, situé à 200 kilomètres de Montréal, adopte un « code de vie » à l’intention des immigrants, rappelant que les arbres de Noël ou les croix au bord des chemins font partie des traditions locales, qu’un médecin homme peut soigner une femme, que les piscines sont mixtes et que le port de la burqa, l’excision et la lapidation sont interdits… L’affaire, qui fait le tour de la planète, révèle l’inquiétude de l’opinion face à des demandes communautaires croissantes, et parfois satisfaites : à Montréal, un jeune sikh avait ainsi obtenu le droit de porter à l’école son couteau rituel, le kirpan, et deux musulmanes avaient pu voter entièrement voilées.
Un mois plus tard, le gouvernement instituait une commission chargée de conduire une consultation populaire sur « les accommodements ethnoculturels et religieux consentis aux minorités issues de l’immigration ». De septembre à novembre 2007, une vingtaine de journées d’information se sont tenues à travers le Québec, donnant lieu à des présentations de mémoires ou des témoignages, en présence de la télévision et de la radio. Coprésidée par l’historien et sociologue Gérard Bouchard, francophone et fédéraliste, et par le philosophe Charles Taylor, anglophone et fédéraliste, la commission a rendu son rapport au début du mois de mai dernier, prônant une plus grande ouverture aux autres cultures. Une de ses propositions les plus symboliques consistait à demander le retrait du crucifix qui trône derrière le siège du président du parlement de la province. Le 22 mai, à l’unanimité, les députés à l’Assemblée nationale du Québec ont décidé que ce crucifix ne serait pas retiré. « L’Eglise a joué un très grand rôle depuis 350 ans, le crucifix est un symbole de cette histoire, et n’est pas seulement religieux », a plaidé le Premier ministre québécois, le libéral Jean Charest, qui avait pourtant mis en place la commission Bouchard-Taylor.
J.S.