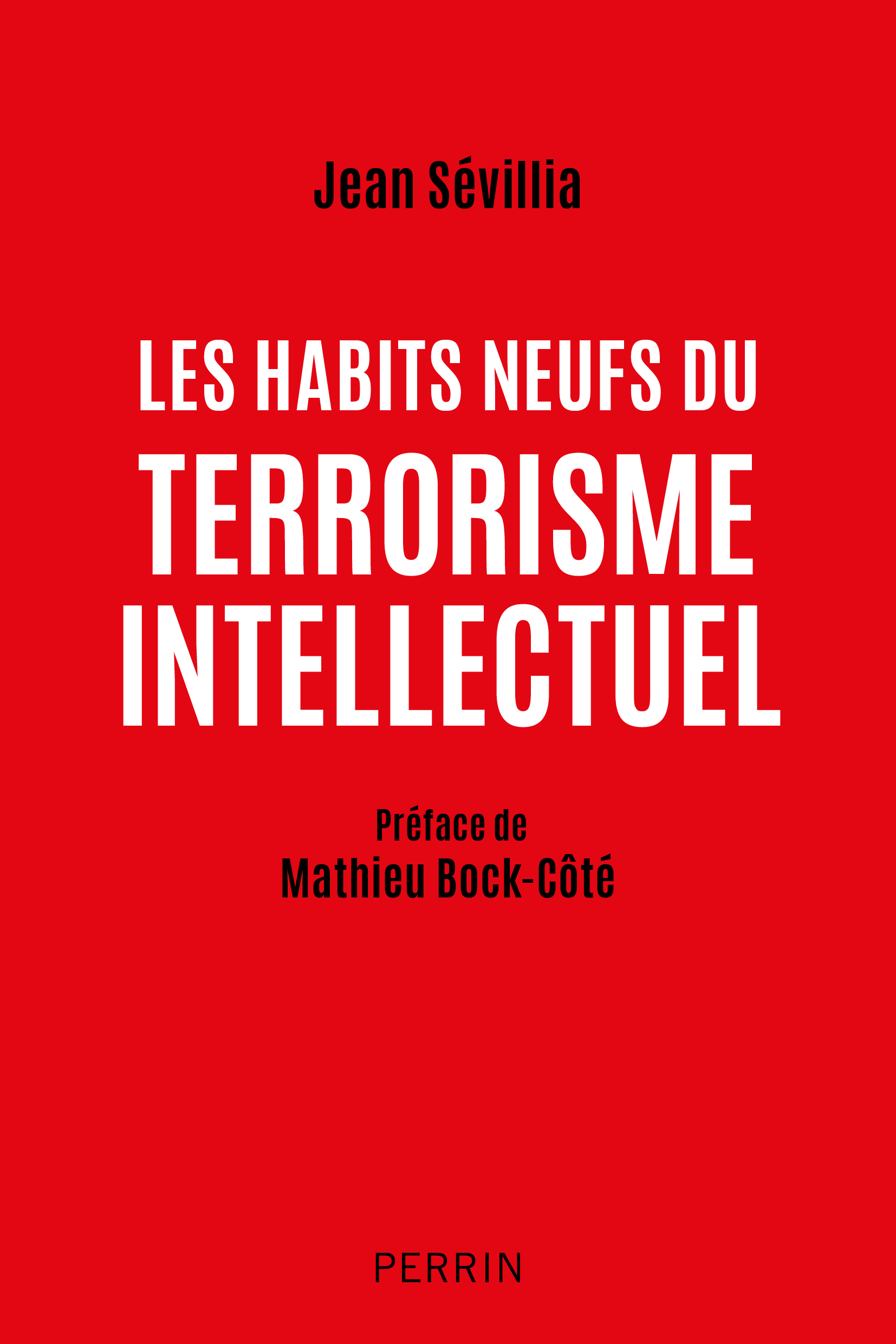Quand les communistes français profitent du rôle joué par l’URSS dans la victoire contre le nazisme pour développer un véritable terrorisme intellectuel.
Le 6 juin 1944, les Anglo-américains débarquent en Normandie. Le 15 août, c’est en Provence que les Alliés prennent pied sur le continent. Le 25 août, Paris est libéré. Au même moment, sur le front Est, les troupes du Reich reculent. Le 1er août, alors que les Allemands commencent à évacuer Varsovie, l’armée secrète polonaise se soulève. Ce sont les SS qui sont chargés de réprimer l’insurrection. L’armée rouge n’est qu’à 20 km de la ville, mais elle ne bouge pas. Les plans de Staline sont formels : il faut laisser les nazis écraser les patriotes polonais, ce qui épargnera aux Soviétiques de le faire. Le 28 août, les derniers résistants se réfugient dans les égouts de Varsovie, où ils tiendront un mois encore. A Paris, à la mi-septembre, l’IFOP (institut de sondage fondé juste avant la guerre) reprend ses activités. Une de ses premières enquêtes, publiée dans le courant du mois, révèle que pour 61 % des Français, l’URSS est la puissance qui a le plus contribué à la défaite allemande, 29 % attribuant ce mérite aux Etats-Unis…
Un an plus tard, en octobre 1945, lors des premières élections législatives d’après-guerre, le parti communiste remporte plus de 26 % des suffrages, devançant les démocrates-chrétiens du MRP et les socialistes de la SFIO. En 1946, ce score monte à 28 % des voix. De 1945 à 1947, les communistes siègent au gouvernement. Le PCF, auréolé de sa participation à la Résistance (« le parti des 75 000 fusillés », chiffre mythologique, supérieur au nombre total des fusillés sous l’Occupation), atteint alors son apogée. Son prestige s’augmente du crédit accordé à l’URSS, ce pays ami dont l’opinion pense qu’il a joué le plus grand rôle dans la défaite de Hitler.
Un trou de mémoire collectif engloutit ce qui s’est passé quelques années auparavant. En août 1939, les communistes français ont approuvé le pacte germano-soviétique, et pendant que Maurice Thorez, le secrétaire général du PCF, désertait son régiment pour rejoindre l’URSS, le gouvernement Daladier a interdit le Parti et l’Humanité. Six jours après l’entrée des Allemands dans Paris, les communistes ont sollicité l’autorisation de faire reparaître leur quotidien auprès de la Propagandastaffel. C’est en 1941 seulement, quand Hitler a attaqué l’URSS, qu’ils sont entrés dans la Résistance. A la Libération, qui oserait rappeler ces faits ? Thorez a été amnistié, l’entente Hitler-Staline est occultée, et les 4 500 officiers polonais dont les dépouilles ont été exhumées par les Russes à Katyn, selon la version officielle, ont été tués par les nazis.
Tragique ambiguïté de 1945. La victoire sur l’Allemagne nationale-socialiste, victoire indispensable, victoire vitale, a été remportée grâce au concours de l’Union soviétique. Stratégiquement, il n’existait pas d’autre solution. Mais voilà l’URSS rangée dans le camp de la liberté, et le silence de se faire sur la nature totalitaire de son régime. Comparer le nazisme et le communisme est interdit : s’y risquer, c’est être suspecté de sympathie rétrospective pour Hitler.
Le résistant Jean Paulhan est un des premiers à en faire l’expérience. Membre du Conseil national des écrivains, il en démissionne, effrayé par la tournure prise par l’épuration. Dès février 1945, le journal communiste Le patriote lance l’accusation : « Monsieur Jean Paulhan, trahissant les Lettres françaises qu’il avait servies durant l’occupation nazie, se met au service de la pensée fascisante. »
« L’antifascisme : avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l’après-guerre », écrira François Furet dans Le passé d’une illusion. La technique, pour autant, date de l’avant-guerre. Dans les années 30, l’anticléricalisme étant passé de mode, l’antifascisme est le creuset de toutes les gauches. Il sert de dénominateur commun à l’alliance ébauchée, le 12 février 1934, lors de la première manifestation réunissant communistes et socialistes, alliance concrétisée, en juillet 1934, par la signature d’un pacte d’unité d’action entre le parti communiste et la SFIO. C’est aussi l’antifascisme qui prépare la coalition formée entre communistes, socialistes et radicaux, un an plus tard, en vue des élections de 1936 qui donneront la victoire au Front populaire.
Pour les communistes, ces retrouvailles avec les socialistes obéissent à un choix tactique opéré à Moscou. Après l’écrasement des communistes allemands par les nazis, échec d’une stratégie qui consistait, pour Staline, à laisser Hitler démolir la République de Weimar dans l’espoir que les communistes ramassent le pouvoir, le Kremlin, abandonnant la ligne « classe contre classe », donne consigne aux partis affiliés à la IIIe Internationale de s’allier aux socialistes, afin de former, au nom de la défense de la paix, un front commun contre le fascisme. A Paris, Willi Münzenberg, un agent du Komintern, chef d’orchestre de la propagande pour l’Europe de l’Ouest et l’Allemagne, met cette tactique en oeuvre, pendant qu’Eugen Fried, un Tchèque qui est le véritable chef clandestin du PCF, veille à son application. Il s’agit de faire passer la cause de la paix par la défense de l’URSS, donc du communisme : être pour la paix, c’est être contre Hitler ; être contre Hitler, c’est être pour Staline ; a contrario, être contre Staline, c’est donc être pour Hitler.
Après-guerre, les communistes resservent cette thématique antifasciste. Le communisme incarne le bien absolu, et le nazisme le mal absolu. A gauche, ceux qui veulent servir la « classe ouvrière » doivent suivre les communistes (le Bien). A droite, l’hostilité à l’encontre du Bien (le communisme) trahit une connivence implicite avec le Mal (le nazisme). La droite libérale et la droite nationale sont complices dans l’anticommunisme ; la droite nationale est en réalité fasciste ; or le paradigme du fascisme est le nazisme. Donc un libéral peut glisser vers le fascisme, car l’anticommunisme conduit au nazisme.
Immense sophisme, mais d’une puissance d’attraction considérable : qui ne serait pas révulsé par Hitler ? Afin de donner consistance au danger fasciste, il faut donc inventer des fascistes. De Gaulle fonde le Rassemblement du peuple français ? C’est un fasciste. Certains prétendent que l’URSS abrite des camps de concentration ? Ce sont des fascistes. Raymond Aron dénonce le communisme international ? C’est un fasciste.
Les accords de Yalta, en 1945, ont prévu en Europe de l’Est des élections libres qui n’auront jamais lieu : la nuit du stalinisme tombe sur les démocraties populaires. « De Stettin, dans la Baltique, à Trieste, dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent », constate Churchill le 5 mars 1946. La guerre froide commence, mais la propagande communiste invente un ennemi fictif : l’impérialisme américain. Et ceux qui se hasardent à mettre en garde contre l’adversaire réel tombent sous le coup de l’accusation suprême, colportée non seulement par les communistes mais par leurs compagnons de route : « L’anticommunisme est la force de cristallisation nécessaire et suffisante d’une reprise du fascisme », affirme Emmanuel Mounier en 1946.
Le terrorisme intellectuel culmine en 1949, lors du procès Kravchenko. Dans son livre J’ai choisi la liberté, ce citoyen soviétique, réfugié politique aux Etats-Unis, a exposé la nature totalitaire du régime soviétique. A Paris, un procès l’oppose aux dirigeants des Lettres françaises, hebdomadaire communiste qui l’accuse d’être un faussaire. Kravchenko produit des témoins qui sont tous des rescapés des camps soviétiques, et parfois, comme Marguerite Buber-Neumann, doublement rescapés, puisque cette dernière est passée directement du goulag à Ravensbrück, livrée par Staline à Hitler après le pacte germano-soviétique. Devant le récit de leurs souffrances, l’avocat des Lettres françaises n’a qu’un commentaire : « La propagande nazie continue ». « Un anticommuniste est un chien », s’écriera encore Jean-Paul Sartre en 1961.
Pour que la vérité sur le système soviétique se fasse jour, il faudra attendre longtemps encore. Mais d’ailleurs, a-t-elle jamais été vraiment faite ?
Jean Sévillia