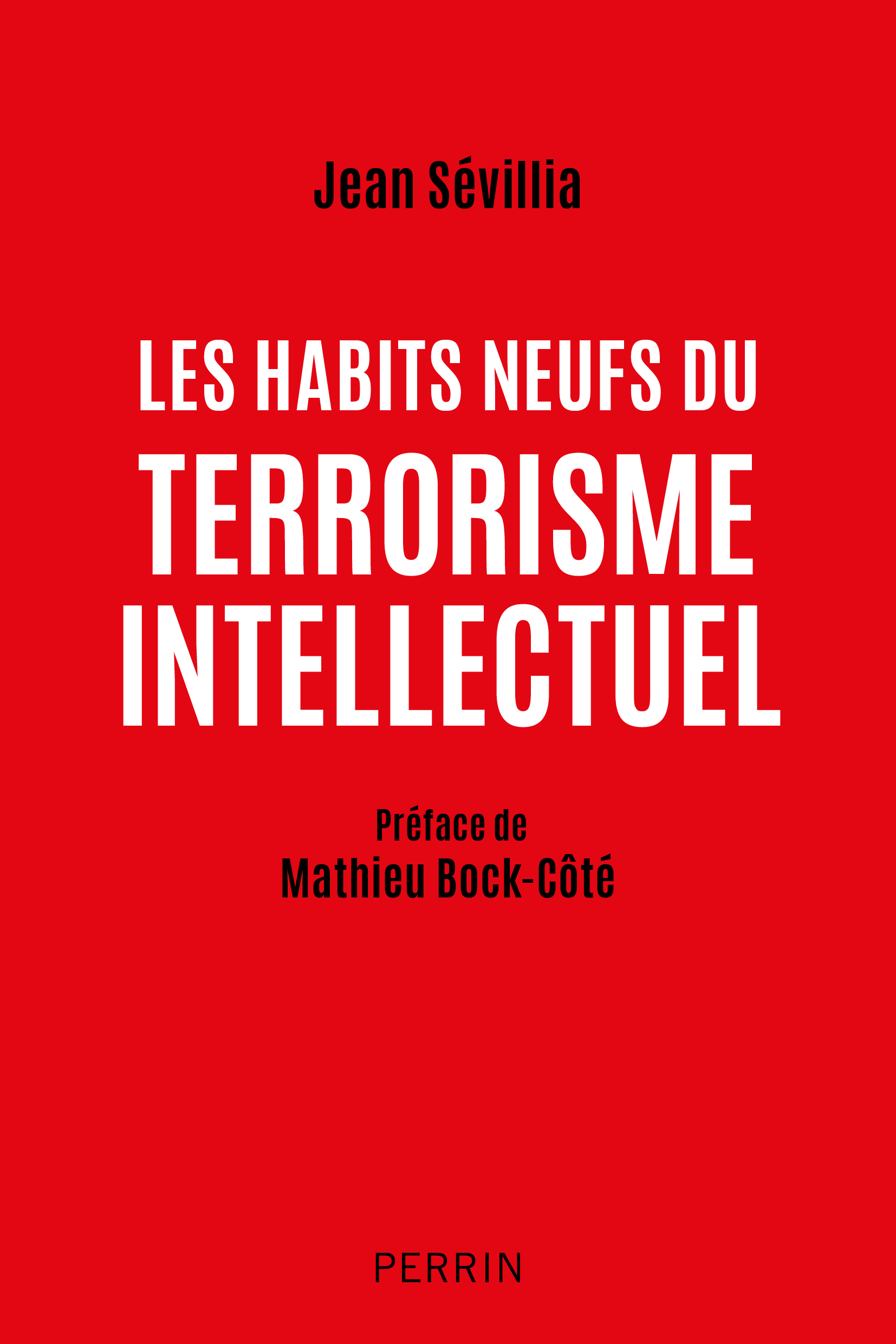Ils ont entre 15 ans et 25 ans, et ils n’ont jamais connu d’autre pape que Jean-Paul II.
Qui sont ces jeunes catholiques qui applaudiront le souverain pontife
à Lourdes le 15 août ?
Leurs sacs bouclés, ils sont prêts. Laissant derrière eux leurs parents, leurs vacances ou leur job d’été, ils vont se retrouver là-bas : à Lourdes. Pour rien au monde ils ne manqueraient cette rencontre, le 15 août, avec Jean-Paul II. Les plus âgés ont pris part aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont déroulées à Paris en 1997, et ils en parlent comme les briscards d’autrefois racontaient leurs campagnes ; les plus chanceux étaient à Rome en 2000, et ils n’oublieront jamais le rassemblement final de Tor Vergata, un million de jeunes écrasés les uns contre les autres, carbonisés par un soleil de plomb et couverts de poussière ; quelques-uns, en 2002, se sont rendus aux JMJ de Toronto, et gagner les Pyrénées, en 2004, leur paraît tout simple.
Ils ont entre 15 et 25 ans, et ils appartiennent à une étrange tribu. Cette tribu, journalistes et sociologues lui ont donné un nom : la génération Jean-Paul II. Ils croient en Dieu, ils sont catholiques (ils disent « cathos »), ils aiment le pape et ils en sont fiers, tout cela en étant pleinement de leur temps, pour le meilleur et pour le pire, et parfaitement à l’aise dans leurs baskets : assurément des animaux bizarres.
En 1977, l’historien Jean Delumeau publiait un essai qui fit grand bruit : Le christianisme va-t-il mourir ? Une telle question, presque trente ans plus tard, ferait rigoler la génération Jean-Paul II. Peu après 68, déjà, quand les graffitis fleurissaient, un quidam avait réagi à un slogan peint sur un mur de la Sorbonne ou de Nanterre : « Dieu est mort. Signé Marx » . L’heureux farceur avait trouvé la réplique : « Marx est mort. Signé Dieu ».
Delumeau postulait dans son livre qu’à l’ère de la sécularisation et de l’émancipation des individus, le christianisme était caduc dans sa version catholique. Un an après, en 1978, la vieille Eglise romaine portait à sa tête un prélat dont le verbe prophétique allait changer la donne.
« France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Ce cri, lancé par Jean- Paul II lors de sa première visite en France, en 1980, ne cesse de retentir. Il est vrai que la crise traversée par le catholicisme français entre 1965 et 1978, a légué un bilan accablant.
Jusqu’à la fin des années 60, plus de 90 % des Français étaient baptisés à leur naissance dans la religion catholique ; dans un pourcentage moindre, ils étaient massivement catéchisés, mariés et enterrés à l’église. Aujourd’hui, les Français ne sont plus que 62 % à se déclarer catholiques, 12 % appartenant à une autre confession (musulmans 6 %, protestants 2 %, juifs 1 %, autres religions 3 %), et 23 % affirmant être « sans religion »(1) .
Et encore faut-il ajouter que les catholiques ne se bousculent pas pour pratiquer leurs sacrements. Au terme d’une déperdition progressive, la baisse du nombre de pratiquants s’est maintenant stabilisée, mais à un niveau bas : 10 % de pratiquants réguliers du dimanche (2) . Pour mémoire, ils étaient 37 % en 1948, 25 % en 1968 et 13 % en 1988. Quant au clergé, les statistiques sont saisissantes. En 1980, 38 000 prêtres étaient en activité (y compris les prêtres religieux au service des diocèses) et 28 000 en 1995 : aujourd’hui, ils ne sont plus que 13 500, dont 3 600 de moins de 55 ans. En comptant les séminaristes actuellement en formation, seulement 4 500 prêtres seront en activité dans dix ans, dans un pays de plus de 60 millions d’habitants (3) . Chiffre auquel il conviendra d’ajouter, pour le clergé régulier, moins de 10 000 religieux et environ 25 000 religieuses. A titre de comparaison, l’historien rappellera que la France de 1878, pour 38 millions d’habitants, recensait 56 000 prêtres diocésains, 30 000 religieux et 130 000 religieuses…
Denis Pelletier, un universitaire qui a analysé la crise du catholicisme français, remarque que le phénomène n’est ni spécifiquement français, ni spécifiquement catholique, et qu’il a coïncidé avec la mutation d’un pays « confronté à une redéfinition générale de son système de références » (4) . La rupture intervenue dans les années 1965-1975, en effet, a affecté toutes les institutions. La tradition catholique a été touchée, mais également la laïque : si les paroisses se sont vidées, les partis en ont fait autant. Face à l’échec tragique des messianismes séculiers et à l’effondrement des systèmes idéologiques, les incroyants, à leur manière, ont subi les affres du doute.
Il est d’ailleurs permis de craindre que le relativisme qui en est résulté, conforté par le conformisme social, n’érige ce doute en vertu obligatoire, au point que l’affirmation d’un absolu ou d’une transcendance devienne suspecte. Le catholicisme, parce qu’il représente une foi non réductible à l’air du temps, articulée autour d’une Eglise dont le mode de fonctionnement hiérarchique n’est pas dans le goût de l’époque, apparaît à cet égard particulièrement visé. C’est en ce sens que le philosophe Marcel Gauchet souligne que « la communauté catholique est la seule minorité persécutée, culturellement parlant, dans la France contemporaine » (5) .
Mais alors, dira-t-on, voilà de quoi désespérer la fameuse génération Jean-Paul II. Eh bien non, c’est justement le contraire. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes qui applaudiront le pape à Lourdes, il faut se mettre dans leur chronologie à eux. Nés dans les années 80, ils sont apparus à la vie de l’esprit à la fin des années 90. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas connu d’autre société que la nôtre, et pas d’autre état du catholicisme. Le marxisme et la chute du mur de Berlin, les enjeux des années Giscard ou des années Mitterrand, ce sont pour eux des débats du passé. L’incroyance contemporaine ? Ils ont toujours vu les églises de campagne fermées. L’effacement des repères ? Leurs parents les avaient déjà perdus. Rien ne les surprend, pas même la présence de l’islam en France, car cela aussi fait partie de leur paysage natal. Tels qu’ils sont, ils se savent minoritaires et affrontés à un univers qui ne leur est pas acquis. Apparemment, cela ne leur fait pas peur.
Minoritaires, mais de leur temps : ils n’échappent pas toujours à ses travers. En un moment où l’individualisme est roi et, la personne n’est rien, certains (pas tous), tout catholiques qu’ils s’affirment, n’hésitent pas à se fabriquer une foi à la carte. Ils aiment les rassemblements festifs ou la prière individuelle, pas toujours la messe, mais il est vrai qu’il n’y a pas grand monde, même dans le clergé, pour leur apprendre le caractère sacré de la liturgie.
Là où ils se sentent en phase, ces jeunes, c’est avec le pape. Ils n’en ont pas connu d’autre, bien sûr, mais il est fascinant de voir combien Jean-Paul II, plus il est âgé et malade, suscite l’enthousiasme des multitudes juvéniles. Un vieillard souffrant qui tire de sa faiblesse une force supplémentaire, c’est un prodigieux spectacle en une époque qui cultive l’image et l’émotion. Mais s’il les séduit, ce vieil homme, c’est d’abord parce que le message chrétien qu’il diffuse incite les jeunes à aller vers le haut. Et parce que dans une société où il est si difficile de devenir adulte, le pape, d’emblée, leur fait confiance.
Minoritaires, les cathos n’en sont pas moins les seuls à pouvoir rassembler de telles foules, à partir d’un encadrement bénévole dans sa quasi-totalité. Gageons que les commentateurs, le 15 août, seront une fois de plus surpris par l’affluence qui se manifestera dans la cité mariale. Les jeunes catholiques, comme les autres, utilisent Internet et possèdent un téléphone portable. Depuis plusieurs semaines, leurs réseaux fonctionnent et le message passe : rendez-vous à Lourdes. Le site Génération Jean-Paul II (www.generationjpii.org) y va de sa recommandation : « En attendant, bonnes et saintes vacances ! N’oublions pas d’en profiter pour « bronzer notre âme ». »
Ils viendront de partout. Plus volontiers, cependant, des secteurs de l’Eglise qui sont attentifs au charisme du pape. Il y aura là des représentants de la Mission étudiante, qui fédère les aumôneries des universités et les communautés chrétiennes des grandes écoles ; des élèves des écoles catholiques et d’autres amenés par les aumôneries des lycées publics ; des groupes paroissiaux et des fidèles des communautés nouvelles ; des scouts et des militants des associations humanitaires. Et les jeunes prêtres, qui ressemblent à leurs ouailles et non aux curés politisés des années 1970, et qui appartiennent aussi à la génération Jean-Paul II.
Après le pèlerinage à Chartres des étudiants d’Ile-de-France, en 2002, le cardinal Lustiger tirait cette conclusion : « Nous sommes en train de tourner la page de la génération qui a rompu il y a trente ans. Ces jeunes sont semblables à une forêt qui repousse après une tornade. » Ces jeunes-là, avec leur air trop sage, leur enthousiasme et leurs chants, d’aucuns les jugeront candides. Reste à savoir si leur candeur n’est pas la marque des apôtres.
Jean Sévillia<
(1) Sondage CSA Le Monde-La Vie, Le Monde, 17 avril 2003.
(2) La Croix, 25 décembre 2001.
(3) La Croix, 29-30-31 mai 2004.
(4) La Crise catholique, Payot, 2002.
(5) La Vie, 7 décembre 2000.