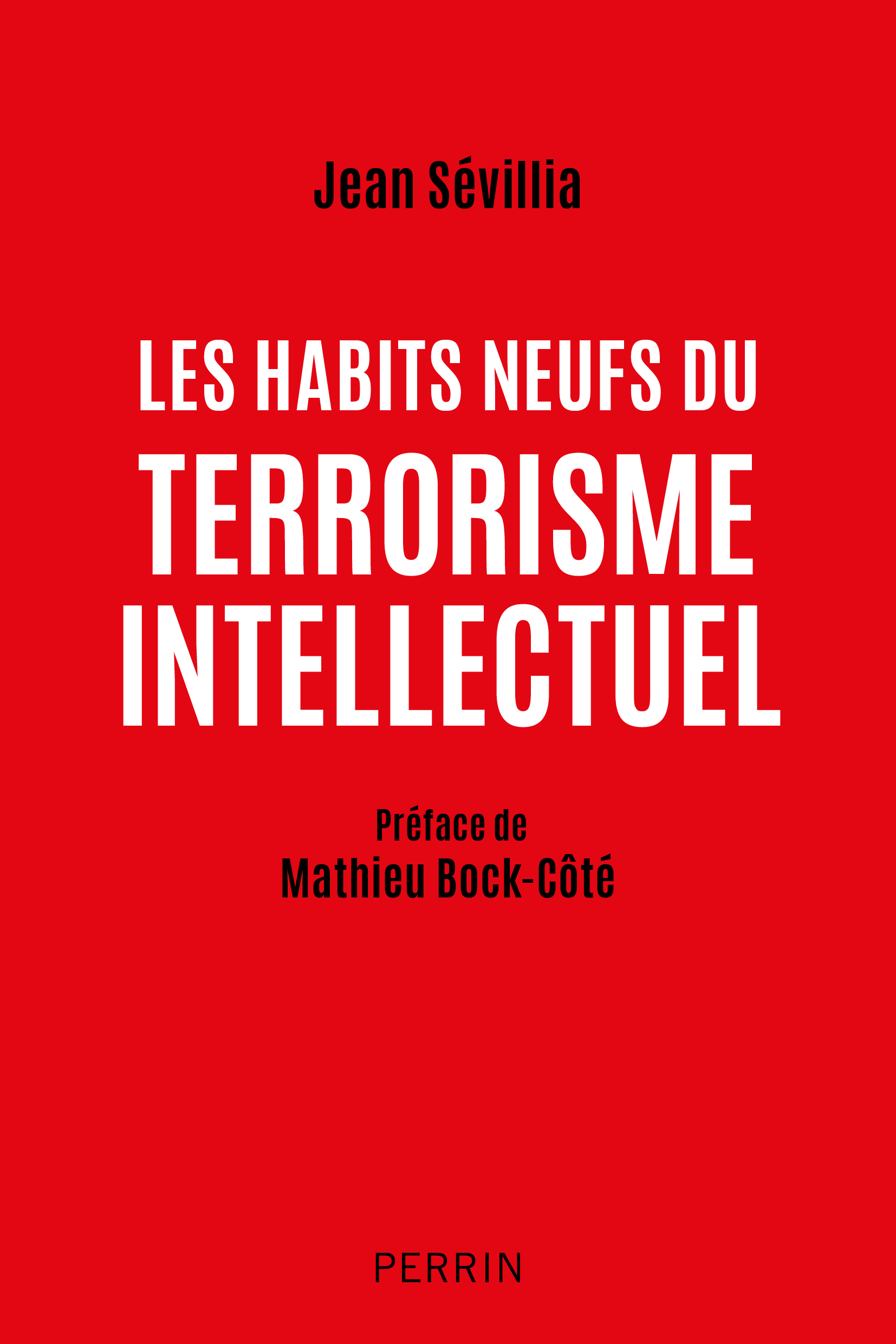Il y a cent ans, le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche était assassinée.
Elle était belle. Elle était la souveraine d’une monarchie prestigieuse. Mais malgré l’amour que lui vouait l’empereur François-Joseph, elle traînait son mal de vivre à travers le monde. Portrait d’une femme qui s’était trompée de siècle.
Hasard du calendrier, le centième anniversaire de la mort d’Elisabeth d’Autriche survient alors que la planète vient de commémorer la disparition de la princesse de Galles. Accoler ces deux figures, c’est prendre le risque de choquer. Et pourtant… Entre ces deux femmes s’imposent quelques traits communs : une destinée royale, un mariage fondé sur un malentendu qui exacerbe les différences, la peur des obligations officielles, le repli sur soi, la fin tragique. La comparaison s’arrête là : du point de vue politique, Elisabeth a régné et n’a pas fait défaut à François-Joseph aux heures les plus graves ; sur le plan humain, elle fut intelligente et manifesta une fidélité sans faille à l’égard de son mari pour des raisons qui vont bien au-delà des normes morales et des conditions de vie à la Cour. Paul Morand, qui n’aura pas connu lady Diana, nous ramène cependant à ce parallèle, quand il constate à propos de Sissi : « Aujourd’hui, les historiens, les scénaristes, les dramaturges restent sous le charme : une impératrice libertaire, une tête couronnée qui étouffe sous les devoirs de sa charge et se révolte contre son rang, suffit à ravir le grand public des hebdomadaires, qui veut que les reines s’habillent comme des reines et se conduisent comme des poules. »
En 1998, pourquoi cette fièvre pour Elisabeth d’Autriche ? Elle se vérifie, à Vienne, par la foule internationale qui se presse aux expositions qui lui sont consacrées, et par le succès commercial des « produits dérivés » à son effigie. Posters, foulards, stylos, montres, porte-clefs, tasses, confiseries ou liqueurs : rien n’arrête la « sissimania », pas même le mauvais goût et surtout pas les scrupules. En privé, les Habsbourg, spoliés de leur patrimoine familial et longtemps bannis de leur propre pays, sourient volontiers de la complaisance avec laquelle la République empoche les dividendes de la nostalgie impériale.
C’est le cinéma qui a créé le mythe Sissi. Plus de vingt films ont porté son personnage à l’écran, du Mayerling d’Anatole Litvak (1935) jusqu’au Ludwig de Visconti (1972). La série culte de l’Autrichien Ernst Marischka, toutefois, remporte la palme. Dans Sissi (1955), Sissi impératrice (1956) et Sissi face à son destin (1957), Elisabeth a les traits de Romy Schneider, et les conserve dans ces milliers de foyers où, pendant les vacances de Noël, les petites filles pleurent en regardant ces cassettes vidéo. Paysages alpestres et lacs bleutés en Agfacolor, valses langoureuses et palais dorés, c’est l’Autriche des cartes postales années 50, celle qui exorcisait ses bleus à l’âme. Ce qui reste un triomphe de l’histoire du cinéma, en dépit de sa niaiserie, n’entretient malheureusement qu’un rapport lointain avec la réalité.
Elisabeth était née en 1837. Son père, Maximilien, duc en Bavière, était un cousin du roi de Bavière ; sa mère, Ludovica, était la propre soeur du roi. Chef d’une branche exclue du trône, le fantaisiste duc Max s’abandonnait à ses inclinations : la nature, les animaux, le cirque, les vers, la cithare. Entre Munich et le manoir de Possenhofen, sur le lac de Starnberg, Elisabeth et ses sept frères et soeurs ont donc poussé dans un climat chaleureux, original, hors de tout protocole.
A Vienne, cependant, François-Joseph régnait depuis 1848. Sa mère, l’archiduchesse Sophie (soeur de Ludovica), était une tête politique. Pour son fils encore célibataire, elle voulait une alliance sûre. Elle porta son choix sur Hélène, l’aînée de ses nièces bavaroises. L’été 1853, une rencontre fut organisée à Ischl, résidence d’été des Habsbourg. Le jeune souverain avait 23 ans. Mais, surprise, sa cousine Hélène ne l’attira pas. A peine eut-il aperçu sa cadette Elisabeth, une ravissante fleur de quinze printemps, que François-Joseph en tomba éperdument amoureux. « Comme un lieutenant » , avouera-t-il. Le lendemain, il l’annonca à sa mère : il épouserait Sissi – ce diminutif était son surnom familial. Quand, bouleversée, cette presque enfant apprit sa décision, elle prononça ce mot qui présageait ses réactions ultérieures : « Si je l’aime ? Bien sûr, comment ne l’aimerais-je pas ! Mais si seulement il n’était pas empereur » …
Leurs noces seront célébrées le 24 avril 1854, à Vienne, dans l’église des Augustins. Déjà, l’accueil solennel en Autriche, en suivant le cours du Danube, avait constitué une épreuve pour la jeune fille timide, terrorisée à la perspective d’être le centre de toutes les attentions. Les festivités nuptiales, de fêtes en réceptions, durèrent une semaine. A leur issue, Elisabeth crut pouvoir échapper à la Cour pour se blottir dans sa vie privée. Erreur. Elle était désormais un personnage public, dont l’étiquette réglait le moindre des gestes. Plus tard, elle baptisera le vieux palais impérial, la Hofburg, d’un jeu de mots : « Kerkerburg » le palais-cachot.
Cette étiquette viennoise, contrairement à ce qui se répète, ne datait pas de Charles-Quint. La grande impératrice Marie-Thérèse, au XVIIIe siècle, ou l’empereur François, le père de Marie-Louise, observaient un mode de vie que nous qualifierions de bourgeois. Mais, au XIXe siècle, surtout après la révolution de 1848, la dynastie autrichienne avait renforcé son protocole, afin de signifier qu’elle incarnait la légitimité monarchique face à une Europe où montaient les idées républicaines : il faudra attendre le court règne de Charles Ier et de Zita, de 1916 à 1918, pour que les Habsbourg réapprennent la simplicité.
Le cérémonial, François-Joseph y tenait à l’excès. Sa mère également, et d’autant plus qu’elle avait immédiatement compris le caractère de sa belle-fille. Victime de la légende forgée par les films de Marischka, l’opinion est injuste avec l’archiduchesse Sophie. Celle-ci a sûrement manqué d’habileté dans ses relations avec Elisabeth, mais elle avait discerné dans sa personnalité, derrière son aversion à l’égard des servitudes de sa fonction, une profonde faille psychologique : l’égocentrisme. Or, le métier de souverain implique le don de soi. Pour ressembler un peu à son mari qui se voulait le premier fonctionnaire de son empire, Elisabeth luttera contre elle-même. Mais pas toujours, pas longtemps, et sans grand résultat : c’était tellement contre sa nature, c’était si au-dessus de ses forces. La solution, elle la trouvera dans la fuite.
La venue au monde de ses deux premières filles, Sophie, née en 1855 et tragiquement décédée deux ans plus tard, et Gisèle, née en 1856, fournira l’occasion d’un violent affrontement avec sa belle-mère, puisque le soin des deux princesses sera enlevé à Sissi. Même sort pour l’archiduc Rodolphe, né en 1858. Cette mesure cruelle provenait de l’incertitude de l’archiduchesse Sophie quant à la capacité d’Elisabeth à élever ses enfants. La suite ne lui a pas donné tort. François-Joseph, en tout cas, refusa de trancher contre sa mère. Si bien qu’apparurent chez l’impératrice toux, spasmes, perte d’appétit, symptômes qu’elle traîna toute sa vie, mal possédant toutes les apparences d’un dérèglement psychosomatique.
A 23 ans, Elisabeth n’est plus une épouse, à peine une mère, et tout juste une impératrice. Mais son mari l’adore, et fera tout pour la garder. Fin 1860, les médecins prescrivent un changement de climat. L’Europe s’émeut, la reine Victoria prête son yacht. Madère, Corfou, Venise, le voyage dure plus d’un an. Il inaugure une errance qui forme à la fois un défi à la cour de Vienne, abhorrée, et un moyen de pression sur François- Joseph : en 1865, à la suite d’un ultimatum, Sissi a obtenu de lui un droit de regard sur l’éducation des enfants, et la liberté de résider où elle le désire. Ses enfants, elle ne s’en occupera guère ; en revanche, elle menacera de partir à chaque fois que l’empereur ne se pliera pas à ses volontés.
A cette époque apparaît son engouement pour la Hongrie. Elle apprend le magyar (pourtant la langue la plus difficile qui soit), se lie avec Gyula Andrassy – député libéral condamné à mort après la révolte de Budapest contre les Habsbourg, en 1848, puis gracié – , s’entoure de dames d’honneur hongroises. Pour une fois, et au moins à court terme, cette flamme va servir la politique de son mari. En 1866, lors de la guerre austro-prussienne, Elisabeth se tient à son côté pour le soutenir. Chassé d’Allemagne par la victoire de Bismarck à Sadowa – drame méconnu de l’histoire du Vieux Continent –, François- Joseph doit consolider son empire multinational autour de son noyau danubien. Aussi le plaidoyer d’Elisabeth en faveur des Magyars est-il exaucé. En 1867, le compromis austro-hongrois transforme les Etats des Habsbourg en une double monarchie, le souverain étant empereur en Autriche et roi en Hongrie.
Le couronnement royal, dans l’église Matthias de Budapest, le 8 juin 1867, sonne comme une heure de gloire pour Sissi. Et autant l’impératrice Elisabeth d’Autriche se sera détournée de sa charge, autant la reine Erszébet de Hongrie s’attachera à son peuple, affection qui lui sera rendue. Période de proximité conjugale, manifestée en 1868, alors que l’archiduc Rodolphe atteint ses 10 ans, par la naissance du dernier enfant du couple, l’archiduchesse Marie Valérie, « l’Unique », la seule qui bénéficiera d’un amour maternel total.
A Gödöllö, château que les Hongrois lui ont offert, Elisabeth se livre jusqu’à l’épuisement à une autre passion : l’équitation. Pendant une quinzaine d’années, elle ira chasser à courre en Angleterre, en Irlande ou en Normandie. Quand elle renoncera au cheval, ce sera au profit d’une pratique non moins furieuse de la marche à pied. Cette frénésie sportive allait de pair avec une autre rage très moderne, poussée chez elle jusqu’au narcissisme : le culte du corps. Si sa beauté et sa silhouette exceptionnelle fascinaient, c’est qu’elle les entretenait. Pour 1,72 mètre, elle ne pesa jamais plus de 50 kilos, avec un tour de taille de 50 centimètres : elle s’astreignait à des régimes à base de laitages, de fruits et de jus de viande, qui achevèrent de détériorer sa santé. Sa célèbre chevelure exigeait de sa coiffeuse trois heures de travail quotidien ! Mais, après ses 40 ans, elle dissimulait son visage, flétri par les privations.
L’archiduc Rodolphe partageait la fragilité nerveuse de sa mère, vraisemblablement un héritage Wittelsbach. En 1889, son suicide à Mayerling rapprochera momentanément le couple impérial, soudé dans la douleur. Mais Elisabeth, « impératrice de la Solitude » (Barrès) qui a trouvé un exutoire à sa mélancolie morbide dans les poèmes qu’elle compose en secret, continue à voyager incognito : Egypte, Tunisie, Malte, Lisbonne, Gibraltar, Sicile, Espagne. Elle passe ses hivers sur la Côte d’Azur, à Cap-Martin. François-Joseph se montre avec elle d’une inépuisable générosité, lui qui, à Vienne, dort sur un lit de camp. Il lui fait construire une villa à Corfou, l’Achilléion, et une autre dans le parc de Schönbrunn, la Villa Hermès, noms qui traduisent la nouvelle ferveur de Sissi pour la langue et la culture grecques. Eternelle insatisfaite, elle s’en désintéresse aussitôt les travaux terminés. Elle est grand-mère, mais ignore ses petits-enfants.
Le 10 septembre 1898, alors qu’elle séjournait à Genève, elle devait emprunter le bateau pour traverser le lac Léman. En ville, un anarchiste italien de 25 ans, Luigi Lucheni, rêvait d’assassiner « n’importe quelle personnalité haut placée » . Sur son chemin, la fatalité avait mis Elisabeth d’Autriche. Vers 2 heures de l’après-midi, frappée au coeur d’un coup de stylet, « la mouette » prit son ultime envol. Elle avait 60 ans. Le comte Paar, venu prévenir François-Joseph, l’entendit murmurer pour lui-même : « Nul ne sait combien nous nous sommes aimés. » De cet homme de devoir, cet amour aura été la seule folie.
Jean Sévillia