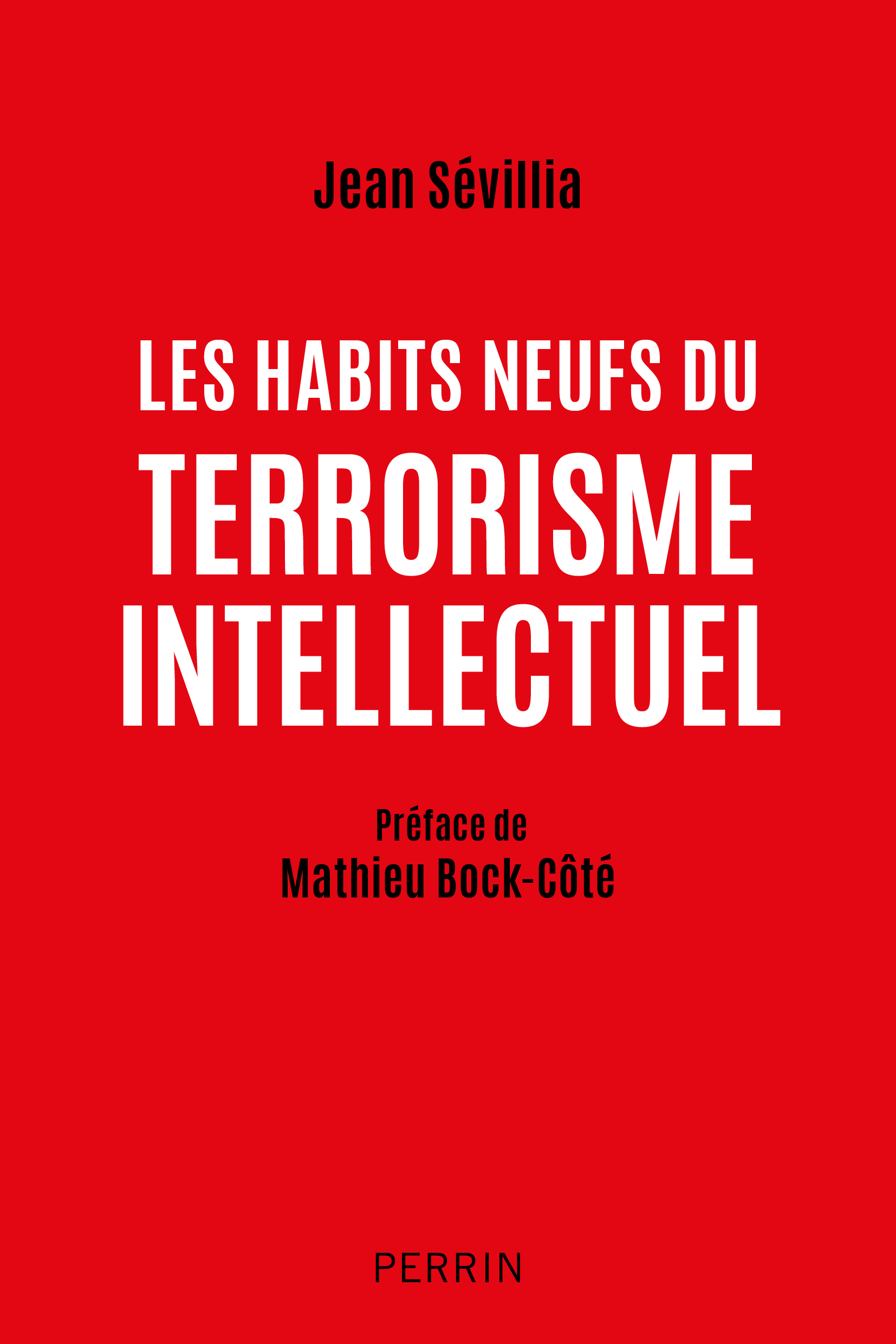La suite de la série du « Figaro » sur la « relecture » des événements de Mai 68.
Ils sont profs, ils ont 30 ans, ils enseignent en banlieue. Probablement votent-ils rose ou vert. A 73 % (1), ils ne croient plus au collège unique. Ce qu’ils attendent, ce sont « d’autres formations pour les élèves en difficulté ». Les mêmes, il y a trois décennies, auraient asséné que l’école avait pour mission d’amener tous les élèves au même niveau.
A gauche aussi, les idées évoluent : Mai 68 ne fait plus forcément recette. Et pourtant, cette « Révolution introuvable » (Raymond Aron) ne nous quitte pas. Le débat semblant toujours recommencer, la tentation pourrait être de s’en lasser. Après tout, que fut Mai 68 ? Un gros chahut d’étudiants, mené par des révolutionnaires qui n’étaient que des nantis (ce qui fit dire à Pasolini : « Entre les étudiants et les CRS, je choisis les CRS car ce sont des fils du peuple »), et une secousse économique que la France des Trente Glorieuses, prospère et dynamique, absorba en définitive assez vite.
Néanmoins, les hommes qui tiennent aujourd’hui les rênes ont eu 20 ans ou 30 ans entre 1965 et 1975. Mai 68 n’a épargné aucun d’entre eux, a fortiori ceux qui y ont pris une part active. Explication de Serge July, bien placé pour témoigner : « Cette génération a investi massivement la société civile, qu’elle a contribué à émanciper. Elle s’est investie dans le social, dans la culture, la communication et même les affaires, mais elle s’est tenue éloignée de la politique d’Etat » (2). July ne dit que la moitié de la vérité, puisqu’il sait bien que le mitterrandisme a recyclé nombre d’anciens gauchistes. Mais il souligne l’essentiel : une génération entière a été conditionnée, fût-ce à son insu, par le climat intellectuel et moral d’un mois de mai entré par effraction dans l’Histoire. Cet esprit s’est diffusé bien au-delà des clivages politiques, et c’est tout le mode de raisonnement et l’imaginaire d’un pays qui en ont été affectés. Ce qui était graffiti sur un mur de la Sorbonne, mot d’ordre tiré d’un tract ou rengaine d’une manifestation s’est institutionnalisé.
Depuis la Libération, le marxisme subjuguait Saint-Germain-des-Prés. A cette pensée dominante, 1968 ajouta d’autres composantes, plus ou moins hétérogènes : le situationnisme, le structuralisme, le spontanéisme, la psychanalyse. Etrange cocktail, sorti d’un shaker où l’on avait mélangé les « philosophes du soupçon » (Marx, Nietzsche et Freud), mais aussi Sartre et Althusser, Debord et Vaneigem, Reich et Marcuse, Derrida et Lacan. Et l’on assista à cette crise de délire : la remise en cause systématique des fondements de la société. L’école, l’université, la famille, l’entreprise, l’Etat, l’armée, la nation, les valeurs, la religion, tout était à « déconstruire ». Il était « interdit d’interdire ». Toute autorité était suspecte, toute contrainte à rejeter. L’homme n’avait plus de devoirs, il n’avait que des droits. Il n’y avait de sacré que l’individu et ses désirs. Le policier, le patron, le professeur, le père constituaient des ennemis. Pis encore, ils incarnaient le fascisme éternel tout obstacle potentiel au libre arbitre étant décrété fasciste.
Les parents ne devaient plus imposer de règles de vie, mais acquiescer aux pulsions de l’enfant. L’école n’avait plus pour fonction de transmettre des connaissances, mais d’assurer l’épanouissement de l’élève. Il appartenait à l’Université de s’ouvrir à tous : la sélection trahissait une philosophie rétrograde. Ouvriers ou paysans, débarrassés de toute hiérarchie, avaient à s’autogérer. La délinquance n’exprimant que la revanche des inégalités sociales, la justice devait s’incliner devant la lutte des classes.
Aucune norme n’était légitime le concept de norme étant injustifiable. Les traditions, les principes, la morale, ces vestiges d’un temps révolu, étaient à liquider. Idéologie de la table rase, du changement perpétuel : voyageur sans bagages, le militant de Mai refusait d’être un héritier. « Tout est possible, tout est permis », chantait Moustaki. Alors que même la gauche française était plutôt puritaine, 1968 allait infliger aux moeurs le bouleversement que l’on sait. Une vague née sur les côtes californiennes (LSD, hippies, peace and love), et qui s’est échouée sur tous les rivages de la planète.
Révolution des mentalités, révolution des moeurs, révolution culturelle. C’est en cela que 1968 et les folles années qui suivirent – en comptant la période d’effervescence gauchiste, close en 1975 – incarnent un tournant capital, révélant à vrai dire un mouvement de fond engagé auparavant.
Chez les intellectuels français, le paradigme soviétique fit référence de 1946 à 1956 (à de glorieux dissidents près, mais on se souvient que Raymond Aron lui-même fut traité de fasciste). De 1956 à 1975 prévalut le modèle tiers-mondiste (Algérie, Cuba, Chine, Vietnam). 1968 se glisse entre-temps, à la fois révolte contre le pouvoir du Parti communiste et contre l’Etat gaulliste. Débordé sur sa gauche et inapte au réformisme, le PC entrera dans un inexorable déclin. Le gaullisme, lui, ne survivra guère à de Gaulle. Les années 70 digérèrent en douceur le legs de Mai. Mais le choc Soljenitsyne, la révélation du génocide cambodgien, la fuite des boat-people vietnamiens, l’apport des nouveaux philosophes à gauche, le réveil de la pensée libérale à droite, l’élection de Jean-Paul II et l’effet Solidarnosc se conjuguèrent pour donner le coup de grâce au marxisme.
En 1981, Mitterrand réactive le mythe de la rupture révolutionnaire mais, en 1983, s’oriente vers un relatif pragmatisme. Que font les intellectuels ? Après l’effondrement de l’URSS, en 1989, le véritable débat n’est plus socio-économique : la gauche (ralliée aux lois du marché) et la droite (consciente de l’enjeu social) ne proposent plus de projets radicalement différents. Les valeurs qui mobilisent Saint-Germain-des-Prés se placent désormais dans le champ de l’éthique : droits de l’homme, lutte contre l’exclusion, morale humanitaire. Ces valeurs étant consensuelles, un certain libertarisme noue des connivences avec un certain libéralisme.
Chez les idéologues, le réflexe hérité de Mai 68 perdure cependant : l’individualisme se fait dialectique. Est alors voué aux gémonies ce qui contredit l’utopie d’un monde sans barrières, sans frontières et sans lois. Au nom de l’égalité, les chanceux et les courageux sont culpabilisés. Au nom de l’antiracisme, les droits de l’homme servent à anathématiser toute volonté de régulation des flux migratoires. Au nom de la tolérance, des circonstances atténuantes sont trouvées aux délinquants, pour peu qu’ils souffrent d’un problème d’intégration. Au nom du multiculturalisme, notre propre civilisation est dévaluée. Au nom de l’ouverture au monde, le soupçon est jeté sur l’enracinement. Au nom des bons sentiments, un droit d’ingérence est brandi qui peut recouvrir des intérêts bien peu désintéressés.
En ce sens, Mai 68 vit encore. Il en reste la méfiance à l’égard des interdits. La préférence accordée aux prérogatives personnelles par rapport aux servitudes collectives. La régression du civisme, se concrétisant notamment par l’éclatement du corps social en communautés ou par le triomphe de revendications catégorielles au détriment de l’intérêt général pour ne rien dire de l’intérêt national, notion jugée obsolète à l’heure de l’Europe et de la globalisation. Plus généralement, un climat intellectuel et moral qui privilégie la gauche, la droite ayant à s’excuser d’exister. Subsidiairement, ce sinistrisme nourrit un antifascisme hallucinatoire, aux yeux duquel Charles Millon serait infréquentable quand les jeunes gens des Motivé-e-s seraient de parfaits démocrates.
En matière de moeurs, les acquis de Mai passent pour intangibles. Les drames de la pédophilie ont cependant prouvé qu’il fallait effectuer l’inventaire de la liberté sexuelle, tabou majeur de l’époque. Jean-Claude Guillebaud ancien de 68 est bien parvenu à la conclusion que « la famille figure le dernier endroit où domine encore une représentation minimale de l’avenir » (3). Un jour, il en sera peut-être de même de la drogue, du prosélytisme
homosexuel ou de la banalisation de l’avortement : le politiquement correct a beau dénoncer un fantomatique « ordre moral », il est des questions anthropologiques qui finiront par se poser.
Mai 68 prétendait libérer les femmes. Mais à voir notre société peiner à accorder la maternité et le travail, et à constater la surenchère érotique dans la publicité, il n’est pas certain que la dignité de la femme ait progressé. Etrange : les soixante-huitards sont au pouvoir, mais la société de consommation se porte mieux que jamais.
Toutefois, tout excès suscite un retour de balancier. Depuis quelques années, le Thermidor de Mai 68 s’est enclenché. Chez les socialistes, cette catharsis est née de l’exercice du pouvoir, de la confrontation avec une réalité qui ne se plie pas aux slogans.
C’est dans le domaine économique que la réaction s’est d’abord signalée. N’évoquons que pour mémoire les rêves autogestionnaires, enterrés dès 1973-74 avec l’échec de l’affaire Lip. Mais, on l’a dit, le gouvernement Mitterrand, afin de faire face aux contraintes internationales, a tourné le dos dès 1983 au programme de 1981. Loin des incantations anticapitalistes, les socialistes ont assimilé les notions d’entreprise, de profit, de logique du marché.
Dans le domaine de l’enseignement, l’évolution est plus lente en raison des pesanteurs sociologiques caractérisant ce bastion de gauche où les appareils syndicaux veillent à maintenir la ligne. Le sondage mentionné plus haut, mené chez les jeunes professeurs, annonce peut-être une fracture générationnelle. Dans les collèges des banlieues à risque, où trop d’enseignants vivent la peur au ventre, les théories de 1970 sur l’école sans maître ni règlement (type « Libres Enfants de Summerhill ») résonnent comme un langage de Martien. Et beaucoup redécouvrent les vertus de la discipline, l’exemplarité des sanctions.
Au sommet aussi, le ton change. Jack Lang, lors d’un récent colloque consacré à la violence scolaire (4), affirme l’urgence d’entreprendre « la reconstruction de l’autorité de l’institution scolaire et de ceux qui y travaillent ». Contre l’égalitarisme dominant, Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l’Enseignement professionnel, ne craint pas d’assurer que « sous le vocable de collège unique, on habille de vertus républicaines un système qui uniformise » (5). Demain, on entendra peut-être l’aveu que l’objectif de 80 % de bacheliers était irréaliste, et qu’il faut reconcevoir les filières d’accès à l’Université, une Université où la sélection par l’échec a remplacé la sélection par le mérite.
Il n’est pas jusqu’au relativisme de l’enseignement qui ne suscite des doutes. Là où leurs aînés s’attachaient à brader la « culture bourgeoise », des instituteurs remarquent que, pour une dictée, Victor Hugo vaut mieux qu’une notice de machine à laver, et les plus laïques des professeurs d’histoire ou de français s’aperçoivent qu’ils ne peuvent expliquer le Moyen Age, Racine ou Chateaubriand si leur classe n’a jamais entendu parler du christianisme. L’école doit donner des repères, assure aujourd’hui Philippe Meirieu, figure historique du pédagogisme : « Les parents et les enseignants de la génération 68 ont eu trop tendance à penser qu’on ne pouvait rien imposer aux enfants » (6).
Dans le domaine de la sécurité, la mutation est également sensible. Face à l’explosion de la délinquance, la gauche range aux accessoires ses invectives contre les « fantasmes sécuritaires » : elle semble avoir compris – poussée, il est vrai, par sa base populaire – que ne pas se faire cambrioler ou qu’emprunter le train sans se faire agresser fait partie des droits du citoyen. A Villepinte, en 1997, Lionel Jospin définissait la sécurité comme une priorité. Quatre ans plus tard, Daniel Vaillant, le ministre de l’Intérieur, remet en cause le « tout-prévention », et Julien Dray, député socialiste, reconnaît que l’expression « tolérance zéro » a un sens. Quant à Jean-Pierre Chevènement, nul n’a oublié sa sortie sur les « sauvageons ». A cet égard, il faut aussi noter le virage de SOS-Racisme, son président Malek Boutih n’hésitant pas à affirmer que les difficultés de l’intégration ne sont pas à mettre systématiquement sur le dos des Français, les immigrés ayant également des devoirs, notamment celui de respecter les lois de la société qui les accueille.
Il faut surtout souligner le cas du ministre des Affaires étrangères. Il y a peu, Hubert Védrine publiait un extraordinaire article (7) dans lequel il invoquait la légitimité de la raison d’Etat en matière de relations internationales. Il y affirmait notamment que la démocratie occidentale n’est pas partout exportable ! Un tel plaidoyer en faveur de la Realpolitik prenait le contre-pied de la morale humanitaire et de la diplomatie des droits de l’homme, parcours obligé de la génération formée dans le tiers-mondisme.
Déjà, contre l’idéologie de la table rase, Régis Debray avait retrouvé la valeur de la nation comme médiation vers l’universel, rappelant qu’« un citoyen a besoin de frontières ». Alain Finkielkraut, de son côté, a dénoncé « l’ingratitude contemporaine », la négation de toute dette à l’égard du passé. Si, à gauche, il se murmure que la France est aussi une communauté de destin, ce sera encore une barricade de tombée.
Jean Sévillia
(1) Sondage Sofres, mars 2001.
(2)Libération, 23 février 2001.
(3) La Tyrannie du plaisir, Seuil, 1998.
(4) A l’Unesco, le 5 mars 2001.
(5) Le Figaro, 9 mars 2001.
(6) Le Figaro Magazine, 16 septembre 2000.
(7) Le Monde diplomatique, décembre 2000.