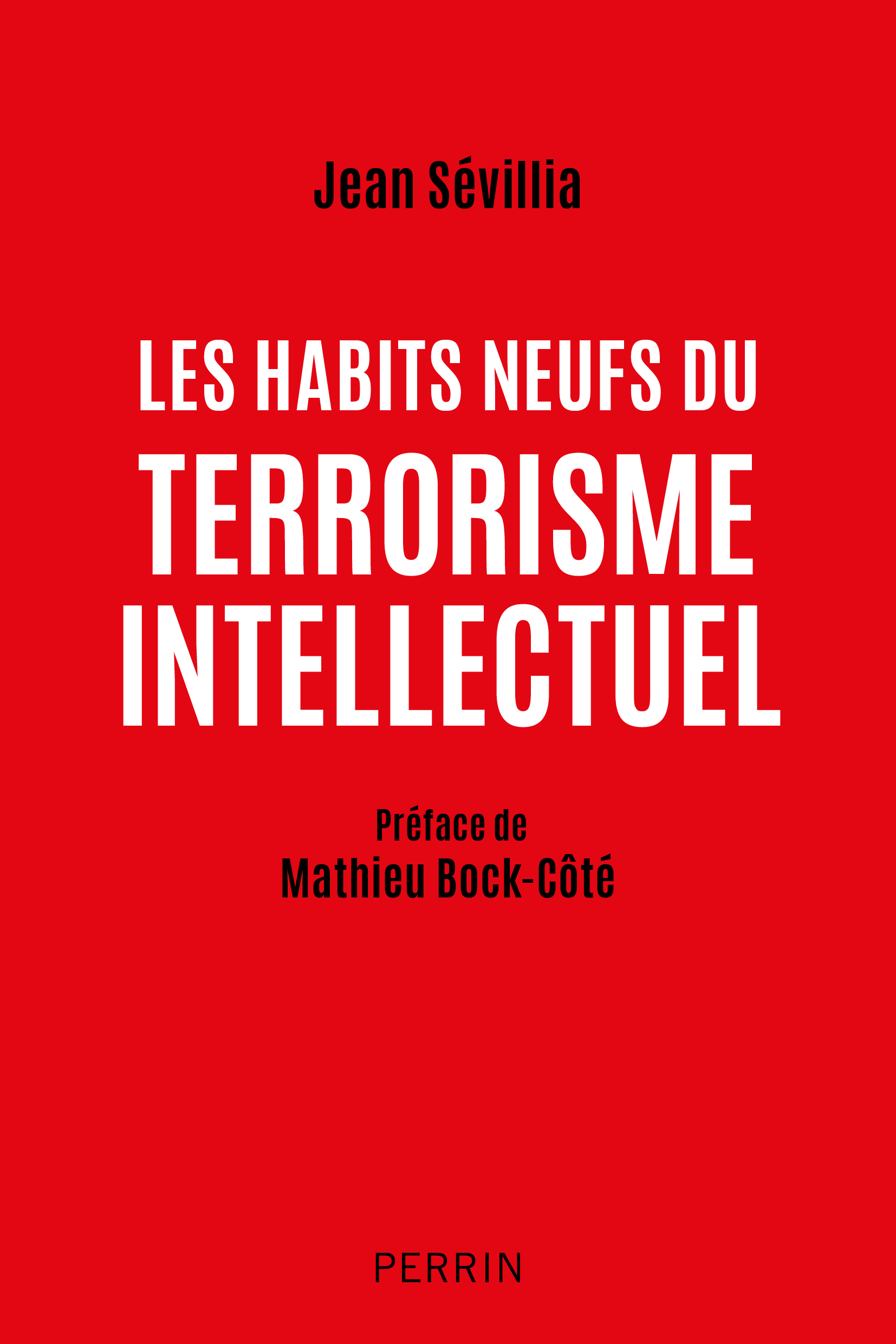L’attitude de Camus vis-à-vis du terrorisme se résume à la formule qu’employait son père devant la cruauté des combattants : « Un homme, ça s’empêche. »
Etudes sur l’homme et l’œuvre, rééditions de ses grands textes : le centenaire de la naissance d’Albert Camus, né le 7 novembre 1913, est marqué par de multiples parutions. Camus et le terrorisme, un essai de l’historien Jean Monneret, spécialiste de la guerre d’Algérie, rappelle que Camus est un des rares écrivains français qui ait poursuivi une réflexion globale sur le terrorisme, sous l’angle politique comme sous l’angle philosophique. En témoigne les Justes (1949), pièce qui met en scène, d’après un fait survenu dans les années 1900, le dilemme de révolutionnaires russes renonçant à commettre un attentat contre le grand-duc Serge parce que deux enfants l’accompagnent dans sa calèche. Ou encore l’Homme révolté (1951), essai où, analysant la perversion de la révolte, Camus montre qu’à travers Sade, Saint-Just, Hegel, le nihilisme et le totalitarisme contemporains, court une lignée qui justifie l’emploi de n’importe quel moyen pour atteindre ses fins, légitimant le mépris du droit et de la morale.
« Camus, observe Jean Monneret, se garda toujours de la moindre complaisance envers la terreur, qu’elle fût d’Etat ou révolutionnaire. Il évita, de même, toute compromission avec ses méthodes et ses hommes ».
Dans la pratique, c’est la guerre d’Algérie qui a confronté l’écrivain au terrorisme. Le 10 décembre 1957, Camus se trouve à Stockholm afin d’y recevoir le prix Nobel de littérature. Deux jours plus tard, dans le grand amphithéâtre de l’université de la ville, il répond, selon la tradition, aux questions d’un parterre d’étudiants. L’échange porte vite sur la politique plus que sur la littérature. Saïd Kessal, un étudiant algérien, apostrophe alors l’écrivain, lui reprochant son silence à propos de la « répression coloniale » exercée par la France en Algérie. Le correspondant du Monde, présent sur place, note que le contradicteur de Camus lui faisant une nouvelle fois grief de ne pas soutenir « la lutte des Algériens pour la justice », l’auteur de l’Etranger répond par une formule restée célèbre : « Je crois à la justice, mais je préfère ma mère à la justice ». Jean Monneret souligne toutefois que la phrase a été déformée, car le propos exact de l’écrivain était le suivant : « A l’heure où nous parlons, on jette des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans l’un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ». Le sens n’est pas le même, et cette version pose le problème dans sa dimension concrète, en lui donnant un visage.
Né à Mondovi, dans le Constantinois, Camus passe son enfance et son adolescence à Alger, dans le quartier populaire de Belcourt. Son père étant mort en 1914 (d’une blessure de guerre), le jeune Albert vit dans le dénuement matériel, en compagnie d’une mère illettrée qui est femme de ménage et avec laquelle il peine à communiquer, mais qui restera pour lui un personnage central. Brillant élève, boursier au lycée d’Alger, il s’oriente après son bac vers la philosophie, mais une tuberculose le contraint à renoncer à l’Ecole normale supérieure et à l’agrégation. Il sera donc homme de théâtre et journaliste.
Professant des idées de gauche, aspirant à la justice sociale, le jeune Camus adhère au Parti communiste en 1935. Mais en 1936, dans le double contexte du pacte franco-soviétique signé par Laval, l’année précédente, en vue de faire pièce à l’Allemagne hitlérienne, et du Front populaire qui gouverne à Paris, le Parti communiste algérien (PCA), antenne du PCF, appliquant une consigne de Staline, donne priorité à l’antifascisme au détriment de la cause de l’émancipation des musulmans. Un choix tactique qui conduit le PCA à s’opposer aux nationalistes algériens regroupés autour de Messali Hadj, animateur de l’Etoile nord-africaine puis du Parti du peuple algérien (PPA), formation dont les militants, désormais considérés comme des adversaires, sont combattus par les communistes avec des méthodes toutes staliniennes, allant jusqu’aux dénonciations à la police. Camus, lié à des Arabes qui sont engagés derrière Messali Hadj mais qui ne renient pas l’héritage français, critique la nouvelle ligne du PCA : dès 1937, cette indépendance d’esprit lui vaut d’être exclu pour « déviationnisme ». L’expérience servira de leçon à l’écrivain qui restera e gauche mais, contrairement à Jean-Paul Sartre, ne sera jamais un « compagnon de route » du communisme.
Débarqué en métropole en 1940, installé définitivement à Paris en 1943, Camus poursuit l’écriture de son œuvre, entamée avant-guerre, tout en étant lecteur chez Gallimard et rédacteur en chef (1944) de Combat, quotidien clandestin de la Résistance.
En Algérie, le FLN, organisation indépendantiste inconnue, déclenche l’insurrection à la Toussaint 1954. Ce que les observateurs pensaient être un feu de paille s’étend, en 1955, amenant le gouvernement à proclamer l’état d’urgence et à intensifier la répression. Camus publie dans l’Express, d’octobre 1955 à janvier 1956, une série d’articles qui seront réunis sous le titre de « l’Algérie déchirée ».
Ce n’est pas seulement son pays natal, qui est déchiré, c’est l’écrivain lui-même. Camus, en effet, approuve l’aspiration des Arabes à l’égalité, déplorant l’attitude méprisante de certains Français d’Algérie à l’égard des indigènes (le mot est d’époque) et une répartition agraire injuste. Récusant toutefois le concept de nation algérienne – l’Algérie n’ayant jamais possédé d’organisation étatique avant la colonisation et sa population étant issue de vagues d’immigration successives -, l’écrivain croit aussi à la légitimité française en Algérie, et prône des réformes sociales et politiques visant à intégrer davantage les Musulmans dans la République.
« J’ai aimé avec passion cette terre où je suis né, écrit-il en 1956 dans un « Appel pour une trêve civile » qui sera repris dans ses Chroniques algériennes. J’y ai puisé tout ce que je suis, et je n’ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu’ils soient ». Mais ce texte reste sans effet, et lui vaut l’hostilité des Français d’Algérie qui refusent toute évolution, comme des partisans de l’indépendance. L’épisode de Stockholm, en 1957, prend donc place dans une longue période où Camus, sachant que les passions l’empêchent d’être écouté, reste silencieux. Au même moment, le FLN recourt systématiquement au terrorisme, notamment urbain, mais l’armée gagne la bataille d’Alger, contre les poseurs de bombes, au prix de méthodes qui, en métropole, accroissent les campagnes des intellectuels de gauche contre cette guerre et, en Algérie, creusent le fossé entre les communautés.
En 1958, l’écrivain invite le gouvernement à s’adresser au peuple arabe d’Algérie pour lui annoncer à la fois que « l’ère du colonialisme est terminée » et que la France « refuse d’obéir à la violence » et qu’elle « refuse de servir le rêve de l’empire arabe à ses propres dépens, aux dépens du peuple européen d’Algérie, et, finalement, aux dépens de la paix du monde ».
Mort le 4 janvier 1960, dans un accident de voiture, Camus a eu le temps d’approuver le principe d’autodétermination de l’Algérie, proclamé par le général de Gaulle en septembre 1959, mais n’a pas vu la suite des événements, dont on devine qu’ils l’auraient crucifié : le bain de sang, la rupture entre la France et l’Algérie, une terre natale à laquelle l’attachait un lien qui éclate dans le Premier homme, son roman posthume (1994).
Camus condamnait la violence terroriste parce que celle-ci est toujours inhumaine, et de plus inefficace, déclenchant un cycle provocation-répression qui perpétue la logique de la violence, faisant obstacle à la fondation d’une société juste, alors que la justice est toujours la revendication initiale de ceux qui choisissent la voie terroriste. Lorsqu’un groupe de ce type prend le pouvoir, avertit Camus, il institue un Etat qui a le terrorisme dans les gènes, et qui règne par conséquent par la peur et le meurtre.
Dépassant les événements de son époque, l’écrivain délivrait une leçon permanente. À l’heure où plane la menace terroriste, « la mesure grecque et la pensée de Midi chères à Albert Camus », conclut Jean Monneret, conservent toute leur vertu.
Jean Sévillia
Jean Monneret, Camus et le terrorisme, Michalon, 190 pages, 16 €.