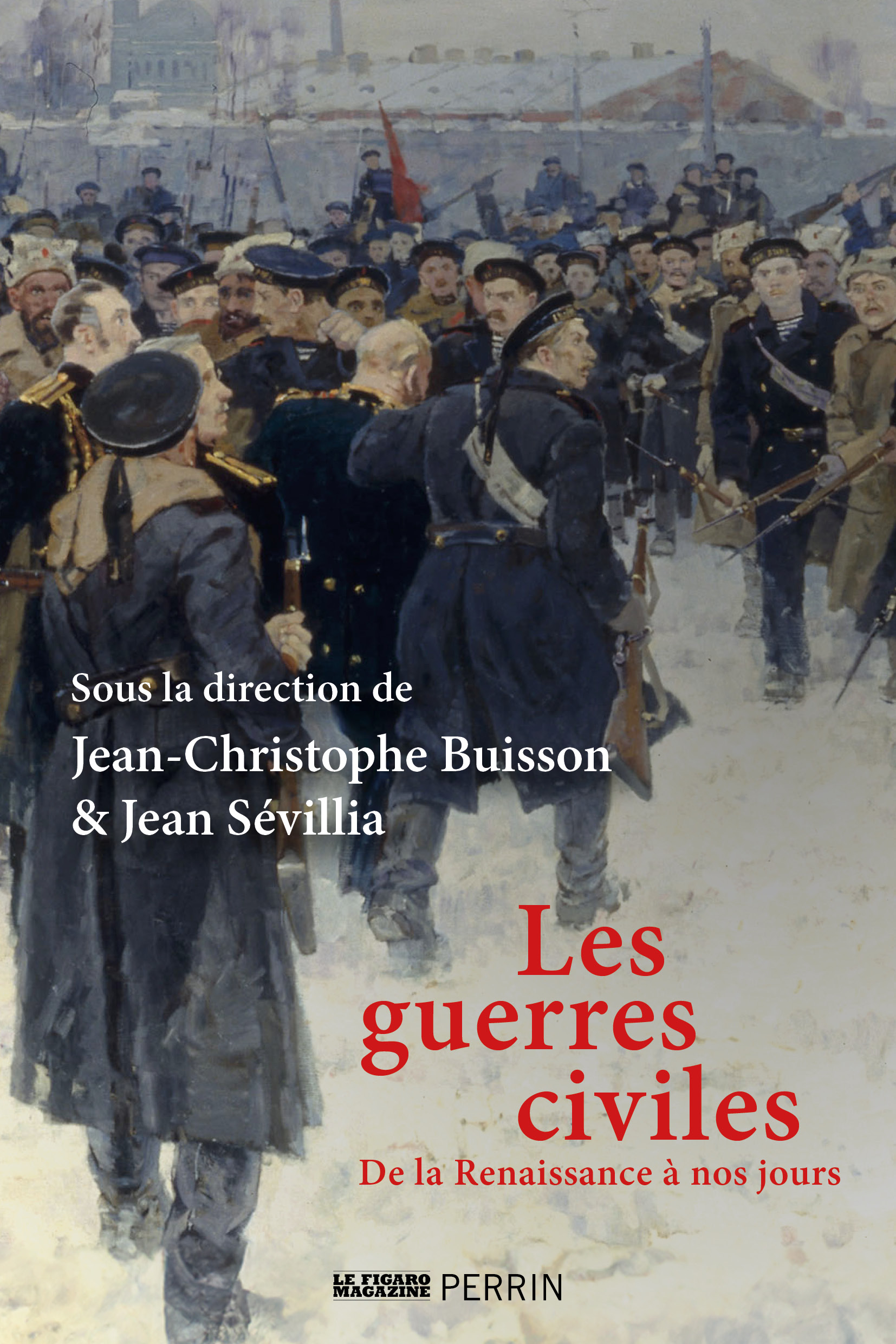Mis en ligne sur le site du Figaro le 23 avril 2025, et publié dans le Figaro Magazine du 25 avril 2025
Par ses origines extra-européennes, son tempérament, son mode de gouvernement, sa détermination à réformer l’Église catholique quitte à brusquer ses ouailles, François s’est distingué de ses deux prédécesseurs. Que restera-t-il de ses douze années de pontificat ?
Elu à la tête de l’Eglise catholique le 13 mars 2013, le cardinal Jorge Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, avait voulu, en prenant le nom de François, placer son pontificat sous le signe de François d’Assise, ami de la nature et des pauvres. Ce patronage traduisait une inclination héritée de son expérience en Argentine, pays instable où, prélat peu conformiste, il s’était fait remarquer pour son action sociale et sa faveur envers les plus démunis. D’emblée, en refusant d’ajouter un numéro à son nom de pape (il aurait pu s’appeler François Ier), en choisissant d’habiter au Vatican la modeste maison Sainte-Marthe au lieu des appartements pontificaux et en simplifiant au maximum le protocole qui l’entourait, François avait manifesté sa volonté de dépouiller la fonction pontificale de sa pompe historique. A tous ses titres solennels, il préférera celui d’évêque de Rome, choix confirmé par sa demande d’être inhumé non dans la basilique Saint-Pierre, avec les autres papes, mais à Sainte-Marie Majeure, « ce très ancien sanctuaire marial où je me rendais pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique », a-t-il rappelé dans son testament rendu public quelques heures après sa mort.
Très vite après son élection, François avait exprimé son intention de réformer l’Eglise et de proposer la foi chrétienne aux gens là où ils sont et comme ils sont, jusqu’aux « périphéries ». Pour mieux l’opposer à son prédécesseur Benoît XVI, devenu pape émérite, les médias l’avaient aussitôt catalogué de « révolutionnaire ». Le mot était juste au sens où le nouveau pape allait soumettre le catholicisme à de profondes secousses, mais ne le définissait pas complètement car, anticonservateur, il n’était pas non plus un progressiste du type des années 1970. A bien des égards, cet homme dont la journée de travail commençait immuablement par une heure de prière silencieuse et qui craignait le diable et invoquait la Vierge Marie et tous les saints montrait une piété digne d’un curé de campagne : rien d’un guérillero latino-américain.
Sa spiritualité, François la puisait chez sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, la petite carmélite de Lisieux, pour laquelle il cultivait une grande dévotion. Une conception de la religion fondée sur la miséricorde divine, Dieu n’étant pas perçu comme un Dieu sévère et vengeur mais comme un Dieu aimant les hommes, et prêt à tout leur pardonner. La plupart des encycliques et exhortations apostoliques de François – Lumen fidei (« La lumière de la foi », 2013), Evangelii gaudium (« La joie de l’Évangile », 2013), Fratelli tutti (« Tous frères », 2020) – viseront d’ailleurs à traduire l’amour inconditionnel de Dieu pour tout homme, quel que soit son état de vie, y compris pour les non-croyants.
En 2015, l’encyclique Laudato Si’ (titre tiré d’un cantique de François d’Assise, Laudato si’, mi’ Signore, « Loué sois-tu, mon Seigneur ») devait rencontrer un formidable écho puisque François, allant au-devant des inquiétudes générales pour la planète, y dénonçait les « silences complices » face aux dégâts sur l’environnement. Les commentateurs à la mode, toutefois, avaient moins relevé que le pape y liait l’idée de protection de la nature et l’exigence de protection de la vie humaine, de la conception à son terme naturel. Continuateur, dans ce domaine, de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, François ne devait cesser de répéter l’opposition de l’Eglise catholique à l’avortement et à l’euthanasie, exprimant le vœu, en visite en Belgique en 2024, de béatifier le roi Baudoin qui avait abdiqué temporairement, en 1990, afin de ne pas signer la loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse. La dénonciation par le pape défunt de la « culture du déchet », c’est-à-dire l’indifférence à la pauvreté, le rejet de l’enfant à naître et l’abandon des malades en fin de vie, rappelait les grands textes dans lesquels Jean-Paul II alertait contre le capitalisme sauvage, le matérialisme mercantile du consumérisme moderne. Continuité, là encore, dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église, combat lancé sous le pontificat de Jean-Paul II par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Un domaine où beaucoup reste à faire, mais où les mesures sont en place pour sanctionner et limiter au maximum les déviances qui ont fait tant de mal aux victimes d’abord et à l’Eglise ensuite.
La simplicité de François, son style naturel, son côté spontané lui auront valu une grande popularité, bien au-delà des milieux catholiques. Au sein de l’Eglise, le bilan est plus nuancé car ce personnage clivant aura parfois échoué dans les objectifs qu’il s’était fixé, et sa politique aura parfois exacerbé certaines fractures, d’autant que cet homme d’ouverture était en réalité autoritaire et guère disposé à accepter la contradiction. A rebours de Jean-Paul II et Benoît XVI qui avaient nommé des cardinaux qui n’étaient pas de leur tendance, le pape argentin aura d’ailleurs cherché à unifier le collège cardinalice autour de sa ligne, ce qui ne signifie pas automatiquement que son successeur lui ressemblera.
Saint François d’Assise, le Poverello sous le signe de qui François s’était placé, avait vu Dieu, en songe, lui donner la mission de « guérir son Eglise ». A son exemple, le pape aura voulu changer le visage de l’Eglise afin de la purger des fautes et des mauvais comportements qui l’affectaient. Réformer la Curie était une tâche que Benoît XVI n’aura pas eu la force de mener à bien. François sera au moins parvenu à rétablir la confiance dans la banque du Vatican, jadis grevée par des scandales et des opérations financières désastreuses, mais les finances du Saint-Siège sont toujours dans le rouge. Pour ce qui est de la réforme de structure de la Curie, la nouvelle constitution apostolique de 2022, qui aspirait à mettre fin à la centralisation romaine, a eu pour effet de reléguer au second plan la congrégation pour la Doctrine de la foi, instance traditionnellement chargée de veiller sur la transmission du dogme, au profit du dicastère pour l’Evangélisation, marquant la priorité de François, plus pasteur que théologien, pour la mission de l’Église plutôt que pour l’orthodoxie doctrinale. Toute une partie du clergé, nourrie par l’idée que les deux étaient indissociables, en a été perturbée, d’autant que les fréquentes sorties du pape contre « le cléricalisme », justifiées à propos d’une minorité, frappait indistinctement tous les évêques et les prêtres, ce qui a été reçu comme une injustice.
Dans sa volonté de faire bouger l’Eglise, François avait annoncé des projets de réforme dont on ne savait pas toujours s’ils avaient été conçus par lui et s’ils lui avaient été soufflés par son entourage, souvent plus radical que lui. En bon jésuite, ordre dans lequel il était entré en 1958, il lançait des ballons d’essai pour juger des réactions provoquées par ses propos, et parfois faisait machine arrière. Ainsi lors du synode sur l’Amazonie (2019), avec la perspective d’ordonner prêtres des hommes mariés, projet finalement mis entre parenthèses, ou à propos de la perspective d’ouvrir le diaconat aux femmes, idée finalement écartée en 2024. Ces hésitations ou ces refus, calculés ou non, ont semé le trouble dans une bonne partie de l’Eglise qui attend du pape qu’il fixe le cap sans faiblir et chasse le doute contre le relativisme contemporain, comme le firent Jean-Paul II et Benoît XVI. Un trouble aggravé par le synode sur la gouvernance de l’Église (2023-2024), le concept de « synodalité » étant un objet non identifié qui contredit la tradition de l’Eglise romaine.
Le style de François, à coté de ses aspects positifs, a ainsi ravivé, malheureusement, des crispations et des clivages qui s’étaient estompés entre progressistes, qui veulent toujours plus de changement, et conservateurs, qui freinent des quatre fers devant la moindre innovation. Le phénomène a été tangible avec les questions de morale sexuelle entre les générations formées par l’enseignement de Jean-Paul II – dont la théologie du corps interprétait la sexualité sous l’angle d’une anthropologie considérant la sexualité comme une réalité ordonnée au plan de Dieu sur les hommes – et une conception de la morale posant en principe l’acceptation de la société telle qu’elle est. Loin d’avoir apaisé le débat sur le sujet sensible de l’accueil dans l’Eglise des personnes homosexuelles, la déclaration Fiducia supplicans de 2023, texte non signé par le pape mais validé par lui, a ouvert la possibilité de bénir les couples de même sexe, ce qui a partout suscité des réserves, mais surtout provoqué une levée de boucliers en Afrique, créant une profonde division dans l’Eglise universelle autour de cette question.
Rupture encore avec les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI dans le domaine liturgique, avec l’incompréhension totale de François envers la pratique de l’ancienne messe en latin, ce qui donnera le feu vert à certains évêques zélés pour lancer une véritable persécution envers les traditionalistes pourtant fidèles à Rome, rouvrant une guerre que Ratzinger-Benoît XVI avait pacifiée.
Rupture enfin avec l’esprit de Jean-Paul II, pape marqué par les tragédies du XXe siècle (guerres mondiales et totalitarismes) et son appel à la nouvelle évangélisation de l’Europe, et avec l’inscription assumée de Benoît XVI dans un héritage civilisationnel occidental. Venu d’Amérique latine, François aura refusé de privilégier l’Europe, deuxième berceau historique du christianisme, préférant visiter des pays lointains et ne craignant pas d’encourager la migration comme un mécanisme naturel, de sa première visite pastorale à Lampedusa (2013) où il dénonça « une mondialisation de l’indifférence » à sa visite à Marseille (2023) dont il vanta « le modèle d’intégration ». Le pape aura de même refusé de s’interroger sur les problèmes posés par l’introduction massive de l’islam sur le Vieux Continent,», déroutant de nombreux catholiques inquiets pour l’avenir de leurs nations et de leurs enfants.
Personnalité complexe, parfois difficile à saisir, souvent aussi aux accents attachants, François aura néanmoins été le 266e pape, concentrant sur lui, par l’adhésion ou au contraire la réserve, l’attention d’1,4 milliard de catholiques à travers le monde, et manifestant par-là, en dépit de tout, l’étonnante permanence de l’Eglise catholique, institution fondée il y a vingt siècles. Il y a eu une et même deux générations Jean-Paul II, et une génération Benoît XVI. En France, on a récemment signalé, à l’occasion des fêtes de Pâques, l’afflux de jeunes adultes demandant le baptême, dont une grande part était issue de familles non chrétiennes. Ce sont eux, dans dix ans, qui diront ce qu’ils doivent à François, ce pape pas comme les autres.
Jean Sévillia