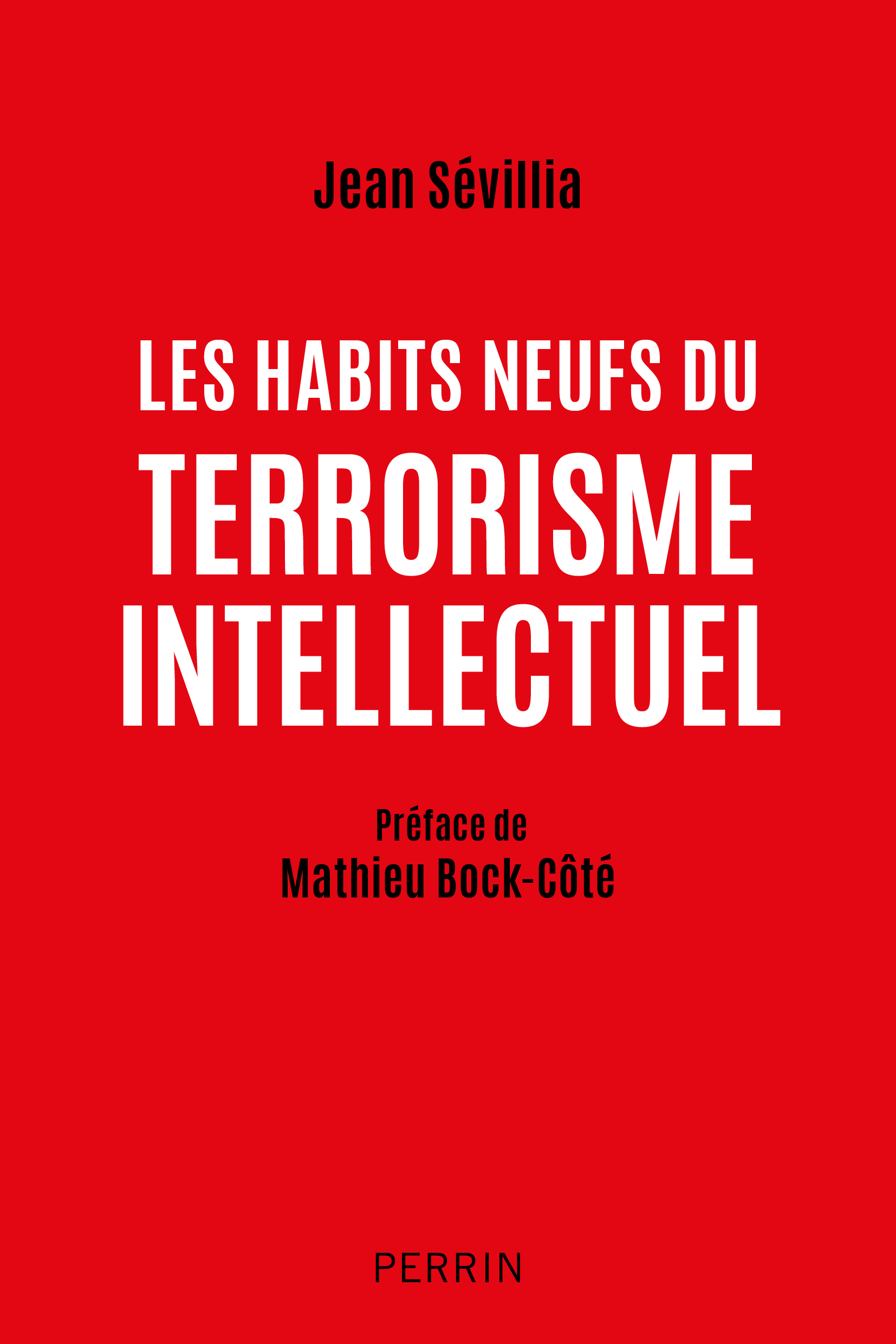Le Figaro Histoire, numéro 51, août-septembre 2020
La mémoire justement douloureuse de la traite transatlantique fait paradoxalement oublier qu’elle ne fut qu’une partie de l’histoire. D’autres traites, occultées, impliquèrent Noirs et Arabes musulmans.
La mort de George Floyd, un Américain noir, le 25 mai 2020, à Minneapolis, dans le Minnesota, lors d’une intervention policière effectuée par un agent blanc, a suscité une émotion qui a secoué les deux côtés de l’Atlantique. Entre manifestations et dégradations de statues, de Christophe Colomb au négociant britannique Edward Colston et du président des Etats confédérés, Jefferson Davis, au roi des Belges Léopold II, les problèmes américains et ceux des pays européens ont été mélangés dans un amalgame des époques, des continents, des situations, pour aboutir à une interprétation des relations sociales focalisée sur la question de l’esclavage et l’irréductible discrimination qui existerait entre Noirs et Blancs, en Occident, depuis l’époque de la traite négrière. Cette séquence a été attisée, en Amérique, par le mouvement Black Lives Matter – formule qu’on peut traduire par « les vies noires comptent » – et, en France, par le courant indigéniste, nébuleuse d’extrême gauche qui a pris le visage, ces dernières semaines, d’Assa Traoré, sœur d’Adama Traoré, un délinquant décédé à la suite de son interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise, en 2016.
La figure historique de Jean-Baptiste Colbert a fait une fois de plus les frais de cette campagne, puisque sa statue du Palais-Bourbon a été aspergée de peinture pendant que le socle était recouvert d’un graffiti : « Négrophobie d’Etat ». Reprenant la revendication – récurrente depuis une quinzaine d’années – de rebaptiser tous les lieux publics portant le nom de Colbert, le socialiste Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, demandait que la salle Colbert de l’Assemblée nationale reçoive un autre nom. Aux yeux de certains, le grand ministre de Louis XIV, serviteur de l’Etat et maître de la vie économique française de 1665 à 1683, n’est donc plus que l’auteur du Code noir qui réglementait, au Grand Siècle, le statut des esclaves.
Historien du droit, maître de conférences à l’université des Antilles Guadeloupe et membre du conseil scientifique du Mémorial ACTe, organisme installé en Guadeloupe et consacré à la mémoire des victimes de la traite et de l’esclavage, Jean-François Niort a publié, il y a cinq ans, Le Code noir. Idées reçues sur un texte symbolique (Le Cavalier bleu, 2015). Son but était notamment de déconstruire la vulgate installée par le philosophe Louis Sala-Molins qui, dans Le Code noir, ou le calvaire de Canaan (PUF, 1987), avait qualifié le Code noir de « texte juridique le plus monstrueux qu’aient produit les temps modernes », notamment parce que l’ordonnance de Colbert aurait nié l’humanité de l’esclave, réduit à l’état de chose. Or sans méconnaître la dureté de la condition servile, Jean-François Niort avait découvert, en allant aux sources, que la question était beaucoup plus complexe, et soulignait qu’on ne pouvait parler du Code noir sans l’avoir lu, évidemment, mais surtout sans connaître les différentes étapes de son élaboration. Cette seule volonté de dénoncer les « idées reçues » et de replacer le Code noir dans son contexte avait provoqué une campagne violemment hostile, qui avait valu à l’universitaire d’être traité de « colonialiste » et de « négationniste », et même de recevoir des menaces l’intimant de quitter la Guadeloupe, où il vivait alors depuis dix-huit ans.
L’affaire rappelait la mésaventure survenue dix ans plus tôt à Olivier Pétré-Grenouilleau. Professeur à l’université de Bretagne-Sud, cet historien de l’esclavage venait de publier Les traites négrières (Gallimard, 2004), un ouvrage dans lequel il exposait les trois types de traite des Noirs ayant existé dans l’histoire : la traite transatlantique effectuée par les Occidentaux, la traite terrestre interafricaine et la traite maritime orientale vers les pays d’islam. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche (12 juin 2005), le chercheur avait en outre refusé d‘assimiler la traite des Noirs à un génocide. La condition des esclaves était terrible, expliquait-il, mais leurs maîtres ne cherchaient pas à les tuer, ce qui n’aurait pas été conforme à leur intérêt. Le propos, simple rappel historique, avait valu à son auteur d’être accusé de contestation de crime contre l’humanité, en vertu de la loi Taubira de 2001 qui définit comme tels « la traite des Noirs et l’esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, perpétrés en Amérique et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe, à partir du XVe siècle ». Dans le monde des historiens, la plainte déposée contre Olivier Pétré-Grenouilleau, mais finalement retirée, fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Une pétition circula, bientôt signée par plusieurs centaines d’enseignants et de chercheurs : Liberté pour l’histoire ! Le texte réclamait l’abrogation ou la modification des lois mémorielles, notamment la loi Taubira. Cependant Jacques Chirac, alors président de la République, afin de prouver qu’il était à l’écoute de ceux qui dénoncent une injustice à réparer en faveur des citoyens de couleur, n’en avait pas moins créé, en 2006, une « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition », fixée chaque année au 10 mai.
Le Code noir sans légendes
Résiduel au Moyen Age, où lui avait été progressivement substitué, dès le VIIe siècle, le servage qui reconnaissait la qualité de personne humaine des serfs (le roi Louis X l’interdit lui-même en 1315 en France), l’esclavage ne subsista en Europe que de manière exceptionnelle, notamment à Gênes et en Espagne. IL réapparaît massivement en Méditerranée, au XVIe siècle, quand les pirates turcs d’Alger – les Barbaresques – réduisent en esclavage les chrétiens qu’ils capturent, tout en s’efforçant de les revendre aux ordres religieux spécialisés dans ce rachat. On comptera en permanence de 25 000 à 30 000 prisonniers chrétiens au sud de la Méditerranée. Entre 1530 et 1780, près de 1 250 000 Européens, chrétiens et blancs, se verront ainsi asservis par les musulmans.
À la même époque, cependant, l’esclavage s’impose dans le Nouveau Monde, dans les colonies européennes. La reine Isabelle la catholique a interdit d’emblée à Christophe Colomb de réduire en esclavage les Indiens, mais en 1503, le gouverneur espagnol de Saint-Domingue (l’actuelle Haïti) obtient d’établir outre-Atlantique des esclaves africains. En 1518, Charles Quint autorise l’implantation de travailleurs serviles africains dans ses possessions d’outre-mer. Les Noirs, dans les îles, sont en effet considérés comme aptes à affronter le climat tropical, et à effectuer un labeur auquel les Indiens ne résistent pas.
Les Portugais, qui autorisent de leur côté, depuis l’origine, leurs colons à réduire les Indiens en esclavage, se livrent également, dès leur arrivée au Brésil, à la traite des Noirs. Vers 1620, les Anglais introduisent l’esclavage en Virginie. A la même époque, les Hollandais font de même au Surinam (la Guyane hollandaise). Les Français, eux s’installent aux Antilles en 1635. Dès 1642, Louis XIII y autorise l’esclavage.
Sous Louis XIV, Colbert entreprend de codifier le droit français touchant à l’économie et aux affaires publiques, publiant ainsi des ordonnances sur la procédure civile, les eaux-et-forêts, la procédure criminelle, le commerce et la marine. Au sujet du travail dans les Antilles, le ministre se trouve devant une situation inédite puisque la pratique de l’esclavage y est courante, alors qu’elle est interdite en métropole. Esprit rationnel, Colbert veut donc légiférer sur le sujet. Pour ce faire, le droit étant toujours coutumier sous l’Ancien Régime, il commence par collecter les lois et règlements en vigueur à ce propos aux Antilles, ce dont il charge, en avril 1681, Charles de Courbon, le gouverneur général, et Jean-Baptiste Patoulet, l’intendant, qui doivent également recueillir les avis des conseils souverains de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe. Le ministre reçoit un premier rapport en mai 1682, puis un avant-projet d’ordonnance trois mois plus tard. Toutefois, malade, Colbert meurt en septembre 1683. L’ordonnance royale sur l’esclavage, signée par Louis XIV, ne sera donc promulguée qu’en mars 1685, contresignée par le secrétaire d’État à la Marine, Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, le fils du ministre.
Composé de soixante articles, cet édit « touchant la discipline des esclaves nègres des îles de l’Amérique française » n’est pas un texte définitif, puisqu’il a évolué, et ne s’appelle pas Code noir, cette expression désignant en réalité un ensemble de textes législatifs rassemblés sous ce titre en 1718, après la mort de Louis XIV. Sous réserve de quelques variantes, ses dispositions seront étendues à Saint-Domingue, aux îles de France (Maurice) et Bourbon (La Réunion), à la Guyane et à la Louisiane. L’édit définit les obligations des employeurs vis-à-vis des esclaves et de leur famille : quantité et qualité de la nourriture, vêtements à procurer, respect du repos dominical, soins dus aux infirmes et aux vieux. Les maîtres sont autorisés à recourir au fouet, mais nulle mutilation ou torture ne leur est permise. Tout maître ou contremaître qui tue un esclave se rend coupable d’un crime dont il doit rendre compte devant la justice. En outre, les esclaves mal nourris ou maltraités ont le droit de se plaindre au procureur général. Clause théorique : les archives ne portent aucune trace qu’une telle procédure ait jamais été engagée. Les désertions sont punies de mort à la troisième récidive. Inversement, un maître peut affranchir un esclave, épouser une esclave qui est ipso facto affranchie, sachant que les affranchis bénéficient des mêmes droits que les personnes nées libres. Selon le Code noir, l’esclave doit être baptisé (son baptême lui est imposé) et se marier à l’église, mais son mariage dépend de l’accord de son maître, et les enfants nés de ces unions deviendront esclaves à leur tour. En réalité, le texte tente de concilier des principes contradictoires. En tant que chrétien, l’esclave est un homme. En tant qu’esclave, il est réduit à l’état d’objet, pouvant être négocié comme un bien meuble.
En principe, l’Eglise, à travers ses papes, condamne l’esclavage. A la fin du XVe siècle, le pape Pie II a essayé d’arrêter la traite inaugurée par les Portugais. L’esclavage a été condamné par Paul III, en 1537, et par Pie V, en 1568. En 1639, Urbain VIII flétrit cet « abominable commerce des hommes ». En 1741, Benoît XIV réprouve à son tour l’esclavage. Mais personne ne les écoute : l’appât du gain est le plus fort.
Philosophiquement, à plus forte raison vu d’aujourd’hui, ce Code noir qui légitime et légalise l’esclavage est indéfendable. Mais dans la pratique, dans le contexte d’une époque et d’une aire où le travail servile est institutionnalisé, il avait pour fonction, rappelle Jean-François Niort, de marquer la souveraineté de l’Etat : c’était à la loi, c’est-à-dire au roi, de s’interposer entre l’esclave et le maître, limitant le pouvoir arbitraire de ce dernier en lui imposant des règles. « Ce texte suscite aujourd’hui tant de réprobation qu’il est difficile de l’interpréter, observe l’historien Lucien Bély. Derrière une réalité barbare, il introduit néanmoins un cadre juridique qui vise à protéger cette population servile. Il ne faut pas chercher à comprendre, donc à justifier, une telle législation mais il faut la présenter et l’expliquer en tenant compte des préjugés du temps de Louis XIV » (Dictionnaire Louis XIV, Robert Laffont, « Bouquins », 2015).
En 1724, le Code noir durcit les normes de l’affranchissement. C’est que le système atteint son apogée : les colonies françaises des Antilles et, à l’autre bout du monde, l’île Bourbon (la Réunion) exportent des denrées que la métropole consomme de plus en plus, et vend à d’autres pays : café, indigo, coton et surtout le sucre, l’or blanc des Antilles et de Saint-Domingue. Saint-Domingue où la France réalise les trois quarts de son commerce colonial : la production en sucre de toutes les colonies européennes réunies n’atteint pas la moitié de celle de la grande île. Là-bas, de véritables usines fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et la courbe de l’esclavage suit la courbe de la production. A Saint-Domingue, en 1720, 7000 tonnes de sucre sont fournies par 47 000 esclaves ; en 1750, 48 000 tonnes sont produites par 200 000 esclaves. En 1739, sur 250 000 habitants des Antilles, 190 000 sont des esclaves. De nouveaux arrivages de main d’œuvre débarquent régulièrement d’Afrique.
A partir de 1715, la traite des Noirs constitue un élément essentiel du trafic transatlantique, le commerce triangulaire. Les navires négriers français partent de Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Le Havre avec une cargaison de troc. Parvenus sur les côtes d’Afrique, ils échangent cette marchandise contre des captifs noirs que leur remettent les chefs tribaux et qu’ils vont eux-mêmes vendre aux îles. De là, ils regagnent l’Europe avec un fret de produits tropicaux. Les Français sont loin d’être les seuls à s’adonner à ce trafic : au seul XVIIIe siècle, 6 millions de Noirs auraient été ainsi conduits par les Européens vers les Amériques, dont 1,1 million par les Français. Le total des Noirs transplantés sur l’autre bord de l’Atlantique, en trois siècles, est estimé de 12 à 13 millions de personnes. Des êtres humains troqués contre des produits de pacotille, transportés dans des conditions abominables (près de 10 % n’arrivent pas vivants), monnayés comme du bétail, et contraints à l’arrivée à des travaux littéralement épuisants. Cette page d’histoire, longtemps dissimulée, fait partie des secrets honteux de la vieille Europe. Pour autant, les Européens d’aujourd’hui n’en sont nullement responsables, sauf à considérer, d’une part, que tous les Blancs sont des descendants d’esclavagistes et tous les Noirs des descendants d’esclaves, ce qui n’est pas le cas (les ancêtres de ceux qui vivent en Afrique n’ayant, au contraire des Antillais ou des Noirs américains, jamais été vendus et certains d’entre eux ayant été au contraire impliqués dans la traite comme vendeurs), et d’autre part que le statut de bourreau, si tant est que les propriétaires d’esclaves aient tous été des bourreaux, est héréditaire, tout comme le statut de victime le serait aussi, ce qui n’est pas vrai non plus.
Vers l’abolition de l’esclavage
Une soixantaine d’années seront nécessaires, de 1790 à 1850, pour que l’esclavage disparaisse des colonies françaises. A l’Assemblée constituante, en 1790, les Amis des Noirs font campagne pour l’abolition de la traite. Ils se heurtent à l’opposition des défenseurs des colons de Saint-Domingue, au premier rang desquels se place Barnave (l’homme du « ce sang était-il donc si pur ? », à propos du massacre par les émeutiers de l’intendant général Foullon et de son gendre Bertier de Sauvigny, le 22 juillet 1789). Se faisant l’avocat des planteurs, celui-ci n’accepte pas que « le nègre puisse croire qu’il est l’égal du blanc ». En 1791, les esclaves de Saint-Domingue se révoltent sous la direction de Toussaint Louverture. Mais devant l’anarchie qui gagne, Anglais et Espagnols interviennent dans l’espoir de mettre la main sur les colonies françaises. Les Britanniques, notamment, occupent la Martinique et la Guadeloupe et débarquent des troupes dans la partie française de Saint-Domingue. En août 1793, afin de rallier les Noirs à la cause française, l’envoyé de la Convention dans l’île y décrète l’esclavage aboli, décision entérinée à Paris par le décret du 4 février 1794. Mais contrairement à la légende, ce n’est pas tant pour obéir à une exigence humanitaire que la Convention a voté l’abolition – au même moment, les colonnes infernales mettent la Vendée à feu et à sang – que pour riposter aux Anglais. Pendant ce temps, Toussaint Louverture, qui a battu les Espagnols et les Anglais, se proclame gouverneur général à vie.
La Guadeloupe, en 1794, n’a été que brièvement occupée par les Anglais. Saint-Domingue, au traité de Bâle (1795) est attribuée dans sa totalité à la France. Toussaint Louverture est capturé en 1802. La Martinique est restituée lors de la paix d’Amiens, en 1802. Or dans cette île, l’esclavage n’a jamais été aboli. Quand Bonaparte accède au pouvoir, il se prononce non pas pour l’abolition de l’esclavage, mais pour l’alignement sur la Martinique. Le 10 mai 1802, l’esclavage est donc rétabli dans toutes les colonies françaises.
En 1807, sous l’influence du parti abolitionniste, l’Angleterre interdit la traite des esclaves. Pour le gouvernement britannique, cette mesure exprime moins un souci philanthropique qu’elle ne constitue, juste retour des choses, un moyen de ruiner les colonies françaises. Au traité de Paris, le 30 mai 1814, la France de la Restauration retrouve les vestiges de son ancien empire colonial : les Antilles, la partie occidentale de Saint-Domingue, la Guyane, les comptoirs de l’Inde et du Sénégal, l’île Bourbon. Par ce traité, Louis XVIII promet de supprimer la traite dans un délai de trois à cinq ans. Le 20 mars 1815, Napoléon est de retour à Paris. Dès le 29 mars, désireux de s’attirer les bonnes grâces de l’Angleterre, l’Empereur déclare la traite illégale. Au congrès de Vienne, qui se clôt le 9 juin (les Cent-Jours prennent fin le 22 juin), toutes les puissances européennes décident également de réprimer le commerce des esclaves. En juillet 1815, retrouvant son trône, Louis XVIII confirme l’abolition de la traite. Lors du second traité de Paris, le 20 novembre 1815, le roi signe un article additionnel édictant les peines dont sont passibles ceux qui transgressent cette interdiction. Le 8 janvier 1817, une ordonnance royale aggrave les sanctions : les bâtiments seront confisqués, et leurs capitaines privés de tout commandement. Ces pénalités sont renouvelées par deux lois votées, l’une, le 15 avril 1818, sous Louis XVIII, et l’autre, le 4 mars 1831, sous le règne de Louis-Philippe.
Tarissant la source qui fournit les colonies en main d’œuvre servile, l’abolition de la traite constitue une étape indispensable. Le trafic illicite se poursuivra néanmoins jusqu’à ce que l’esclavage soit lui-même aboli, en 1833 par les Anglais, en 1848 par les Français. C’est sous la monarchie de Juillet que la France s’engage sur la voie de l’abolition. En 1832, la taxe frappant les affranchissements est supprimée. En 1833, la marque physique des esclaves est interdite. En 1839, ils reçoivent un état civil. En 1840, Louis-Philippe charge une commission extra-parlementaire d’étudier la condition des travailleurs coloniaux. Le duc de Broglie, qui en est le président, négocie avec l’Angleterre une nouvelle convention relative à la répression de la traite, comportant un droit de visite des navires. En 1843, dans un rapport au roi, la commission conclut à la nécessité d’émanciper les esclaves. La monarchie de Juillet tombe le 24 février 1848. Le 25 février, la République est proclamée. Le 4 mars, Victor Schoelcher devient membre du gouvernement provisoire. Sous-secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies, il préside la commission d’abolition de l’esclavage, qui travaille à partir des données réunies par l’administration du roi Louis-Philippe. Le 27 avril 1848, le ministre de la Marine et des Colonies, Arago, signe le décret d’abolition préparé par Schoelcher. 250 000 esclaves (dont 160 000 aux Antilles) sont concernés. Ils doivent être émancipés deux mois après la promulgation du décret dans chacune des colonies.
Le génocide oublié
Toute une partie de la bourgeoisie occidentale a fait fortune dans ce commerce triangulaire que nous jugeons à raison, aujourd’hui, monstrueux. Curieusement, cependant, c’est toujours la traite transatlantique qui fait l’objet de commémorations et donne matière à polémique. Les deux autres formes de traite – la traite interafricaine occidentale et la traite maritime orientale – suscitent rétrospectivement moins d’indignation. Un écrivain franco-sénégalais, Tidiane N’Diaye, anthropologue et économiste, a consacré à cette tragédie une enquête historique documentée : Le Génocide voilé (Gallimard, 2008). L’ouvrage étudie la traite des Noirs en direction des pays arabo-musulmans, phénomène antérieur à la traite transatlantique et dont les conséquences, au final, ont été plus lourdes.
Dès le VIIe siècle après. J.-C., les Arabes, qui ont conquis l’Egypte au cours de la première expansion islamique, lancent des expéditions visant à soumettre les peuples de Nubie, de Somalie, du Mozambique. En 652, pour obtenir la paix, le roi de Nubie Khalidurat signe avec l’émir arabe Abdallah ben Saïd un traité (bakht) par lequel il s’engage à livrer chaque année 360 esclaves des deux sexes. Prélevé sur les populations du Darfour, ce tribut est le point de départ d’une ponction humaine qui, pendant treize siècles, frappera le continent africain, de l’océan Atlantique à la mer Rouge. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, réduits en esclavage, seront ainsi conduits vers l’Egypte, la Perse, l’Arabie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc. Les prisonniers, capturés au cours de razzias, étaient regroupés en caravanes et dirigés soit vers l’intérieur des terres, soit vers la mer, entamant un long voyage pour être vendus. A l’ouest de l’Afrique, la route des esclaves traversait le Sahara pour déboucher vers la côte méditerranéenne. Dans le centre-est du continent, l’itinéraire passait à Khartoum, au Soudan, puis remontait le Nil. Sur la côte orientale, c’est le port de Zanzibar (dans l’actuelle Tanzanie) qui servait de marché aux esclaves à destination de la péninsule Arabique, de la Perse et de l’Inde. Ce système, souligne Tidiane N’Diaye, était lié aux jugements racistes qui s’exprimaient vis-à-vis des Noirs dans le monde arabo-musulman : le mot arabe abid, qui signifie esclave, était devenu, à partir du VIIIe siècle, plus ou moins synonyme de « Noir ».
Des peuples d’Afrique s’étaient spécialisés dans le commerce de leurs semblables, capturés au sein de territoires et de tribus ennemis. L’empire du Mali, aux XIVe et XVe siècles, pratique massivement l’esclavage. En Afrique occidentale, les royaumes d’Ashanti ou d’Abomey (actuels Ghana et Bénin) sont de véritables Etats négriers qui font affaire avec les Européens quand ceux-ci apparaissent sur les côtes africaines. En Afrique occidentale, au début du XIXe siècle, donc avant la colonisation européenne, l’expansion des peuples noirs islamisés ravage un espace compris entre le lac Tchad et l’océan Atlantique. A chaque fois, des tribus entières sont réduites à l’état servile, et vendues. Au nord, les esclavagistes de Libye, traversant le Sahara, effectuent des razzias en direction du sud, dépeuplant l’actuelle République centrafricaine. En Afrique orientale, du Mozambique à la Somalie, la côte est colonisée par le sultanat d’Oman. En 1840, cette principauté musulmane fait de Zanzibar sa capitale, créant des centres esclavagistes qui s’étendent jusqu’au fleuve Congo. C’est dans cette région, dans les années 1860, que Tippo-Tip, un marchand négrier de Zanzibar, se taille un royaume fondé sur la chasse aux esclaves, écumant des territoires correspondant à de nombreux Etats actuels : Somalie, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi, République démocratique du Congo, Zaïre, Malawi et Mozambique.
Lorsque les explorateurs européens pénètrent à l’intérieur du continent, ils découvrent l’ampleur des coutumes esclavagistes. Tel l’Anglais Livingstone, médecin et théologien, qui explore le Zambèze et le plateau des grands lacs entre 1850 et 1860, et dont la rencontre avec Stanley, sur les bords du lac Tanganyika, en 1871, est restée célèbre. Après la mort de Livingstone, en 1873, Stanley poursuit son œuvre au cours des années 1870-1880. Les récits de ces aventuriers dresseront l’opinion anglaise contre la traite pratiquée en Afrique, forçant le gouvernement britannique à intervenir au Soudan en 1885. A Paris, en 1888, c’est le cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger et fondateur des Pères blancs, qui, alerté par ses missionnaires, lance une campagne contre l’esclavagisme. En 1889-1890, une conférence internationale réunie à Bruxelles décide de réprimer la traite des esclaves en Afrique, continent où les Européens, au congrès de Berlin de 1884, se sont partagé les zones d’influence. Si paradoxal que cela paraisse de nos jours, un des buts des colonisateurs était d’éradiquer l’esclavage.
Tidiane N’Diaye observe qu’il est difficile, au regard de la rareté des sources, d’établir une comptabilité exacte des victimes de cette traite. S’appuyant sur les travaux de l’historien américain Ralph Austen, de l’université de Chicago, il retient les chiffres de 7,4 millions d’Africains déportés dans le cadre de la traite transsaharienne entre le VIIe et le début du XXe siècle. S’ajoutent 1,6 million de captifs morts au cours du voyage et 300 000 autres restés en bordure du désert ou dans les oasis, soit un total de 9,3 millions de prisonniers pour la voie saharienne. Dans les régions voisines de la mer Rouge et de l’océan Indien, 8 millions d’Africains auraient été transférés par la terre ou par bateaux. On aboutit ainsi au total de plus de 17 millions d’Africains victimes de la traite, sachant que, pour un déporté sain et sauf, trois ou quatre auraient péri.
Si 12 à 13 millions d’Africains ont été victimes de la traite transatlantique entre le XVe et le XIXe siècle, une diaspora de 70 millions de Noirs vit aujourd’hui aux Etats-Unis, dans les îles caraïbes et au Brésil. En revanche, dans les pays arabo-musulmans qui achetaient autrefois des esclaves, ces derniers n’ont pas de descendants. Entre la castration des hommes, pratiquée systématiquement et dont la mortalité était considérable, et les autres mauvais traitements, tout contribuait à ce massacre. C’est pourquoi Tidiane N’Diaye n’hésite pas à parler de génocide. Un génocide « voilé », selon lui, parce que, de nos jours, une sorte d’entente tacite entre Arabo-musulmans et Africains convertis à l’islam permet de passer sous silence la traite interafricaine et la traite orientale d’autrefois. Sans compter une réalité plus contemporaine : après la décolonisation, l’esclavage a réapparu en Mauritanie, au Nigeria ou au Soudan, attirant à plusieurs reprises, jusqu’à nos jours, l’attention des Nations unies. En Arabie saoudite, l’esclavage n’a été officiellement aboli qu’en 1962. Mais comme l’observait il y a peu l’historien Pierre Vermeren, spécialiste des pays musulmans, « la culpabilité n’étant pas un sentiment partagé en terre d’islam, où l’opinion considère que Dieu a voulu ce qui advient, la mémoire de cette longue traite assassine s’est volatilisée » (Le Figaro, 2 juillet 2020). Dès lors, sur fond d’anticolonialisme rétrospectif, descendants de victimes et descendants de bourreaux s’arrangent pour braquer les projecteurs sur la traite transatlantique, et par-là même accuser l’Occident.
A lire
Jean-François Niort, Le Code noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier bleu, 2015.
Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Gallimard, 2004.
Tidiane N’Diaye, Le Génocide voilé, rééd. Folio, 2017.