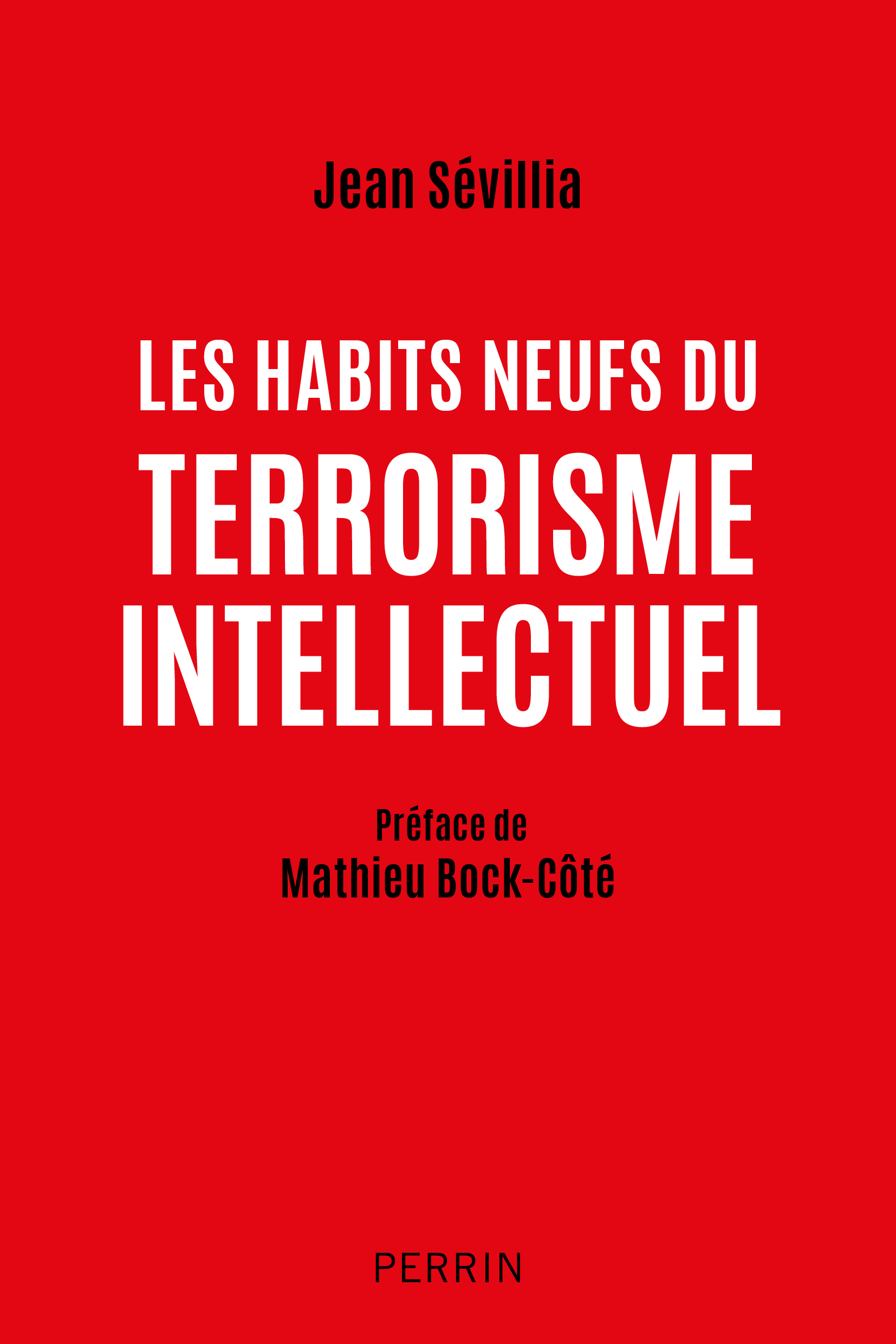Après vingt ans de présidence, Abdelaziz Bouteflika a été finalement victime du rejet du système qu’il incarne. Celui-là même qui régit l’Algérie depuis l’indépendance et qui a ruiné le pays.
Le 11 mars dernier, de retour en Algérie après deux semaines passées dans un hôpital de Genève, Abdelaziz Bouteflika a annoncé le retrait de sa candidature à l’élection présidentielle et le report du scrutin, initialement prévu le 18 avril 2019. Le 10 février, le chef d’Etat algérien avait notifié son intention de briguer un cinquième mandat, déclenchant une série de manifestations hebdomadaires qui allaient faire descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes. Agé de 82 ans, président fantôme n’ayant pas pris la parole en public depuis 2012, physiquement diminué – il a été victime d’un AVC en 2013 -, Bouteflika suscite un rejet que ses soutiens et ses proches, notamment son frère Saïd, qui l’assiste au plus près, n’avaient pas mesuré.
Mais renoncer à un cinquième mandat présidentiel sans fixer une nouvelle date pour l’élection revenait à prolonger indéfiniment le quatrième mandat entamé en 2014. La manœuvre n’a trompé personne, et les manifestations ont continué, réclamant un changement du système. Le 26 mars, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée algérienne, a demandé que soit engagée la procédure prévue par l’article 102 de la Constitution, qui permet de déclarer le président inapte « pour cause de maladie grave et durable ». Une semaine plus tard, Abdelaziz Bouteflika remettait sa démission.
La France s’en va
Entamées en 1960, poursuivies en 1961, les tractations entre le gouvernement français et les indépendantistes algériens avaient abouti, le 18 mars 1962, à la signature des accords d’Evian. Côté algérien, les négociations avaient été menées par les représentants du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), organisme mis en place en 1958 afin de servir de vitrine politique au Front de libération nationale (FLN) sur la scène internationale, mais qui avait toujours été le théâtre de luttes intestines. Président du GPRA depuis l’origine, Ferhat Abbas, suspect de modération, avait été déposé au cours de l’été 1961 et remplacé par Benyoucef Ben Khedda, un civil qui incarnait, au sein du GPRA, le clan des durs, partisans d’une rupture radicale entre l’Algérie et l’ancienne métropole.
Après la signature des accords d’Evian, la confusion régnait en Algérie. Alors que le cessez-le-feu du 19 mars n’avait pas mis fin au cycle de la violence – en témoignent les attentats du FLN et de l’OAS, les enlèvements d’Européens, leur départ précipité vers la métropole -, de grandes manœuvres se déroulaient en vue de la future organisation du territoire. Aux termes des accords d’Evian, les habitants de l’Algérie devaient décider par référendum s’ils choisissaient ou non l’indépendance. Mais le résultat ne faisait guère de doute : anticipant le résultat du référendum dans le sens de la rupture avec la France, les accords avaient eux-mêmes prévu dans un deuxième temps l’élection d’une Assemblée nationale algérienne, chargée de promulguer une Constitution et de bâtir un nouvel Etat doté de ses propres institutions. En attendant, les pouvoirs publics relevaient d’un dispositif transitoire : un haut-commissaire de la République française à Alger (en l’occurrence Christian Fouchet) et un Exécutif provisoire, composé de cinq représentants du FLN, de quatre musulmans modérés (dont le président de l’Exécutif provisoire, Abderrahmane Farès), et de trois Européens libéraux, acquis à l’indépendance.
Le 15 mai, le référendum d’autodétermination est fixé au 1er juillet. Mais à l’approche de ce scrutin décisif, des tensions se manifestent au sein du FLN. Le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA), le « Parlement » du mouvement indépendantiste, se réunit à Tripoli, en Libye, du 25 mai au 6 juin et donne lieu à un coup de force. Ahmed Ben Bella, un des chefs extérieurs du FLN, vice-président du GPRA, arrêté en 1956 quand l’avion civil marocain qui le conduisait du Maroc à la Tunisie avait été détourné par la chasse française et resté prisonnier pendant plus de cinq ans en métropole, a été libéré le jour de la signature des accords d’Evian. Consacré comme le leader de la nouvelle Algérie par les médias, bénéficiant du soutien de l’Egypte de Nasser, il cherche à imposer son autorité avant le référendum. A cette fin, il passe un pacte avec le colonel Houari Boumediene, chef de l’état-major général de l’Armée de libération nationale (ALN, le bras armé du FLN) qui est installé à Oujda, ville frontalière entre le Maroc et l’Algérie, située côté marocain.
A l’instigation de Ben Bella, le CNRA élabore une charte qualifiant les accords d’Evian de «plate-forme néocolonialiste», et proclamant la volonté du FLN de revenir sur les quelques garanties accordées aux Européens par les négociateurs du GPRA: amnistie générale pour tous les actes commis avant le cessez-le-feu ; droit pour les citoyens français d’exercer pendant trois ans les droits civiques algériens, avant de choisir leur nationalité définitive, avec une représentation proportionnelle à leur nombre ; respect de leurs droits et de leurs biens même s’ils choisissent de rester en Algérie avec la nationalité française ; mise en valeur des richesses du Sahara par un organisme franco-algérien ; convention fixant l’évacuation totale des forces françaises en Algérie à l’échéance d’un délai de trois ans après l’autodétermination, à l’exception de bases navales et aériennes concédées pour quinze ans et de sites sahariens d’essais militaires alloués pour cinq ans. Ben Bella vise notamment la nationalisation des ressources minières et énergétiques du pays, dont le pétrole du Sahara.
Dès les années 1920, des recherches scientifiques avaient en effet décelé la présence de richesses pétrolières au nord du Hoggar ou dans le Sahara central. Reprises après 1945, ces recherches s’étaient étendues sur 600 000 km² au début des années 1950, et avaient abouti, en janvier 1956, à la découverte du gisement d’Edjelé, puis au mois d’août à celle du site de Hassi-Messaoud, où neuf puits de forage avaient été mis en service : une véritable manne que l’ancienne puissance coloniale avait cédée, par les accords d’Evian, à l’Algérie, alors même que le Sahara, qui recelait ces richesses, n’en avait jamais dépendu avant la conquête française.
Sur un plan strictement politique, Ben Bella tente de substituer au GPRA, que préside Benyoucef Ben Khedda, un bureau politique appelé à devenir l’autorité suprême du FLN. L’autre vice-président du GPRA, Mohamed Boudiaf, allié à des leaders historiques du FLN comme Krim Belkacem et Hocine Aït Ahmed, restés loyaux envers Ben Khedda, fait cependant avorter ce putsch.
Au référendum du 1er juillet 1962, sans surprise, le « oui » remporte 99,7 % des suffrages. Selon les accords d’Evian, les Européens d’Algérie, privés du droit de participer au premier référendum réservé aux habitants de la métropole (le 8 avril 1962, cette consultation – remportée avec 90 % de « oui » – avait autorisé le président de la République à mettre en œuvre les accords d’Evian), devaient voter à leur tour, mais seulement au second référendum d’autodétermination, réservé aux habitants de l’Algérie. Mais lorsque ce second référendum eut lieu, ce 1er juillet, la plus grande part des Français avaient déjà quitté, sous la pression des indépendantistes, l’Algérie, si bien que leur sort fut démocratiquement tranché sans eux. Quant aux musulmans qui avaient voulu longtemps rester français, la volonté de retrait de la France avait eu raison de leur enthousiasme. Les plus irréductibles sentaient en outre la menace qui planait désormais sur eux et qui se traduirait, après l’indépendance, par le massacre des harkis. Ils s’abstinrent donc de se signaler aux vainqueurs du jour par un vote négatif. Si bien que le « non », le 1er juillet, n’obtint que 16 534 bulletins, contre presque 6 millions de voix pour le « oui ».
Au bord de la guerre civile
Le 3 juillet 1962, l’indépendance de l’Algérie est donc proclamée. Mais derrière les cris de joie de la foule musulmane, l’Algérie frôle la guerre civile, car le FLN est au bord de l’implosion. Si le président de l’Exécutif provisoire, Farès, devient dépositaire de la souveraineté du nouvel Etat jusqu’à la réunion d’une Assemblée nationale constituante, il dirige une instance fictive. Le président du GPRA, Ben Khedda, rentré à Alger au premier jour de l’indépendance, est en conflit avec le vice-président Ben Bella, tandis que le commandement de l’armée extérieure a été décapité, Boumediene ayant été destitué par Ben Khedda. Quant à l’ALN, elle est partagée entre les wilayas qui soutiennent Ben Khedda et celles qui appuient Ben Bella. Cette situation anarchique favorisera notamment le massacre d’Oran du 5 juillet 1962 (près de 700 Européens et une centaine de musulmans victimes de règlements de comptes).
De retour en Algérie, le 11 juillet, Ben Bella s’installe à Tlemcen, ville proche d’Oujda, au Maroc, où se trouve l’état-major de l’ALN. Le 22 juillet, le bureau politique qu’il a constitué se déclare « habilité à assurer la direction du pays ». Devant ce coup de force, le GPRA doit s’incliner faute d’appui militaire. Confirmé à la tête de l’état-major de l’ALN par Ben Bella, le colonel Boumediene entre à Alger le 9 septembre, et l’ALN, devenue officiellement l’armée de l’Algérie indépendante, prend le nom d’Armée nationale populaire (ANP). Ben Bella ayant à son tour fait son entrée à Alger, Ben Khedda se retire et quitte la politique : à l’échelle de l’histoire du FLN, c’est la défaite des civils. C’est du « clan d’Oujda », un clan politico-militaire, que sera désormais issu le pouvoir algérien.
Le 20 septembre 1962, ont enfin lieu les élections à l’Assemblée constituante. Mais se présente aux suffrages des Algériens une liste unique de candidats imposée par Ben Bella. A l’issue du scrutin, ce dernier est nommé chef du gouvernement, et le colonel Boumediene ministre de la Défense.
Un jeune homme de 25 ans devient ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme : il s’appelle Abdelaziz Bouteflika… Celui-ci a fait la guerre d’indépendance non les armes à la main, mais comme agent politique hors d’Algérie. Intégré à 19 ans dans les unités de l’ALN basées au Maroc, il est devenu un homme de confiance de Boumediene, suivant son ascension jusqu’à la tête de l’état-major général à Oujda et remplissant pour lui des missions stratégiques. Délégué au Mali, Bouteflika y a collecté de l’argent pour le FLN. En 1961, l’état-major de l’ALN étant déjà en conflit avec le GPRA, il a été envoyé en France et chargé de déterminer lequel des chefs historiques du FLN emprisonné en métropole serait le mieux à même d’incarner l’Algérie indépendante. C’est lui qui a conseillé à Boumediene de s’appuyer sur Ben Bella.
Naissance d’une dictature
Le 26 septembre 1962, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est officiellement mis en place. Le FLN en est le parti unique, adossé à l’appareil militaire qui dirige le pays. Bien décidé à démanteler les accords d’Evian, à ses yeux trop favorables aux intérêts français, Ben Bella fait en outre adopter, en mars 1963, un code de la nationalité qui précise que le mot «Algérien», en matière de nationalité d’origine, s’entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman, ce qui exclut, dans la pratique, les 200 000 Européens restés après l’indépendance (600 000 sont partis entre mars et juillet 1962). En novembre 1963, à nouveau en violation des accords d’Evian, les biens fonciers des Français qui sont partis, déclarés vacants, sont nationalisés sans contrepartie. Au cours des mois suivants, près de 150 000 pieds-noirs qui voulaient encore rester sur leur terre natale quittent le pays. En 1965, ils ne seront plus que 50 000 ; il n’en restera plus que quelques milliers dans les années 1980, sur une communauté d’un million de personnes en 1960.
Le sort des musulmans profrançais fut plus tragique encore. En théorie, ceux-ci étaient protégés par la clause des accords d’Evian qui excluait toutes représailles. Dès le 19 mars 1962, avaient eu lieu pourtant des meurtres de supplétifs de l’armée française. Il s’agissait cependant d’actes isolés, car le FLN se donnait le temps de dresser des listes de ceux qu’il considérait comme des traîtres. Le 15 avril, les harkis avaient été désarmés ; quinze jours plus tard, leurs unités dissoutes. Une directive laissait alors le droit à ceux qui se sentaient menacés de demander leur transfert en France, rupture géographique et culturelle à laquelle très peu étaient disposés. Sentant le danger pour eux, des officiers commencèrent à organiser l’évacuation vers la métropole des hommes qui avaient servi sous leurs ordres et de leurs familles. Mais dès le mois de mai, une série de circulaires gouvernementales, signées par Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, et Pierre Messmer, le ministre des Armées, s’opposèrent à ces transferts clandestins, prévoyant des sanctions pour leurs auteurs.
A partir de l’indépendance, le 3 juillet, la situation bascula pour ceux qu’on désigne sous le terme générique de « harki s». Ne disposant d’aucune protection, l’armée française encore présente en Algérie ayant ordre de ne pas intervenir, ils furent livrés à la vengeance du FLN. Elus et fonctionnaires musulmans de l’administration française, chefs de villages, anciens combattants et anciens supplétifs, regardés comme des collaborateurs du « colonialisme français », sont arrêtés. La plupart subissent d’abominables sévices (mutilations, écartèlements, ébouillantements, etc.) qui s’achèvent par leur mort. Après la formation d’un gouvernement algérien régulier, fin septembre 1962, les arrestations se poursuivirent, au moins jusqu’en décembre. Ce n’est qu’au début de l’année 1963 que le nombre d’exactions diminua, les derniers harkis sortant des camps de prisonniers politiques entre 1965 et 1969. Sur 200 000 à 250 000 hommes ayant servi dans les unités supplétives pendant la guerre d’Algérie, 80 000 musulmans avaient réussi à passer en France, mais ce chiffre inclut aussi des civils, des femmes et des enfants. Il est impossible de déterminer exactement le nombre de harkis tués après les accords d’Evian. 10 000 victimes ? 25 000 ? 50 000 ? 80 000 ? Nul ne peut le dire en se fondant sur des preuves. La seule certitude est que cette tragédie reste une tache sur l’histoire de France.
L’indépendance sous perfusion
Redistribution gratuite des terres, nationalisation du crédit et du commerce extérieur, industrialisation subordonnée au développement agricole : influencé par la Yougoslavie de Tito, le gouvernement de Ben Bella fit de l’Algérie indépendante un laboratoire du socialisme autogestionnaire, version tiers-mondiste. L’expérience est marquée par le coup d’Etat du 19 juin 1965, qualifié de « réajustement révolutionnaire », quand Boumediene fait emprisonner Ben Bella et s’empare du pouvoir qu’il exercera en s’appuyant sur l’armée, jusqu’en 1976, avec le titre de président du Conseil de la révolution, puis de président de la République jusqu’à sa mort, en 1978.
Boumediene au pouvoir, le général De Gaulle entend pourtant poursuivre la coopération avec le jeune Etat. Paris maintient jusqu’en 1970 une aide financière à l’Algérie qui correspond aux investissements prévus en 1958 par le plan de Constantine : un programme de 100 milliards de francs d’investissement public en Algérie dans le domaine économique et social. Le gouvernement français signe en outre en 1966 un accord secret par lequel il renonce à obtenir de l’Algérie des indemnités pour les biens français unilatéralement nationalisés. Parallèlement, la France évacue ses troupes dès 1964, un an avant l’échéance prévue, puis ses sites nucléaires et spatiaux du Sahara (1967) et ses bases militaires de Mers el-Kébir (1968) et de Bousfer (1970). En 1965, après avoir multiplié les pressions destinées à obtenir la révision des concessions pétrolières françaises au Sahara, les Algériens obtiennent gain de cause avec de nouveaux accords financiers qui leur sont favorables, politique préludant à la nationalisation des sociétés pétrolières françaises en 1971.
Bouteflika, une carrière
Sous le règne de Ben Bella, en septembre 1963, Abdelaziz Bouteflika était devenu le ministre des Affaires étrangères de l’Algérie. Limogé en mai 1965, il est partie prenante du coup d’Etat qui renverse Ben Bella le mois suivant. Sous Boumediene, il retrouve son portefeuille des Affaires étrangères et le conservera jusqu’en 1979. De capitale en capitale et dans les enceintes internationales, Bouteflika, ministre d’un Etat devenu riche grâce au pétrole, se fait le porte-parole de l’Algérie révolutionnaire.
Après la disparition de Boumediene en 1978, son successeur, Chadli Bendjedid, nomme, en 1979, Bouteflika ministre d’Etat. Celui-ci est néanmoins peu à peu écarté de la scène politique. Il quitte le pouvoir en 1981. Un détournement de fonds sur les trésoreries des chancelleries algériennes à l’étranger, portant sur 60 millions de francs qu’il a placés en Suisse, vaut à Bouteflika d’être traduit devant le conseil de discipline du FLN et poursuivi par la Cour des comptes. Il s’exile en Suisse, où il fait des affaires. Il ne reviendra en Algérie qu’en 1987.
En octobre 1988, la jeunesse urbaine du pays, lasse de la misère et de la corruption qui règne dans le pays, se révolte. La répression est impitoyable : l’armée tire à balles réelles sur les manifestants, faisant 500 morts. Pour éteindre la contestation, le régime lâche du lest en édictant, en 1989, une nouvelle Constitution qui reconnaît le pluralisme politique et la liberté des élections. Mais celles-ci débouchent sur le succès du parti islamiste, le Front islamique du salut (FIS), aux élections locales de 1990 et aux élections législatives de 1991. Cela conduit l’armée à, successivement, proclamer l’état de siège, pousser le président Chadli Bendjedid à la démission et interrompre le processus électoral. En 1992, le nouveau président, Mohamed Boudiaf, rappelé d’exil par les militaires, est assassiné après quatre mois d’exercice du pouvoir. Ce meurtre marque le début d’une guerre civile opposant l’armée et l’Etat-FLN aux islamistes du Groupe islamique armé (GIA), branche armée du FIS. Ce conflit d’une violence inouïe durera près de dix ans et fera entre 150 000 et 200 000 victimes selon les sources (contre 250 000 à 300 000 morts, tous camps confondus, pour la guerre d’indépendance de 1954-1962).
En 1994, alors que la vie politique est suspendue, Bouteflika est sollicité pour devenir chef de l’Etat, mais il ne donne pas suite à cette proposition. Liamine Zéroual, un général à la retraite, est donc désigné pour diriger le pays, et Bouteflika retourne s’enrichir en Suisse. Dans le but de mettre fin à la période de transition, Zéroual organise une élection présidentielle, en 1995, qu’il remporte. Trois ans plus tard, des tensions au sommet de l’Etat le poussent cependant à déclarer forfait en annonçant pour 1999 une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne se présentera pas. Les généraux vont de nouveau chercher Bouteflika et le chargent de reprendre en main un pays épuisé par la « décennie noire » des années 1990. En avril 1999, il est élu président de la République avec 73,8 % des voix. En avril 2004, Bouteflika sera réélu, au premier tour de scrutin, avec 84,99 % des suffrages. En 2008, le Parlement algérien adopte une modification de la Constitution qui supprime notamment la limite de deux mandats consécutifs pour le chef de l’Etat, ce qui permet au président sortant, candidat à sa succession en 2009, d’être réélu avec 90,24 % des votes.
En avril 2014, désigné candidat par le FLN en dépit de son état de santé – son AVC est survenu l’année précédente -, Bouteflika est réélu pour un quatrième mandat avec 81,5 % des suffrages.
Comment obtient-il des scores aussi caricaturaux ? En Algérie, dictature militaire déguisée en démocratie, prévaut en réalité la culture du parti unique. En dépit d’une réelle liberté d’expression laissée aux médias d’opposition, l’Etat-FLN verrouille le pays à tous les échelons, attribue ou retire subventions, places et prébendes, et n’autorise aux élections locales que l’élection de représentants agréés par les cercles officiels. Les quelques formations d’opposition existantes n’ont ni les hommes ni les moyens pour présenter des candidats crédibles à la présidentielle. La sincérité du scrutin, par ailleurs, est suspecte : les opposants ont toujours dénoncé les tripatouillages électoraux du pouvoir.
Si le système opaque qui gouverne l’Algérie l’a si longtemps maintenu au pouvoir et a même voulu le faire réélire cette année, c’est parce qu’Abdelaziz Bouteflika, figure emblématique de la caste politico-militaire qui tient le pays depuis la rupture avec la France, incarne, à travers son parcours personnel, toute l’histoire de l’Algérie indépendante. Ce que n’avait pas prévu et senti ce clan allié à la famille d’Abdelaziz Bouteflika, notamment son frère Saïd, c’est cependant l’exaspération d’une population humiliée de se voir représentée par un président fantôme et désespérée par les impasses de la vie en Algérie, spécifiquement les jeunes.
L’échec d’un système
Par un mélange de socialisme, de bureaucratie, de corruption, de gabegie et d’immobilisme, l’Algérie n’a fait, depuis 1962, que reculer sur le plan économique. La collectivisation des terres, à l’époque qui a suivi l’indépendance, a ruiné le secteur agricole : l’Algérie importe des produits alimentaires qu’elle exportait avant l’indépendance. Aucun effort d’industrialisation, de plus, n’a été accompli depuis un demi-siècle, si bien que l’Algérie achète à l’étranger 80 % de ce qu’elle consomme. Le tourisme, enfin, dans un pays aux somptueuses beautés naturelles, est inexistant. En définitive, l’économie ne repose que sur la prodigieuse richesse du sous-sol saharien que lui a légué la France. Pétrole et gaz (et bientôt gaz de schiste) représentent plus de 95 % des recettes extérieures du pays, et contribuent pour 60 % au budget de l’Etat. Mais le prix du pétrole baisse sur le marché mondial, et les ressources algériennes ne sont pas illimitées…
L’Algérie n’a pas assez de travail à offrir à sa population qui s’accroît de plus d’un million d’individus chaque année : les Algériens sont 43 millions en 2019, quatre fois plus qu’à l’indépendance, dont plus de la moitié est âgée de moins de 30 ans. Le chômage frappe 30 % de cette classe d’âge, avec pour conséquence l’émigration des plus diplômés vers l’Europe ou l’Amérique, ou le rêve français pour ceux qui souhaitent rejoindre les 5 millions d’Algériens et de Franco-Algériens qui vivent dans l’ancienne puissance coloniale.
Au deuxième mois de contestation contre Bouteflika, les meilleurs experts étaient circonspects. Le pouvoir allait-il céder devant la rue ? Allait-il au contraire tenter l’épreuve de force ? Toute cette jeunesse branchée sur les réseaux sociaux savait-elle où elle allait ? Quel était le poids des islamistes dans le mouvement ? C’est finalement l’appel du tout-puissant général Ahmed Gaïd Salah à appliquer la Constitution qui a changé la donne. Pour autant, nul ne sait si le processus engagé accouchera d’un nouveau système ou débouchera sur le chaos. Cinquante-sept ans après l’indépendance de l’Algérie, nul ne peut dire non plus combien de ses ressortissants s’apprêteraient alors à fuir pour rejoindre cette France dont les héros unanimement célébrés de leur histoire avaient prétendu se délivrer au prix de tant de violence et de tant de sang.
Jean Sévillia