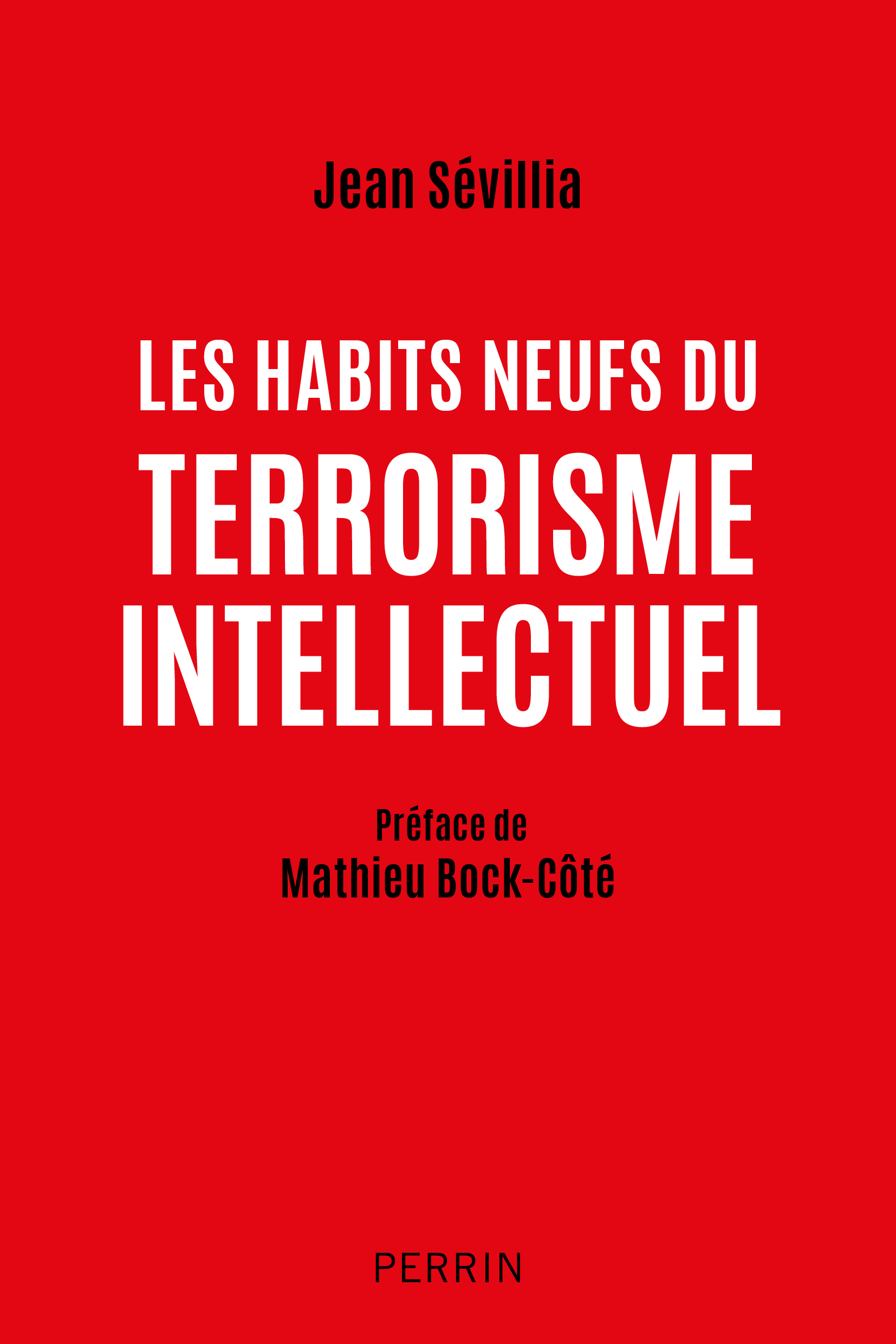Depuis trente ans, dans ses articles du Figaro Magazine comme dans ses ouvrages, Jean Sévillia s’applique à rappeler des évidences contestées par les élites intellectuelles, une grande partie du corps professoral et les procureurs médiatiques du politiquement correct : oui, le passé de la France fut riche et glorieux, et mérite d’être enseigné sans honte ; oui, la crise actuelle du lien social est une crise d’identité politique, mais aussi et surtout spirituelle et civilisationnelle ; oui, il est autant possible d’être réaliste sans être « décliniste » que lucide sans être naïf. « Empêcher que le monde se défasse » : tel est un des objectifs que s’est fixé l’auteur d’une Histoire passionnée de la France. C’est aussi le titre de la préface d’une épais volume publié par les éditions Perrin qui ont rassemblé trois de ses essais majeurs (Le Terrorisme intellectuel, Historiquement correct et Moralement correct). Ecrits historiques de combat est un livre aux allures d’arme de guerre intellectuelle contre une gauche bien-pensante qui peine à renouveler ses munitions. Mais dont les bastions sont encore nombreux…
Jean-Christophe Buisson
Le Figaro Magazine : La publication de votre livre « Le Terrorisme intellectuel », en 2000, marqua les esprits, autant par son contenu que par le titre, particulièrement violent. A quelle(s) réalité(s) correspondait-il alors ?
Jean Sévillia – Le terrorisme intellectuel consiste à discréditer son adversaire, à le délégitimer en lui collant une étiquette infamante plutôt que de discuter ses arguments et d’avoir avec lui un authentique débat. Le phénomène est apparu dans sa forme contemporaine dans les années d’après-guerre, lorsque la gauche en général et les communistes en particulier dominaient les milieux intellectuels. Jean-Paul Sartre décrétait alors qu’un anticommuniste était « un chien » tandis que les universitaires marxistes qualifiaient le libéral Raymond Aron de « fasciste ». Après la déstalinisation et la répression de la révolte de Budapest par les chars russes, l’étoile soviétique a cessé de briller au firmament des idées, mais les intellectuels ont adulé de nouveaux héros qui s’appelaient Ho Chi Minh, Mao, Fidel Castro. Quand on a découvert que le communisme tropical engendrait lui aussi des goulags, il y a eu, à gauche, une remise en cause des schémas marxistes, mais l’intelligentsia a enfourché de nouveaux chevaux de bataille. Ce furent le droit-de-l’hommisme, l’antiracisme, le sans-frontièrisme, le multiculturalisme, l’antisexisme, le droit à la différence sexuelle, etc. La doxa qui en a résulté était hégémonique dans le monde culturel et médiatique à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La classe politique, même de droite, pliait devant lui.
… Pouvez-vous en donner des exemples ?
Rappelons-nous les campagnes contre les mesures prises par les gouvernements de droite pour réguler l’immigration, sous la présidence Mitterrand ou au début de la présidence Chirac, mesures accusées de racisme. Rappelons-nous encore l’obligation de repentance collective imposée à la France au moment du procès Papon, la façon dont fut accueillie le Livre noir du communisme, ouvrage soupçonné de vouloir minimiser les crimes nazis, ou encore l’anti-lepénisme hystérique qui a culminé lors des régionales de 1998 ou dans l’entre-deux-tours de la présidentielle de 2002, antifascisme dont Lionel Jospin a reconnu plus tard qu’il était « du théâtre » puisque la France, en ces années-là, n’avait jamais été confrontée à une menace fasciste. Cette accumulation de mensonges ne pouvait que provoquer une réaction. Elle m’a conduit à écrire le Terrorisme intellectuel, essai qui raconte l’histoire de la manipulation des esprits, au nom de l’idéologie dominante, de 1945 à nos jours. De Jean-François Revel à Vladimir Volkoff, des auteurs m’avaient précédé dans l’analyse de ce qu’on appelait alors la désinformation. La lutte contre le politiquement correct allait susciter, dans les années 2000 et 2010, une véritable vague de parutions dans tous les domaines : politique, société, histoire. Ce renouveau d’une pensée conservatrice au sens fort du terme ou réactionnaire comme on dit à gauche me réjouit profondément. J’éprouve certes quelque fierté à en avoir été un des pionniers.
Etes-vous d’accord avec la thèse de Guillaume Bernard, auteur de « La guerre à droite aura bien lieu », selon laquelle la droite intellectuelle est en train de gagner le combat culturel puisque la gauche intellectuelle a quasiment disparu du paysage des idées en France ?
Guillaume Bernard défend la thèse selon laquelle la dynamique intellectuelle et politique s’est inversée, en France, à partir des années 1990. Alors qu’elle s’organisait depuis deux siècles sur la base d’un mouvement sinistrogyre, les nouvelles forces politiques apparaissant à gauche et repoussant sur leur droite les courants plus anciens, les radicaux, par exemple, étant ainsi dépassés par les socialistes qui eux-mêmes étaient ensuite dépassés par les communistes, nous aurions désormais une logique inverse, le mouvement dextrogyre, dont la conséquence serait que l’innovation idéologique et politique vienne de la droite, ce qui nous promettrait non seulement une recomposition du champ politique mais une guerre entre une droite classique ayant retrouvé ses vraies valeurs et une droite moderne en passe de redevenir la gauche. Pour ma part, je serais plus prudent. Il est exact que la gauche française semble en panne d’idées et qu’elle a du mal à appréhender les défis identitaires actuels, elle qui a toujours raisonné en termes d’inégalités sociales. Je crois néanmoins que le clivage gauche-droite structure en profondeur notre vie intellectuelle et politique depuis si longtemps qu’il n’est pas près de disparaître. Nous restons le pays de la Révolution française, soit un pays marqué par l’idéologie, par l’esprit de révolte, de rupture, d’aspiration à l’égalité, mentalité qui continue de nourrir à gauche d’inépuisables rêves. On n’entend plus les intellectuels de gauche, il est vrai, mais c’est surtout parce qu’ils ont perdu leurs repères, non parce qu’ils auraient fondamentalement changé. Il faut d’ailleurs distinguer ce que j’appelle la haute cléricature, les grands intellectuels pétitionnaires qui défendent des positions de gauche, qui sont rares aujourd’hui, et la basse cléricature où la gauche reste dominante et parfois hégémonique. Ceux qui disent que la droite a remporté le combat culturel pourraient enquêter dans les salles de profs des lycées et collèges ou dans les rédactions des chaînes publiques sur ce que l’on pense de la crise des migrants, du vote Sarkozy, de Marine Le Pen ou de l’élection de Donald Trump : ils seraient édifiés sur la prétendue disparition des idées de gauche. Je ne crois donc pas à l’effacement du clivage gauche-droite, même si ses thèmes et ses césures se sont déplacées, et même si un certain libéralisme libertaire réunit et tend à confondre les élites dirigeantes de gauche comme de droite. La multiplication des analystes de droite ou conservateurs est indéniable, l’audience médiatique de figures comme Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour, qui ont soulevé la chape de plomb du politiquement correct, est avérée, mais cette réalité ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Dans les profondeurs de notre société, en tout cas dans l’univers de l’enseignement, de la culture et de l’information, la prégnance des idées de gauche reste très forte, et le terrorisme intellectuel ne désarme pas.
Dans votre livre, vous vous félicitez néanmoins de voir et d’entendre certains intellectuels changer d’opinion sous la pression du réel. A qui songez-vous ?
Une bonne partie de ceux qu’on a qualifiés de « néo-réacs » ont commencé leur carrière à gauche. Cela est vrai, dans le désordre, d’Alain Finkielkraut, Régis Debray, Pascal Bruckner, Philippe Muray, Pierre-André Taguieff, Natacha Polony ou Elisabeth Lévy. Leur évolution rappelle qu’il n’existe pas de déterminisme, et que nul n’est assigné à résidence dans sa famille de pensée d’origine. Persiste toutefois une sorte de sur-moi datant de leur jeunesse qui empêche les intellectuels ayant rompu avec la gauche de se dire de droite. C’est sans importance, car l’essentiel n’est pas l’étiquette mais le contenu. Cela me fait seulement sourire, moi qui n’ai jamais été de gauche, pas même à dix-huit ans.
Y a-t-il des thèmes historiques qui restent tabous en France ? Y a-t-il une période historique dont le traitement « officiel » a empiré depuis dix ans ?
Il reste des vaches sacrées, comme la Révolution française, la Commune, le Front populaire ou la Résistance. Mais dans ce domaine-là, on a aussi des surprises. C’est un homme venu de la gauche, François Furet, qui a forcé ses amis à admettre qu’il y a une inacceptable dimension terroriste dans la Révolution française. Et Olivier Wieviorka, un historien de gauche, s’est récemment livré à un passionnant travail de démythification de la Résistance. Rien n’est figé dans le domaine de la recherche historique. Ce que j’ai appelé l’historiquement correct se déplace. On peut aujourd’hui critiquer le communisme sans subir les foudres de personne, parce que le parti communiste est moribond et que le communisme n’est plus un enjeu. Vingt ans après, l’accueil réservé en 1997 au Livre noir du communisme ne serait plus le même. En revanche, se livrer à une étude scientifique de la vie de Mahomet ou de l’histoire de l’islam est un exercice qui n’est pas sans risques pour les raisons que l’on sait.
L’enseignement de l’histoire au collège et au lycée est-il vraiment catastrophique ?
Oui, en dépit de la bonne volonté des enseignants. Le temps consacré à cette matière a été réduit, la chronologie a été sacrifiée à des perspectives thématiques qui introduisent de la confusion dans l’esprit des élèves, et les programmes laissent de côté des pans entiers du passé. Il y a une perspective idéologique qui consiste à privilégier l’histoire vue du monde extérieur, comme si raconter l’histoire de France était réducteur. Les élèves arrivent au bac avec des connaissances lacunaires, inorganisées et farcies de préjugés qui contrastent avec l’esprit critique que l’époque prétend cultiver. Tous les maîtres de conférences ont à raconter d’incroyables anecdotes sur des étudiants de première année d’histoire qui ne maîtrisent pas les bases nécessaires pour entamer des études supérieures dans cette discipline, se montant par exemple incapables de classer dans l’ordre les régimes politiques français du XIXe siècle. Ignorer que la Restauration précède la monarchie de Juillet ou la IIe République le Second Empire quand on s’inscrit à l’université pour faire de l’histoire, oui, c’est catastrophique. Et au-delà de ceux qui se vouent à l’histoire à titre professionnel, cette méconnaissance du passé est une rupture pour tout un peuple.
Vos adversaires vous reprochent de n’être pas un véritable historien, au sens universitaire du terme…
Je leur réponds qu’il a toujours existé des historiens non-universitaires, que la connaissance du passé n’est la propriété privée de personne, et que je suis publié par des maisons d’édition dont la compétence en matière d’histoire ne peut être mise en doute : si ce que j’écrivais était dénué de sérieux ou de pertinence, on me retournerait mes manuscrits. Nul, par ailleurs, n’a pu prouver que ce que j’écris est faux. Je n’ai d’ailleurs jamais être prétendu être spécialiste de tous les sujets. Mais je lis les spécialistes – cela fait trente ans que je fais de la critique des livres d’histoire dans les colonnes du Figaro Magazine – et je m’appuie sur eux en les citant : je suis un passeur. J’ai par ailleurs chez moi un classeur plein de lettres d’historiens universitaires qui me félicitent pour mon travail. Les idéologues qui cherchent à décrédibiliser mes livres ne m’impressionnent pas.
Vous donnez à la préface de la réédition de vos trois livres de combat un titre éloquent : « Empêcher que le monde se défasse ». Doit-on vous classer parmi les déclinistes ?
Je ne me reconnais pas dans ce mot de « décliniste » inventé, il y a une dizaine d’années, pour vilipender ceux qui décrivaient simplement le réel : le recul de la France sur la scène internationale, la faiblesse d’un Etat par ailleurs tentaculaire, la perte de confiance dans la classe politique, les lourdeurs qui obèrent l’économie française, la perte d’autorité dans la société, la hausse vertigineuse de la délinquance, l’échec de l’école, la paupérisation des banlieues et du monde rural, l’abandon de la « France périphérique » décrite par Christophe Guilluy, la progression de l’islamisme et j’en passe…
Certains avancent que la France se trouve dans une situation pré-insurrectionnelle voire pré-révolutionnaire. Est-ce votre avis ?
La faiblesse de la puissance publique conjuguée au délitement du tissu social dans de nombreuses zones du territoire national où règne de plus un puissant communautarisme ethnico-religieux met en place les conditions de troubles graves. Rappelons cependant que, dans l’histoire, les guerres civiles surviennent lorsque s’affrontent des forces sensiblement égales. Dieu merci, on n’en est pas là. Le pire n’est donc pas inéluctable. Ayant étudié l’histoire de France, je sais en outre que notre pays a souvent affronté de terribles épreuves dont il a fini par sortir à chaque fois, au prix de miraculeux sursauts nationaux. Je sais encore qu’il existe une France qui travaille, qui élève ses enfants et qui n’abandonne rien de nos valeurs traditionnelles. C’est d’ailleurs grâce à cette France que le pays tient debout. Je sais néanmoins que, faute de consensus entre tous ceux qui vivent dans notre pays, notre société est éminemment fragile.
Propos recueillis par Jean-Christophe Buisson