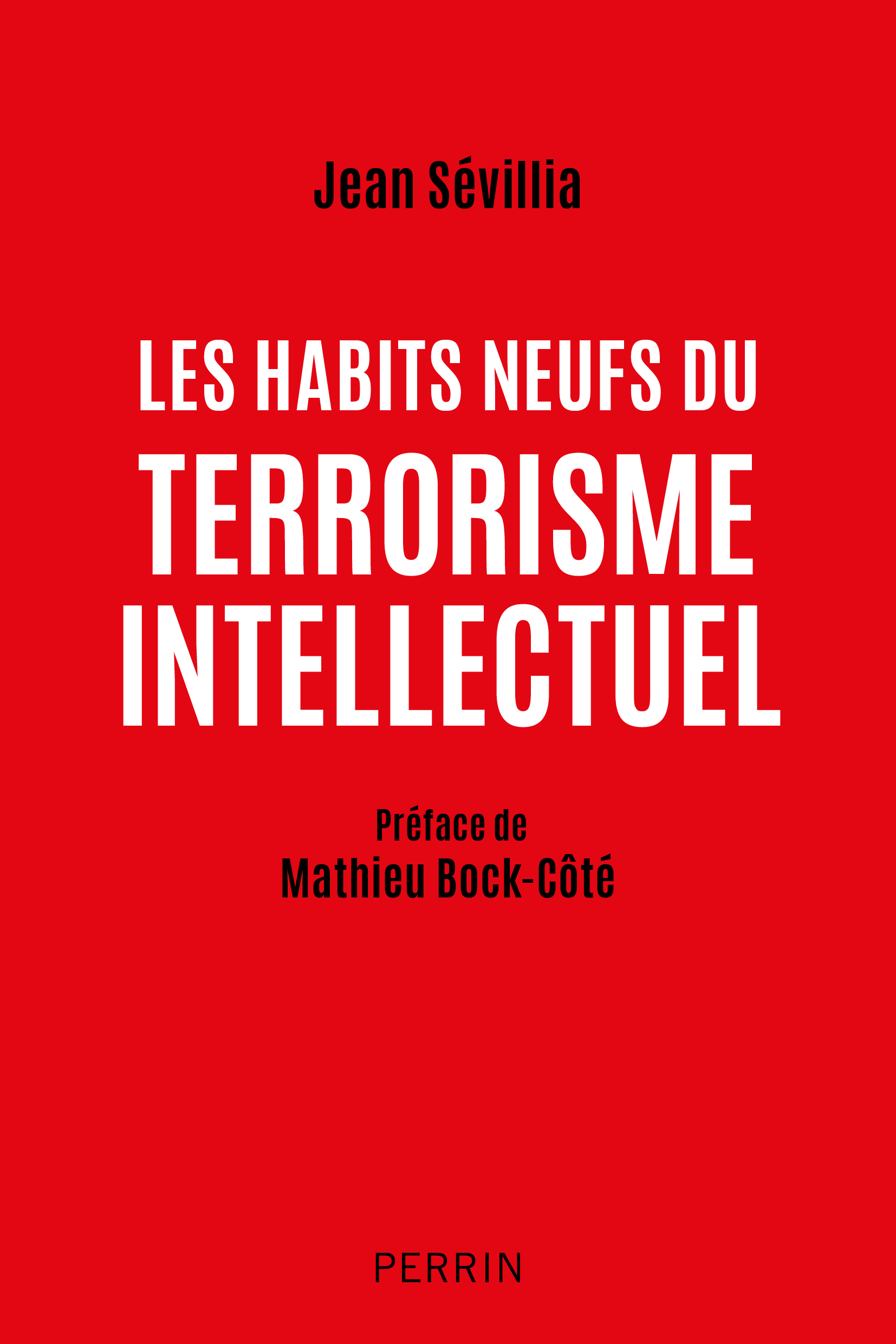Mettant fin aux guerres de Religion et fixant le statut des protestants, l’édit de Nantes, signé le 13 avril 1598, est un grand acte politique d’Henri IV. Sa mise en oeuvre s’avérera difficile. Mais sa révocation sera une faute du règne de Louis XIV.
Le 13 avril 1598, dans la salle du conseil du château de Nantes, Henri IV signe un édit royal. Préparé et discuté depuis de longs mois, cet acte met fin aux guerres de Religion et fixe dans la loi le statut des protestants. Dans le royaume, pour une population totale de 16 à 18 millions d’âmes, leur nombre est estimé à un million. Manifestant la reconnaissance de la différence religieuse au sein des habitants du pays, cet édit marque un tournant dans l’histoire de France. Son application, pour autant, rencontrant de fortes oppositions, ne sera pas facile. Elle entrera en contradiction, de plus, avec la tradition unitaire française, si bien qu’on peut s’interroger : la politique d’Henri IV était-elle visionnaire, ou inévitablement vouée à l’échec ?
Au moment de la signature de l’édit de Nantes, Henri IV est roi de France depuis environ neuf ans. Dans la pratique, ce monarque a dû batailler pour être accepté. En 1589, il a succédé à Henri III, assassiné par un moine fanatique, alors qu’ils assiégeaient ensemble Paris. Face à un nouveau soulèvement des provinces catholiques fomenté par le duc de Mayenne, frère des Guise qu’il avait fait exécuter, à Blois, au nom de la raison d’Etat, le souverain s’était en effet rapproché de son cousin, Henri de Navarre, qui était aussi son successeur depuis la mort de son frère, Monsieur, duc d’Anjou, en 1584. Mais Henri, fils d’Antoine de Bourbon, était protestant et avait même combattu l’armée royale à Coutras, en 1587. Si bien que, après la mort d’Henri III, les trois quarts des Français avaient refusé de voir en ce prince devenu de droit Henri IV leur nouveau roi, un roi que les extrémistes catholiques de la Ligue considéraient tout simplement comme un ennemi.
C’est donc les armes à la main qu’Henri IV avait dû conquérir son trône. A Arques, en 1589, puis à Ivry, en 1590, il avait affronté le duc de Mayenne, chef de la Ligue. En 1591, il avait assiégé de nouveau Paris où la Ligue avait pris le pouvoir. Le conflit s’éternisant, il avait fait savoir, pour sortir de l’impasse, qu’il était disposé, lui qui avait changé plusieurs fois de religion dans sa jeunesse, à se convertir définitivement au catholicisme. A Saint-Denis, en 1593, il avait abjuré. En 1594, il avait été sacré à Chartres. En 1595, tout en obtenant la soumission des derniers grands seigneurs de la Ligue, il avait déplacé le conflit civil sur le plan international en déclarant la guerre à l’Espagne, traditionnel soutien des ligueurs.
Les guerres de Religion – les huit guerres successives pour être précis -, commencées en 1562, entrecoupées de traités de paix suivis de périodes de répit, avaient duré trente-six ans.
Pourquoi presque quarante années de lutte armée ? Aucun pays européen touché par la Réforme n’avait subi un affrontement intérieur aussi long, aussi meurtrier, aussi destructeur. C’est que les guerres de Religion, en France, au-delà de leur dimension confessionnelle, avaient mis en branle des forces qui cherchaient à prendre le contrôle de l’Etat, en mettant la monarchie dans leur camp ou en la plaçant sous tutelle. Et comme dans toute guerre civile, chaque parti avait eu ses intransigeants préférant s’allier avec l’étranger (l’Angleterre pour les huguenots, l’Espagne pour les ligueurs catholiques) plutôt que de trouver un compromis avec ses compatriotes de l’autre bord.
Au centre de l’Europe, les terres d’Empire avaient aussi connu la guerre entre catholiques et réformés. Après la paix d’Augsbourg, en 1555, Charles Quint s’était résolu à la partition territoriale entre les deux religions en fonction de l’appartenance confessionnelle de chaque prince, selon le principe cujus regio, ejus religio. Mais le Saint-Empire était une constellation d’Etats et de villes libres. En France, la constitution unitaire du royaume capétien, selon un modèle national en gestation, interdisait une telle solution.
Au-delà de l’antagonisme religieux qui séparait huguenots et papistes, le drame qui s’était joué entre 1562 et 1598 était donc une tragédie politique. A laquelle Henri IV, roi politique, voulait apporter une réponse politique. Après sa conversion, il avait déclaré : « Je veux que ceux de la Religion [les réformés] vivent en paix en mon royaume, non pas pour ce qu’ils sont de la Religion, mais d’autant qu’ils ont été fidèles serviteurs à moi et à la couronne de France. Nous sommes tous Français et concitoyens d’une même patrie. » Avant la lettre, avant l’usage du mot, le monarque voulait refonder l’unité nationale. Un projet qui supposait que les armes soient déposées, ce qui sera l’oeuvre de l’édit de Nantes.
Cet accord a été précédé de longues tractations avec l’assemblée protestante. En 1597, l’ouverture de négociations de paix avec l’Espagne, qui n’a finalement tiré aucun bénéfice de la guerre civile française, a mis Henri IV en position de force. Il en a été de même de la soumission, au début de 1598, du duc de Mercoeur, le chef la Ligue en Bretagne, vieil allié de l’Espagne.
Ce qu’on appelle l’édit de Nantes se compose en réalité de quatre éléments. D’abord l’édit public signé le 13 avril 1598, qui comporte 92 articles. Ensuite 56 articles secrets sur la future application de l’accord, qui seront signés le 2 mai, comme la paix de Vervins, conclue entre Henri IV et Philippe II d’Espagne. L’édit et ces articles complémentaires doivent être enregistrés par les parlements. S’ajoutent deux brevets immédiatement exécutoires, l’un relatif à un subside de 45 000 écus pour le traitement des ministres du culte réformé, l’autre à l’octroi de places de sûreté pour les protestants. Ultérieurement viendront des dispositions concernant le droit, pour les réformés, de tenir des assemblées générales et d’entretenir deux députés généraux à la Cour.
Globalement, l’édit de Nantes se montre très généreux envers les protestants. Non seulement l’édit leur accorde la liberté de conscience et la liberté de culte (dans des conditions déterminées, il est vrai), mais leur culte est désormais autorisé sur les terres des 3 500 seigneurs hauts justiciers, tandis que les seigneurs bas justiciers reçoivent un droit de culte privé. Le culte réformé est reconnu dans les villes où il se déroulait publiquement en 1596 et jusqu’à la fin d’août 1597, ainsi que dans les faubourgs de deux villes ou bourgs par bailliage. Les anciens temples seront restitués aux communautés réformées, qui auront la faculté d’en bâtir de nouveaux. Les synodes protestants, par ailleurs, seront autorisés. Quant aux droits civils, les protestants seront placés à égalité avec les catholiques : ils pourront accéder à toutes les charges, dignités et magistratures, auront le droit de libre résidence, le droit de vendre, d’acheter, de tester et d’hériter. Ils auront la liberté d’être admis dans les universités, collèges, écoles et hôpitaux, comme de créer des collèges et académies. Ils pourront en outre être jugés par des tribunaux spéciaux : à Bordeaux, à Grenoble et à Castres, des chambres composées pour moitié de juges des deux confessions devront siéger afin de juger des procès dans lesquels une des parties serait calviniste. Au parlement de Paris, une chambre de l’Edit sera composée de six magistrats réformés et de dix catholiques. Enfin près de 150 places fortes, dont La Rochelle, Saumur, Montauban et Montpellier, sont concédées aux protestants pour se réfugier en cas de troubles.
Le premier article de l’édit signé le 13 avril 1598 est peut-être le plus profond. Car Henri IV instaure la paix intérieure sous les auspices de l’oubli et du pardon : « Que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu’à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents, et à l’occasion d’iceux, demeurera éteinte et assoupie comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs-généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cour ou juridiction que ce soit ». Ce principe d’amnistie est un principe civilisateur : il est le seul qui permette de clore une guerre civile.
Dans son esprit, cependant, l’édit de Nantes n’est pas différent des autres traités de pacification conclus au long des années de guerre, par les Valois, à Saint-Germain (1562), à Amboise (1563), à Longjumeau (1568), de nouveau à Saint-Germain (1570), à Beaulieu (1576), à Poitiers (1577) et à Fleix (1580). Ceux-ci, déjà, instauraient sinon l’égalité pour les réformés, du moins une liberté de culte relative, et leur attribuait des places fortes. En réalité, l’originalité de l’acte signé à Nantes vient de ce que Henri IV est décidé à le faire appliquer à la lettre. De Toulouse à Paris, le roi ira d’ailleurs plaider en faveur de l’édit. « Je suis plus catholique que vous car je suis le fils aîné de l’Eglise, nul de vous ne l’est et ne peut l’être », expliquera-t-il dans la capitale.
De l’édit de Nantes, toutefois, on se fait aujourd’hui une idée fausse. Il n’est pas un manifeste laïc, au sens moderne du terme. Car même après le 13 avril 1598, Henri IV reste le roi très-chrétien et le catholicisme reste religion d’Etat. A Paris et dans les villes où réside la Cour, le culte réformé demeure interdit. Avant 1597, le culte protestant était illégal à Rouen, Dijon, Toulouse ou Lyon. Après l’édit de Nantes, il le demeure. En sens inverse, après 1598, le culte catholique reste interdit à La Rochelle, Saumur, Montauban ou Montpellier.
Formellement, un quart du territoire français reste sous contrôle huguenot. Il ne faut donc pas croire que l’édit de Nantes a été accueilli avec joie par les catholiques. Au contraire, l’édit se heurtera à une violente opposition. Ce n’est qu’après deux ans de tergiversations que le parlement de Paris procédera à son enregistrement. Les autres cours souveraines de Rennes, Aix et Toulouse s’y résigneront, cédant à la menace du roi, mais le parlement de Rouen résistera jusqu’en 1609.
L’édit de Nantes tiendra parce que le souverain saura l’imposer en ralliant les modérés des deux camps. Et aussi parce que le pays, exsangue, était las de la guerre civile. Mais l’édit instaurait moins la tolérance entre les deux religions qu’il n’organisait la coexistence entre elles, et sur la base d’un partage territorial, accroc à la tradition unitaire française. En réalité, cet accommodement permit aux catholiques et protestants, selon l’intitulé d’un colloque organisé pour le quatrième centenaire de l’édit, en 1998, de « coexister dans l’intolérance ».
Car contrairement à une idée reçue, nulle part le mot ou même le concept de tolérance n’apparaît dans l’édit. Au XVIe siècle, le terme est d’ailleurs négatif. Tolérer est un synonyme de supporter ou d’endurer. La tolérance, c’est l’action de subir avec patience un mal que l’on ne peut éviter. Elle ne désigne donc pas un idéal, mais un pis-aller. A l’époque des guerres de Religion, et même après, catholiques comme protestants étaient persuadés de détenir la vérité religieuse et considéraient comme un devoir de charité d’y amener leurs adversaires, y compris par la force.
Dans l’esprit de ses négociateurs, l’édit de Nantes constituait un compromis politique : à titre provisoire, les représentants d’une autre confession chrétienne étaient admis sur le territoire du royaume. Il s’agissait, explique Bernard Cottret, un historien du protestantisme, de « placer les huguenots sous liberté surveillée, en attendant paisiblement leur disparition ». De leur côté, les protestants ne jugeaient pas l’édit autrement que comme une pause forcée au sein d’un combat à reprendre. Pendant les guerres de Religion, les huguenots ne cherchaient pas à se faire admettre en tant que minorité. Cette conception moderne du droit à la différence leur était étrangère. Leur stratégie visait en fait à s’emparer de l’Etat afin d’y imposer leur religion, car à l’époque il n’y avait de religion que d’Etat, et ce dans tous les pays.
Avec l’édit de Nantes était instauré en France un régime de coexistence religieuse, régime dont il faut se demander si, dans l’optique de la monarchie absolue qui commençait alors à s’édifier, il n’était pas pensé comme transitoire car il faisait du calvinisme un véritable Etat dans l’Etat.
Dès le règne de Louis XIII commenceront à se manifester les menaces contenues en germe dans l’édit de Nantes. On verra ainsi les protestants de La Rochelle recevoir des secours des Anglais. Richelieu, poursuivant son oeuvre d’unité nationale, imposera aux réformés la paix d’Alès (1629). Garantissant à ceux-ci la liberté de culte et l’égalité civile, ce nouvel édit leur enlèvera leurs places de sûreté et abolira les autres clauses politiques de l’édit de Nantes.
L’équilibre de l’édit d’Alès sera rompu, un demi-siècle plus tard, par Louis XIV. Ses conseillers religieux l’ayant persuadé que les missions envoyées dans le royaume afin de convertir les réformés au catholicisme avaient r&eac te;ussi, le roi pensa qu’interdire le protestantisme ne serait rien d’autre qu’aligner la France sur le modèle qui dominait l’Europe, où les sujets professaient la religion de leur souverain. En 1685, l’édit de Fontainebleau, qui révoquait celui de Nantes, privait les réformés de leur religion et leur interdisait même de quitter le royaume, ce que 200 000 d’entre eux feront illégalement, se fixant en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande. Humilié et proscrit, le protestantisme français devenait une force de contestation souterraine. Non seulement l’unité spirituelle du royaume, qui était le but recherché par la révocation de l’édit de Nantes, n’est pas atteinte, mais un cinquième de l’élite économique française, de confession réformée, prenait le chemin de l’exil, apportant ses talents à des Etats qui étaient ou seront des ennemis de la France. Sans aucun doute, cette révocation fut une faute majeure du règne de Louis XIV.
Jean Sévillia