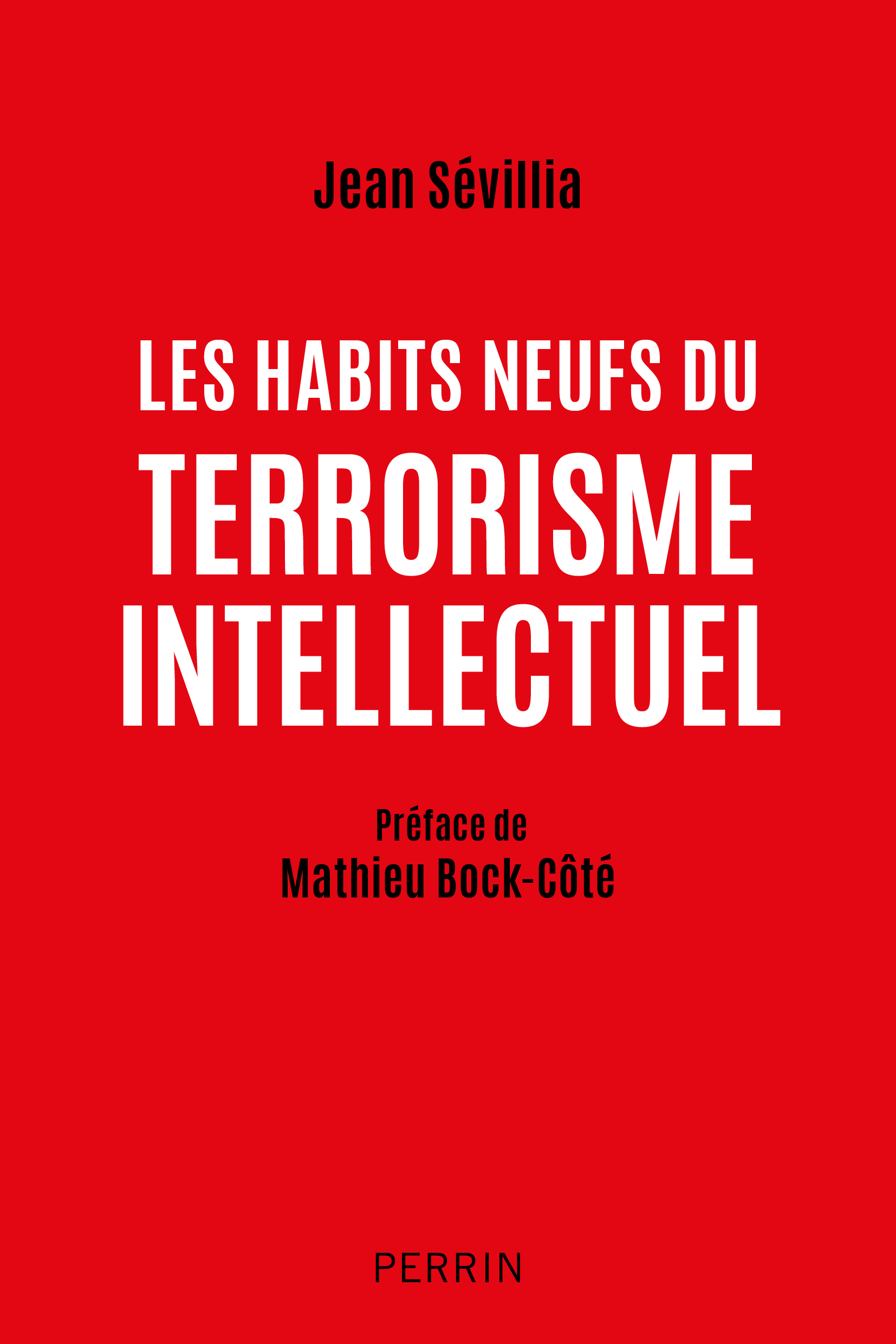Réforme du collège, programmes d’histoire : les projets gouvernementaux ont déclenché une tempête. Si le débat déborde du cadre politique habituel, l’égalitarisme et l’idéologie multiculturaliste sont en cause.
Ce n’est certes pas la première fois qu’une série de mesures touchant à l’école – sujet toujours sensible en France – déchaîne les passions, mais la réforme du collège conçue par Najat Vallaud-Belkacem, couplée à la refonte des programmes d’histoire, a cette fois-ci déclenché une véritable tempête. La ministre de l’Education nationale a ainsi traité de « pseudo-intellectuels » quelques figures du débat d’idées qui avaient critiqué ses projets. Pseudo-intellectuels, Marc Fumaroli, Régis Debray, Luc Ferry, Pierre Nora, Pascal Bruckner ou Michel Onfray ? Nicolas Sarkozy, de son côté, a dénoncé « la plus détestable de la longue liste des réformes inutiles que nous avons connues depuis trois ans », tandis que plus de 230 parlementaires de la droite et du centre ont écrit au président de la République afin d’exiger le retrait de la réforme. François Hollande, lui, a fustigé les adversaires de Najat Vallaud-Belkacem : « J’entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants, ceux qui, au nom de l’intérêt général supposé, défendent leurs intérêts particuliers. » Quant au monde enseignant, il est tout aussi divisé : le Snalc, le Snes, Sud et la CGT, syndicats de gauche, annoncent pour le 19 mai une grève destinée à protester contre une réforme dont certaines nouveautés dans l’organisation du travail heurtent les professeurs. D’autres organisations de gauche, de la CFDT au syndicat lycéen UNL, soutiennent pourtant la ministre de l’Education nationale, voyant dans sa réforme la consécration de leur philosophie de l’école…
De quoi s’agit-il ? Deux projets distincts, en l’occurrence, se télescopent. Il y a d’abord la réforme du collège, approuvée par le Conseil supérieur de l’éducation et présentée le 10 avril, qui entrera en vigueur à la rentrée 2016. Celle-ci préconise de laisser 20 % d’autonomie aux établissements dans l’exécution des programmes, et prévoit l’instauration d’« enseignements pratiques interdisciplinaires » (EPI), qui mêleront élèves et professeurs de plusieurs matières, affichant l’intention de décloisonner les disciplines, de susciter l’inventivité pédagogique et d’éveiller l’intérêt des élèves.
Dans cette perspective, le latin et le grec perdront leur statut de matières à option pour rejoindre celui des enseignements interdisciplinaires. Najat Vallaud-Belkacem argue dès lors que 100 % des élèves seront amenés à faire du latin, puisque les langues anciennes ne seront plus optionnelles, mais obligatoires comme tous les EPI. Un raisonnement hypocrite, selon les adversaires du projet, qui soulignent que le temps dégagé pour les enseignements pratiques interdisciplinaires (trois heures par semaine) s’impute en réalité sur les matières déjà obligatoires. En d’autres termes, un professeur de lettres latiniste ou helléniste devra s’entendre avec son collègue professeur d’histoire, par exemple, afin de glisser du latin au milieu de l’étude de la Rome antique ou du grec dans un cours sur la démocratie athénienne. N’étant plus des disciplines en tant que telles, le latin et le grec, sans horaires propres, sans vrai programme et laissés au bon vouloir des chefs d’établissement, sont donc voués à disparaître des collèges dans la plupart des cas. Quand on sait que seulement 19 % des élèves de cinquième font du latin, contre 25 % en 1996, il s’agit d’une mise à mort organisée.
Dans le cadre de sa réforme du collège, Najat Vallaud-Belkacem a également annoncé la quasi-fin des classes bilangues qui avaient été créées, en 2005, afin de permettre aux élèves d’étudier deux langues vivantes dès la sixième, ainsi que la suppression des classes européennes où l’apprentissage de ces mêmes langues est intensif. En cause, le caractère minoritaire (traduire « élitiste ») de ces filières. Désormais, tous les élèves aborderont la deuxième langue en cinquième, et non plus une minorité en sixième et le plus grand nombre en quatrième. Alors que seulement 6,5 % des collégiens de sixième choisissent l’allemand en première langue et 14,6 % en deuxième langue (en quatrième), les adversaires de la réforme, essentiellement les germanistes, montrent, statistiques à l’appui, que les classes bilangues anglais-allemand ont permis d’augmenter significativement les effectifs des collégiens apprenant l’allemand, soit 11 % des élèves de sixième. Ancien Premier ministre et ancien professeur d’allemand, le socialiste Jean-Marc Ayrault s’est fendu d’une lettre ouverte à Najat Vallaud-Belkacem dans laquelle il lance un avertissement : « La réforme du collège aura pour conséquence la disparition de nombreuses classes bilangues (…) qui ont permis à l’allemand de rester la troisième langue vivante enseignée en France », enseignement qui se situe « au coeur de la coopération franco-allemande. » La soixantaine de députés du groupe d’amitié France-Allemagne ont de même pris position contre la réforme, tandis que l’ambassadeur d’Allemagne en France, Suzanne Wasum-Rainrer, discrètement missionnée par Angela Merkel, a demandé un rendez-vous à Najat Vallaud-Belkacem, afin d’obtenir des éclaircissements sur un projet dans lequel Berlin discerne une partielle remise en cause d’accords franco-allemands datant du traité de l’Elysée de 1963. La ministre assure que son « ambition » est de « développer » l’allemand, au prétexte que le nombre de postes de professeurs mis au concours a augmenté, et que les classes bilangues seront maintenues pour les élèves ayant commencé l’allemand en primaire. Malheureusement, rétorquent les adversaires de la réforme, les professeurs des écoles susceptibles d’enseigner l’allemand sont rarissimes.
La question des programmes d’histoire a ouvert une troisième polémique, mais le sujet ne tient pas à la réforme du collège. Ce n’est pas le ministère mais le Conseil supérieur des programmes (CSP), instance indépendante instituée par la loi de 2013 et composée d’experts, d’enseignants et de parlementaires de gauche comme de droite, qui a rendu publics, le 13 avril, ses projets de programme. Des programmes sur lesquels les enseignants sont amenés à donner leur avis au cours d’une consultation qui a commencé le 11 mai et s’achèvera le 12 juin. Dès la mi-avril, Le Figaro avait relevé « les perles de la «novlangue» pédagogiste » dans les programmes d’éducation physique et sportive qui nomment une piscine « un milieu aquatique profond standardisé » et où courir se dit « créer de la vitesse ». Mais au même moment, les boucliers se levaient contre les nouveaux programmes d’histoire, la contestation étant soutenue par des historiens prestigieux, pourtant pas tous de la même tendance politique, de Patrice Gueniffey à Pierre Nora.
Najat Vallaud-Belkacem a tenté de calmer le jeu en soulignant que les programmes n’étaient qu’un projet. Il convient certes d’être prudent en attendant d’avoir de ceux-ci une vision définitive, mais nul ne s’attend à ce que l’architecture générale prévue par le Conseil supérieur des programmes soit radicalement modifiée. Il importe, à cet égard, de saisir une subtilité qui donne toute son importance à une question apparemment technique. Le CSP, en effet, afin de simplifier un enseignement d’histoire au contenu jugé encyclopédique, a décidé de laisser aux professeurs une part de liberté. Le programme proposé pour les collèges distingue par conséquent des intitulés « obligatoirement étudiés » et d’autres « traités au choix de l’enseignant ». C’est ici que le bât blesse car la répartition entre ce qui est obligatoire et ce qui est optionnel trahit les arrière-pensées – conscientes ou inconscientes, explicites ou implicites – des concepteurs des programmes.
En cinquième, par exemple, les élèves étudient obligatoirement l’apparition et l’expansion de l’islam, tout comme ils le font en sixième avec les débuts du judaïsme et du christianisme. Sur ce point, rien n’a changé par rapport aux anciens programmes. Toutefois la chrétienté médiévale, qui a marqué une civilisation et une culture, n’est pas enseignée comme telle dans un ensemble obligatoire : cette réalité historique est tronçonnée à travers plusieurs thèmes, dont certains sont facultatifs. Sous le titre général « Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident chrétien », seule est ainsi obligatoire le sous-thème « La construction du royaume de France et l’affirmation du pouvoir royal », alors que sont au choix de l’enseignant les sous-thèmes « Une société rurale encadrée par l’Eglise » et/ou « Essor des villes et éducation ».
« Dans ces programmes, commente Sylvain Gouguenheim, professeur d’histoire médiévale à l’Ecole normale supérieure de Lyon, on voit l’islam comme religion, ce qui est nécessaire ; on le voit comme civilisation, ce qui est justifié. Mais on restreint le christianisme, même pas à une religion – dont la présentation, il est vrai, est faite en classe de sixième – mais à l’Eglise et on restreint l’Eglise à son rôle d’encadrement social des campagnes. Il n’existe donc pas de civilisation médiévale chrétienne ? Où sont les cathédrales gothiques ? L’intitulé du thème «Société, Eglise et pouvoir» est d’ailleurs révélateur : il évoque un monde où l’Eglise, servant d’articulation entre le pouvoir et la société, est une force d’encadrement social. Ce qui n’est pas faux, mais réducteur, car le rôle de l’Eglise ne se limitait pas à cela. On oublie la foi, les pèlerinages, l’art. »
Par ailleurs, si la naissance de l’islam entre dans un module obligatoire, l’enseignant doit choisir un seul des deux autres sous-thèmes : « Empires byzantin et carolingien » ou « Routes de commerce ». « L’islam, poursuit Sylvain Gouguenheim, est-il plus important dans l’histoire de l’Europe que l’Empire carolingien ou que Byzance ? » En outre, étudier la Méditerranée comme « foyer d’échanges et de cultures », selon l’intitulé d’un thème obligatoire, pose un double problème sur le plan de la connaissance historique. D’une part, c’est passer sous silence ce qui contredit cette image irénique des relations entre l’Occident et l’Orient : les croisades et le djihad, la piraterie et l’esclavage, réalités réciproques, car s’il y eut des musulmans réduits à l’esclavage par des chrétiens, il y eut aussi des milliers d’esclaves chrétiens chez les musulmans. « Cette vision idyllique a-t-elle pour but d’apaiser les tensions actuelles dans la société française ? » demande Gouguenheim. Qui ajoute cette ultime critique : « N’y a-t-il donc pas d’autres espaces que la Méditerranée ? La Hanse ? L’Europe centrale avec l’Empire allemand ? S’il existe au Moyen Age une structure politique impressionnante, c’est bien l’Empire germanique. A l’heure où l’on veut faire l’Europe, se focaliser sur sa frange méditerranéenne est curieux. »
Concernant une autre période de l’Histoire, les critiques se sont étonnés que les traites négrières, page honteuse de l’Occident, mais dont le rôle historique n’a pas été central, soient abordées dans un module obligatoire (qu’en est-il, à ce propos, de la traite interafricaine et de la traite musulmane ?), tandis que l’examen de la Réforme ou des Lumières, qui sont au coeur de notre histoire, sont abandonnées au choix de l’enseignant. « Les thèmes qui entrent en résonance avec les préoccupations actuelles, affirmait Patrice Gueniffey, le 27 avril, au site Figaro Vox, obtiennent une place disproportionnée, mais en vérité il s’agit plutôt de morale que d’histoire. »
« Une nouvelle étape de la décomposition des programmes d’histoire engagée depuis une dizaine d’années » : ainsi Gueniffey, spécialiste de la Révolution et de l’Empire, qualifie-t-il la réforme Vallaud-Belkacem. Cela fait longtemps, en effet, que l’enseignement de l’histoire divague sous l’effet de préjugés de nature idéologique et de présupposés pédagogiques absurdes appuyés sur un langage jargonnant. Faut-il rappeler que les précédents programmes du collège, adoptés en 2008, alors que la droite était au pouvoir, étaient peu ou prou de la même eau que ceux qui déclenchent un débat aujourd’hui ? Ainsi le renoncement à la chronologie n’est-il pas nouveau, en dépit du discours officiel qui prétend que celle-ci a été rétablie : depuis vingt ou trente ans, des programmes ratifiés par des ministres de droite comme de gauche font faire aux élèves des impasses sur des périodes entières de l’Histoire, les promenant d’une époque à l’autre, d’une civilisation à l’autre, les empêchant d’avoir un regard continu et construit sur le passé. On n’ose pas parler des grands hommes qui ont agi sur leurs temps, eux aussi absents des programmes depuis des décennies, au prétexte de faire de l’histoire sociale et thématique, une histoire pour qui le mot « héros » semble inconvenant.
La réforme Vallaud-Belkacem, par conséquent, ne fait qu’achever le délabrement d’une matière qui fut pourtant une fierté du système scolaire et universitaire français. Mais elle le fait sur un mode aigu, que ne dissimule pas le joli sourire de la ministre socialiste. Jean-Christian Petitfils, historien de l’Ancien Régime, porte du coup un jugement sans pitié : « Ce programme agit comme un désherbant. Il s’agit d’éradiquer les trois grandes racines de l’histoire de France : la chrétienté médiévale, l’humanisme de la Renaissance et les Lumières. Il faut tuer Saint Louis, Rabelais et Voltaire pour déconstruire notre passé. Tout cela pour satisfaire une vision moraliste et communautariste de l’Histoire, reflétant le pluralisme culturel actuel qui favorise l’étude de l’islam au détriment de notre héritage chrétien – les élèves en sauront plus sur la grande mosquée des Omeyyades que sur la cathédrale de Reims -, l’étude de l’esclavage, de la condition féminine. C’est une vision bobo de l’histoire de France qui évacue les guerres et tout le tragique pour se focaliser sur l’anticolonialisme permanent et la repentance généralisée. » Et Petitfils de conclure : « Najat Vallaud-Belkacem est, avec Vincent Peillon, un des ministres les plus idéologues que nous ayons eus sous la Ve République. »
En vérité, si la querelle autour des programmes d’histoire du collège prend un tel relief, c’est qu’elle concentre une multiplicité de débats qui touchent aux fondements de notre société. En premier lieu celui qui concerne la fonction de l’école. Est-elle – ce qui était la conception traditionnelle – un lieu de transmission du savoir, dans un rapport hiérarchique évident entre le maître qui détient le savoir et l’élève à qui il le transmet, et qui ne craint pas de sélectionner les meilleurs, à quelque milieu social qu’ils appartiennent, pour leur permettre de monter plus haut ? Ou l’école est-elle – selon la conception pédagogiste post-68 – une institution destinée à assurer l’égalité entre tous les élèves, ou du moins à le faire croire, élèves auxquels il faut éviter la contrainte et l’ennui et auxquels le contenu de l’enseignement doit s’adapter afin d’éviter que la machine scolaire reproduise la dichotomie entre les boursiers et ceux que le sociologue marxiste Pierre Bourdieu nommait « les héritiers » ? La défiance à l’égard des classes de latin ou d’allemand aux trop bons élèves a tout, chez certains, d’un réflexe idéologique antibourgeois, d’autant plus absurde qu’il est prouvé que les langues anciennes ou la langue de Goethe peuvent servir d’ascenseur social pour des jeunes issus de quartiers défavorisés. Mais la logique socialiste, on le sait, préfère le nivellement par le bas. « L’antiélitisme en matière scolaire provoque des dégâts irréparables », rappelait récemment Alain Finkielkraut…
L’autre débat souterrain qui court derrière cette querelle scolaire concerne l’identité même de notre société. Faut-il, au nom de l’Europe et de la mondialisation, occulter ou diluer le facteur national français dans l’explication de l’Histoire ? Quand Michel Lussault, le président du Conseil supérieur des programmes, soutient que les critiques à l’égard du projet dont il a accouché émanent de « gens mal intentionnés qui font une lecture idéologique de l’Histoire », mais qu’il affirme de son côté que le rôle d’un programme d’histoire n’est pas de « faire réciter aux jeunes le roman national, le petit doigt sur la couture du pantalon » (Les Echos, 4 mai), n’est-ce pas lui qui cède à l’idéologie ?
Pierre Nora observe que la France, dans les années 70 et 80, a subi une rupture qui l’a fait passer d’un modèle de « nation paysanne, chrétienne, étatiste, souveraine », à un autre « qui se cherche dans la douleur », et que la forte immigration que notre pays a connu depuis « n’est pas l’élément principal de la crise, mais en est un accélérateur » (Le Journal du Dimanche, 3 mai). D’où des questionnements qui ont récemment assuré le succès, entre autres, des livres d’Eric Zemmour ou de Michel Houellebecq. Pierre Nora – qu’on aura du mal à taxer de nostalgie vichyste – souligne ainsi que l’absence d’orientation intellectuelle et politique des programmes scolaires d’histoire reflète « la crise identitaire que traverse la France, une des plus graves de son histoire », l’académicien y percevant « l’expression d’une France fatiguée d’être elle-même, d’un pays qui ne sait pas trop où il va et ne sait donc pas dire d’où il vient ».
Jean-Christian Petitfils accuse l’inspiration des nouveaux programmes d’être « contraire à l’esprit du 11 janvier qui était un sursaut national pour la défense des valeurs et de l’identité française contre les barbaries venues d’ailleurs ». En fait, pour apprendre correctement aux enfants la totalité de notre histoire, avec ses pages de gloire et pas seulement ses heures sombres, il faut aimer notre passé. Mais qui n’aime pas son passé ne s’aime pas soi-même, et qui ne s’aime pas soi-même est mal armé pour affronter l’avenir.
Jean Sévillia