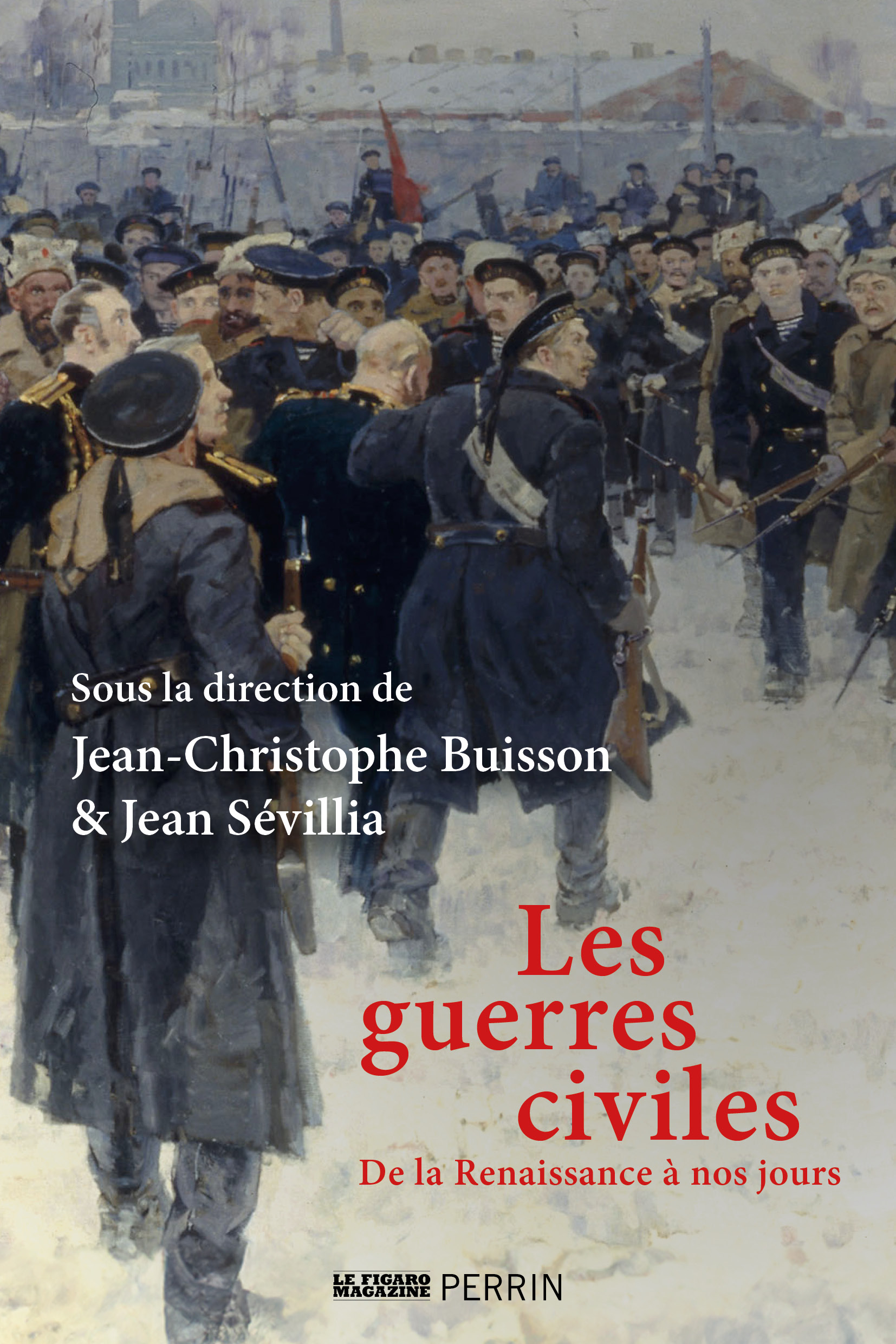Petite histoire de l’historiquement correct.
La polémique aura duré plus de trois ans. Elle n’est sans doute pas terminée, mais le projet de la maison de l’Histoire de France semble, désormais, engagé de façon irréversible. Bien que guère réputé pour son goût du passé et sa culture historique, Nicolas Sarkozy demandait, peu après son élection à la présidence de la République, en 2007, la création d’un « centre de recherche et de collections permanentes dédié à l’histoire civile et militaire de la France ». Des rapports étaient commandés à Hervé Lemoine, un conservateur du patrimoine, puis à Jean- Pierre Rioux, un spécialiste du XXe siècle, qui posaient les bases du concept. En 2010, alors que divers sites avaient été envisagés pour la future institution (les Invalides, l’île Seguin, le château de Vincennes, le palais de Fontainebleau…), il était annoncé que la maison de l’Histoire de France – tel est l’intitulé finalement retenu – verrait, en définitive, le jour en plein cœur du Marais, à Paris, sur le site actuel des Archives nationales, occupé par les hôtels de Soubise et de Rohan. Son ouverture est prévue en 2015.
Pourtant, un musée de l’Histoire de France existe déjà bel et bien. Et ce, depuis… 1867. Qui plus est, il est installé, depuis cette date, à l’hôtel de Soubise, parmi ces Archives nationales dont il présente au public une sélection aussi émouvante que pédagogique, illustrant, à travers les documents originaux exposés, quinze siècles de notre histoire. Un lieu véritablement magique, propre à éveiller en chaque visiteur l’amour du passé. Alors, pourquoi ce nouveau projet ? Quel objectif poursuivra-t-il ? Selon Jean- Pierre Rioux, il s’agit d’une « initiative républicaine », qui « exposera un panorama de notre histoire » et « valorisera et diffusera la recherche, y compris sur des questions taboues comme celle de la nation, de la patrie ».
Selon ses détracteurs, ce projet représenterait une « régression ». En premier lieu, parce que l’Etat n’aurait aucun rôle à jouer en matière d’histoire. En deuxième lieu, parce que conçu autour de l’idée de nation, ce nouveau musée instrumentaliserait à des fins politiques la notion d’« identité nationale » que Nicolas Sarkozy tenta de remettre au goût du jour en lançant sur ce sujet, à la fin de 2009, un débat qui tourna court.
Qu’il n’appartienne pas à l’Etat de décréter quelle est la vérité historique, c’est l’évidence. Les diatribes contre « l’histoire officielle » ont ceci d’hypocrite, cependant, qu’elles ignorent – ou feignent d’ignorer – qu’il a toujours existé une histoire officielle, en France, des origines du pays à nos jours. Soit de manière active, quand l’Etat diffusait consciemment une certaine vision du passé dans le but de légitimer son pouvoir. Soit de manière passive, quand l’Etat laissait s’installer dans ses rouages des réseaux décidés à utiliser leur position institutionnelle pour imposer une certaine interprétation de l’histoire, version devenue officielle à force d’être dominante. C’est dans ce dernier cas de figure que nous nous trouvons depuis de nombreuses décennies.
A l’échelle du temps, l’Histoire est une science récente. Oubliant Hérodote et Thucydide, le Moyen Age mêle la réalité et la fiction dans la relation du passé, amalgamant les personnages authentiques et les héros de la mythologie. La chronique historique est une mise en abyme de la parole divine : à travers la chrétienté, l’Histoire sainte se prolonge. A l’approche de l’an mil, on commence à écrire l’histoire des Francs (496, le baptême de Clovis), qui devient peu à peu l’histoire de France, parce que les moines de Saint-Denis, au XIIe siècle, épousent le dessein des rois capétiens, qui aspirent à relier leur couronne aux dynasties précédentes. A ces Francs sont attribuées des origines imaginaires, situées jusqu’à Troie.
Au Grand Siècle, du mythe troyen à l’héritage gaulois, le récit historique ne sort toujours pas du champ mythologique. La mise en scène, toutefois, vise bien à écrire la chronique de la nation. Significativement, au moment où l’on peut parler d’histoire de France, se précise également la géographie du pays : l’espace national répond à une définition (« le pré carré ») et à des limites mesurées et cartographiées, puis matérialisées par Vauban. Voulant faire table rase du passé « féodal » et liquider l’héritage chrétien de la France, la Révolution fait néanmoins appel à l’histoire, prétendant prendre exemple sur la République romaine et son culte de la « vertu ». Napoléon, lui, joue sur tous les tableaux, ses thuriféraires patentés ne craignant pas de le comparer à Alexandre le Grand.
Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que, avec Mabillon et les moines mauristes, l’Histoire entre dans l’ère scientifique, en se fondant sur l’étude des preuves et des documents. Cette mutation met toutefois cent ans à entrer dans les faits. Au XIXe siècle, le genre historique est écrasé par l’héritage révolutionnaire, l’Histoire se donnant pour but soit de justifier la Révolution, comme chez Michelet, soit de la critiquer, comme chez Taine.
En ayant érigé l’université en organisme d’Etat, le Premier Empire a introduit l’enjeu politique dans l’enseignement de l’Histoire : l’attribution des grandes chaires de la Sorbonne devient un indicateur de la tendance qui prévaut dans les cercles du pouvoir. C’est vrai sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet ou sous Napoléon III, mais plus encore sous la IIIe République. Jules Ferry, tout particulièrement, assigne une mission à l’école publique, désormais laïque : éradiquer les traces de l’Ancien Régime dans les mentalités populaires, convaincre des bienfaits du nouveau régime, détacher les Français de l’influence de l’Eglise. Mais c’est aussi pendant cette période que s’élabore le discours national-républicain, celui qui s’exprime dans le Petit Lavisse et qui sera pratiquement la version officielle de l’histoire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Ce roman national a ses limites, car il fait tourner l’histoire de France autour de la Révolution de 1789, conçue comme un événement eschatologique. Il possède cependant le mérite de fournir un cadre interprétatif cohérent du passé, aisément compréhensible par les enfants à qui l’on donne des dates à connaître par cœur et des figures à admirer : tout petit Français, quelle que soit son origine géographique, sociale ou religieuse, est ainsi incité à considérer Vercingétorix comme un de ses lointains aïeux. C’est un mythe, mais un mythe unificateur.
Après-guerre, cette version de l’histoire va voler en éclats, selon un processus étalé dans le temps, avec des décalages entre l’histoire savante et les programmes scolaires, entre la recherche et la vulgate médiatique, et sous l’effet d’évolutions idéologiques successives, parfois contradictoires, mais conduisant au même résultat : la remise en cause d’un passé national qui, non seulement n’est plus glorifié, mais se trouve mis au banc des accusés.
Première évolution, d’ordre historiographique, l’arrivée en force de l’histoire économique et sociale, sous l’influence de l’école des Annales, fondée avant-guerre par Marc Bloch et Lucien Febvre. Fortement marxiste au départ, cette école se diversifie ensuite en courants et sous-courants, pas tous adeptes de la lutte des classes comme grille d’analyse historique : certains privilégient même le jeu des mentalités et des représentations comme facteur explicatif du passé. Mais dans tous les cas, l’histoire économique et sociale comme l’histoire des mentalités ont pour conséquence de dévaluer l’événement au profit des structures sociales ou mentales. Les années 1950 signent ainsi la fin de l’« histoire-bataille ». Il faudra une bonne trentaine d’années pour que des chercheurs issus des Annales et devenus des pontes (Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff…), sans renier les apports de l’analyse économique et sociale, reviennent à l’histoire événementielle ou à la biographie.
La seconde évolution est d’ordre sociopolitique. Si, en France, les enseignants penchent à gauche depuis toujours, la tendance s’accentue à partir des années 1960, d’autant que la Ve République naissante a fait le choix d’abandonner à l’opposition les domaines de la culture et de l’éducation. Le corps professoral, dès lors, sert de caisse de résonance aux idéologies de l’époque : antifascisme, marxisme-léninisme, maoïsme, castrisme, anticolonialisme, tiers-mondisme…
Troisième évolution : après Mai-68 – mouvement pour l’essentiel d’essence individualiste et libertaire qui ébranlera le pouvoir gaulliste, mais aussi la toute-puissance du Parti communiste – et après l’écrasement du Printemps de Prague par les Russes, le modèle soviétique, déjà ébranlé en 1956, pâlit de plus en plus, jusqu’à s’effondrer en 1989. Le désenchantement face aux grandes idéologies messianiques et séculières impose un nouveau paradigme dans l’univers des idées : l’individu. L’échelle des valeurs se déplaçant, les références intellectuelles et morales vont désormais être les droits de l’homme, le multiculturalisme, l’antiracisme. Et la corporation des historiens, reflétant l’air du temps, va épouser cette évolution.
D’où le phénomène de l’« historiquement correct », qui est un alignement de l’Histoire sur les oukases du « politiquement correct ». Défiant sciemment les lois de la science historique, cette tendance manie allègrement l’anachronisme en jugeant le passé selon les critères du présent : l’Inquisition ou les guerres de Religion, par exemple, sont analysées au nom de la liberté religieuse et de la liberté de conscience, concepts inconnus au Moyen Age comme au XVIe siècle. L’« historiquement correct » pratique ensuite le mensonge par omission : les Croisades sont ainsi vilipendées comme une agression contre le monde musulman, sans que soit rappelé que le but de la première d’entre elles était de rétablir la liberté pour les chrétiens de se rendre sur les Lieux saints, liberté qui leur avait été confisquée par les Turcs.
L’« historiquement correct » se caractérise donc par le manichéisme. Alors que l’historien doit normalement tout situer dans un contexte et mesurer le poids subtil des nuances et des circonstances, la complexité de l’Histoire se trouve ainsi gommée, réduite à l’affrontement binaire du bien et du mal et, qui plus est, un bien et un mal réinterprétés selon les codes contemporains : l’analyse de la colonisation ou des années d’Occupation en fournissent les exemples les plus patents. Dès lors, l’Histoire constitue un champ d’exorcisme permanent : plus les forces obscures du passé sont « anathématisées », plus il faut se justifier de n’entretenir avec elles aucune solidarité. Au nom de l’« historiquement correct », des personnages, des sociétés et des périodes entières sont ainsi diabolisés.
Ces derniers temps, de multiples cris d’alarme sont lancés au sujet de l’enseignement de l’histoire. Pour expliquer son effondrement, des causes d’ordre technique sont avancées qui ont toutes leur pertinence : diminution des horaires à l’école primaire comme dans le secondaire, absurdité des orientations pédagogiques opérées depuis trente ans – telle l’abandon de toute chronologie –, recul de la lecture, avec le réflexe zapping suscité par Internet. Tous ces facteurs ont leur importance, mais ne représentent qu’une partie de la question. Car la crise de l’Histoire déborde largement du monde de l’enseignement pour devenir un problème général de notre société, avec ses incidences politiques et culturelles.
En réalité, plus que d’une crise de l’Histoire, il s’agit d’une crise du lien social, d’une crise de la citoyenneté. Un citoyen est l’héritier d’un passé plus ou moins mythifié, mais qu’il fait sien. Jusqu’aux années 1960, on apprenait aux Français l’histoire de la France et des civilisations qui avaient marqué sa culture. Sous l’influence des évolutions évoquées plus haut, le rapport au passé revêt désormais d’autres contours.
Décolonisation, déchristianisation, immigration, mondialisation, relativisme des valeurs : sous les coups de boutoir de ces bouleversements successifs, la France, partie d’un modèle stato-national plaqué sur un vieux pays catholique, bascule dans un autre type de société, mais qui peine à se définir, ainsi qu’en témoigne la crise de nerfs qui a accompagné, il y a quinze mois, le débat sur l’identité nationale.
Il n’est nullement étonnant, dès lors, que les programmes scolaires, au collège, passent Clovis et Louis XIV à la trappe, tout en préconisant, au nom de l’« ouverture aux autres cultures », des cours sur la Chine des Han, l’Inde des Gupta ou l’empire africain du Monomotapa. Ce qui est tout simplement occulté, c’est que la première condition pour s’ouvrir aux autres est de se bien connaître soi-même, de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.
Or, c’est précisément ce que demandent les Français, qui plébiscitent ce qui a trait au passé français. Il n’est qu’à voir le succès des spectacles historiques, la passion pour les musées d’histoire, l’engouement pour la généalogie, ou le triomphe des Journées du patrimoine. L’Histoire va mal, mais tout prouve que nos contemporains aiment savoir de qui ils descendent. Pour soigner la crise de l’Histoire, il ne faudra donc pas seulement des circulaires ministérielles, mais aller au fond du problème. Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où voulons-nous aller ? Ce sont des questions éminemment politiques : l’Histoire n’appartient pas aux seuls spécialistes.
Jean Sévillia