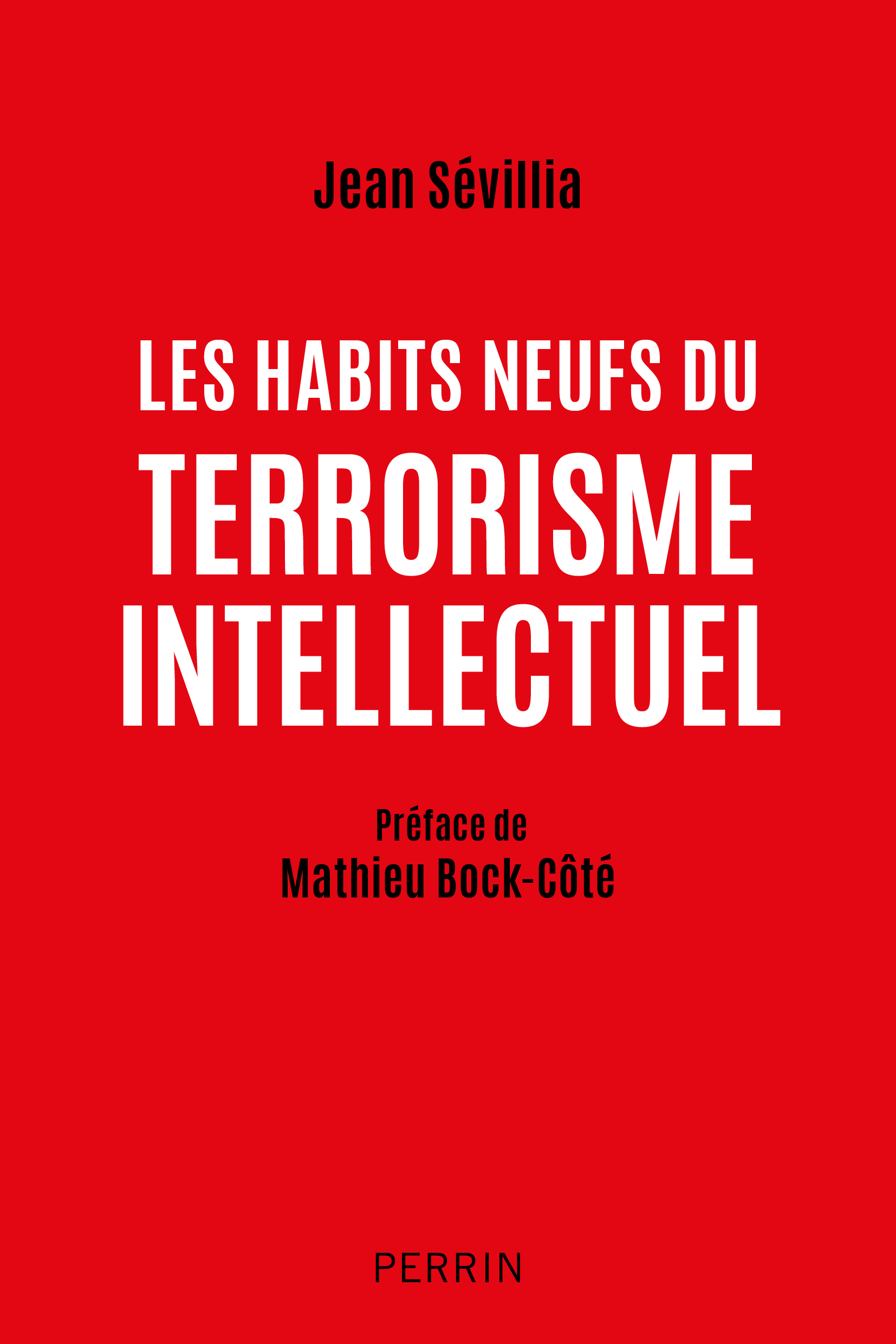Il y a cent ans, le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et sa femme étaient assassinés à Sarajevo par un jeune révolutionnaire serbe. L’occasion de démonter les idées reçues circulant sur ce drame qui fut l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale.
1 L’assassinat de François-Ferdinand était inévitable. En fait, c’est le contraire : la réussite de cet attentat est le fruit d’une succession de coïncidences et de hasards malheureux. Maladroitement organisés, guère discrets dans leurs préparatifs, surveillés par la police autrichienne qui possède un vaste réseau d’espions (dont le père d’un des conjurés !), les sept Serbes qui ont organisé l’opération auraient pu se faire arrêter plusieurs fois avant de se retrouver mi-juin dans la capitale de la Bosnie, où l’archiduc François-Ferdinand vient superviser des manoeuvres militaires. Ils n’ont aucun plan d’action précis le matin du 28 juin 1914. Ils savent à peine se servir des revolvers et des petites bombes carrées qu’ils portent sur eux et qu’ils ont miraculeusement pu faire venir de Serbie. Agés de 17 à 28 ans, ils n’ont aucune expérience des combats ou de la lutte armée et redoutent d’avoir à tuer. Lorsque la Gräf und Stift noire dans laquelle a pris place le couple impérial passe devant eux, sur le quai Appel le long duquel ils sont disposés, ils sont quatre à rester immobiles, tétanisés, morts de peur, et à ne rien tenter (lors de leur procès, ils prétexteront qui une mauvaise vue, qui la peur de toucher des innocents). C’est Nedeljko Cabrinovic, posté du côté de la rivière Miljacka, qui, finalement, envoie son engin de mort sur le cortège, mais seulement trois secondes après l’avoir décapsulé en le cognant contre un mur. Conséquence : n’explosant que près de dix secondes plus tard, la bombe endommage le véhicule qui suit celui de François-Ferdinand, faisant neuf blessés dont sept spectateurs et deux membres du service de sécurité de l’archiduc. Après cette première attaque, le neveu de l’empereur François-Joseph rejoint l’hôtel de ville de Sarajevo où toutes les options sont envisagées : annuler la suite de la visite, déployer de nouvelles troupes de protection, évacuer les rues alentour. François-Ferdinand n’en retient aucune et annonce qu’il veut continuer sa visite, mais après être allé à l’hôpital de la ville prendre des nouvelles de son aide de camp blessé (le lieutenant-colonel Merizzi). Par sécurité, un homme se poste sur le marchepied du côté gauche de la voiture (côté rivière, puisque c’est de là qu’est venue la bombe tantôt), mais on néglige d’ajouter au convoi une escorte à cheval et de replier la capote du « landau » (il fait ce jour-là un soleil éclatant). Pire : on oublie de prévenir le chauffeur du changement d’itinéraire. Raison pour laquelle l’homme va tourner à droite devant le magasin Moritz Schiller, dans l’axe du pont Latin, au lieu de poursuivre sa route sur le quai Appel. Quand on l’informe de son erreur, il s’arrête pour enclencher une marche arrière… et s’immobilise exactement devant Gavrilo Princip qui, après avoir hésité à fuir après l’échec de son complice Cabrinovic, erre dans le quartier. Le couple princier se trouve à deux mètres du jeune Serbe âgé de 17 ans et onze mois et demi. Il n’y a aucun obstacle entre eux : c’est le côté droit de la voiture qui est devant lui… Il tire au jugé deux balles. La première se loge dans la veine jugulaire de l’archiduc, la seconde dans l’artère de l’estomac de Sophie Chotek. Elles seront toutes les deux mortelles.
2 Le gouvernement autrichien était au courant des projets d’attentat et a laissé faire. Quelques jours avant son départ pour Sarajevo, François-Ferdinand avait confié à son aide de camp, le comte Harrach, qui sera le témoin direct de l’attentat : « Ça ne m’étonnerait pas que quelques balles serbes m’attendent là-bas. » Depuis l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche, en 1908, des attentats avaient été planifiés ou exécutés contre des représentants de l’empire des Habsbourg, mais aucun n’avait réussi. L’ambassadeur de Serbie à Vienne, Jovan Jovanovic, affirmera avoir manifesté devant le comte Leon von Bilinski, ministre des Finances de l’Autriche-Hongrie et gouverneur de Bosnie-Herzégovine, la crainte que la vie de François-Ferdinand ne soit menacée lors de sa visite à Sarajevo. De fait, les rapports de police signalaient des tracts et des graffitis hostiles à la venue de l’archiduc-héritier dans la capitale bosniaque, et une certaine agitation dans les cercles nationalistes ou révolutionnaires.
Mais François-Ferdinand, confiant dans l’organisation de sa sécurité par le général Potiorek, le gouverneur militaire, et soucieux de ne pas paraître reculer par peur, avait tenu à maintenir son voyage. Il était néanmoins parti avec une certaine inquiétude. Dès le mois de mai, recevant à Vienne l’archiduc Charles, son neveu et successeur dans l’ordre dynastique, et son épouse l’archiduchesse Zita, qui le racontera beaucoup plus tard, il avait exprimé un pressentiment : il allait mourir prochainement. Alors que le chef de sa chancellerie militaire, le colonel Bardolff, l’invitait à prendre garde à Sarajevo, l’archiduc avait répliqué : « Que voulez-vous, nous sommes en permanence en danger de mort. On doit faire confiance à Dieu. » Un arrêt de la Providence avait-il décidé que la vie terrestre de François-Ferdinand d’Autriche s’arrêterait le 28 juin 1914 ?
3 L’Empire austro-hongrois cherchait un prétexte pour entrer en guerre. En 1908, l’annexion de la Bosnie et de l’Herzégovine, anciennes provinces ottomanes confiées à l’administration de l’Autriche en 1878, avait déclenché une crise européenne dont Vienne avait dominé les effets : la Russie, la Serbie et l’Italie s’étaient inclinées. Depuis, l’Autriche cherche surtout à maintenir le statu quo, qui lui est favorable, alors même que les positions de la double monarchie se dégradent à l’issue des guerres balkaniques, qui se sont achevées sur la victoire et l’agrandissement de la Serbie. La politique extérieure de l’Autriche est du ressort de l’empereur, qui nomme des ministres des Affaires étrangères (Aehrental jusqu’en 1912, puis Berchtold) partageant ses vues. Or les perspectives de François-Joseph sont d’autant plus attachées à la paix que le souverain est conscient des fragilités internes de son empire, devinant qu’un conflit européen pourrait le faire éclater. En 1911, le général Conrad, le chef d’état-major des armées austro-hongroises, veut une guerre préventive. François-Joseph le désavoue : « Ma politique est une politique de paix. C’est dans cet esprit que mon ministre des Affaires étrangères conduit ma politique. » Et l’ultrabelliciste général Conrad est obligé de quitter son poste… Jusqu’en 1914, l’empereur d’Autriche ne changera pas d’orientation.
4 François-Ferdinand était un va-t-en guerre. François-Ferdinand, une personnalité violente, comme le prouvent ses manières brutales, son tempérament emporté et sa passion pour la chasse ? Cette légende noire, forgée par la propagande alliée pendant la Première Guerre mondiale, ne correspond pas à la vérité de l’histoire. Si l’archiduc-héritier n’a rien d’un pacifiste, s’il est fier d’être, à partir de 1913, l’inspecteur général des forces armées austro-hongroises, poste qui ferait de lui le commandant en chef en cas de guerre, il épouse totalement la politique de l’empereur. Très soucieux de l’avenir de la monarchie danubienne, puisqu’il en est l’héritier, François-Ferdinand est comme son oncle persuadé qu’un conflit européen serait fatal à l’Autriche-Hongrie. Il ne veut pas d’une guerre avec l’Italie. Il veut encore moins d’une guerre avec la Russie, pensant qu’une solidarité objective, comme au temps de la Sainte-Alliance, lie les Habsbourg et les Romanov contre les libéraux et les républicains du Vieux Continent. François-Ferdinand ne veut pas plus d’une guerre contre la Serbie, même s’il cherche à isoler diplomatiquement Belgrade. En premier lieu parce que ses projets de réforme intérieure de l’empire des Habsbourg visent à donner plus de place aux Slaves, et notamment aux Slaves du Sud, au détriment des Hongrois. Il doit rendre visite à Sarajevo le 28 juin, date où les Serbes commémorent chaque année la bataille du Champ des merles, leur défaite historique de 1389 devant les Turcs. Mais ni l’archiduc ni aucun responsable autrichien n’ont pensé au symbole malheureux d’une date vécue comme une provocation par les nationalistes serbes, alors qu’elle avait été choisie par hasard.
5 Le gouvernement serbe a organisé l’assassinat. Epuisée et presque ruinée par les deux Guerres balkaniques (1912-1913) qui lui ont permis de recouvrer notamment le Kosovo et une partie de la Macédoine, terres occupées par les Ottomans depuis plusieurs siècles, la Serbie n’a ni le désir ni les moyens financiers et militaires de se lancer dans un conflit contre la puissante Autriche-Hongrie. Tout Belgrade sait que de jeunes militants d’organisations nationalistes comme Défense nationale, La Main noire ou Jeune Bosnie rêvent d’en découdre et de libérer leurs frères de Bosnie (43 % de la population), mais le gouvernement, sans ignorer qu’elles existent, ne cautionne ni n’aide ces entreprises individuelles. Pour lui, la priorité est de « digérer » le retour des provinces du Sud dans le giron de la mère patrie : il sera bien temps, dans quelques années, d’envisager un rattachement des Slaves de Bosnie au jeune royaume de Serbie (indépendant depuis seulement 1878). A aucun moment, les conjurés du 28 juin n’entretiendront des relations avec des membres ou des proches du gouvernement dirigé par le radical Nikola Pasic. Leur seul contact – indirect – sera Dragutin Dimitrijevic, chef charismatique de la Main noire et responsable des services secrets serbes. Or, il n’est autre que l’ennemi juré du Premier ministre serbe, qui ne cesse de tenter de réduire son influence auprès de ses ministres : il est persuadé qu’« Apis » (ainsi surnommé en raison de son cou de taureau) envisage un coup d’Etat pour renverser la dynastie Karageorgevitch au profit d’une dictature nationaliste…
6 Les meurtriers étaient des nationalistes fanatiques qui rêvaient d’une Grande Serbie. Un seul nom suffit pour balayer cette assertion anachronique, développée après les guerres yougoslaves des années 90 : Mehmed Mehmedbasic. Ce musulman est un des sept hommes qui ont participé à l’attentat de Sarajevo. Son rêve, comme celui de ses compagnons, n’est pas d’agrandir le territoire serbe mais de débarrasser une région slave habitée par des Serbes, des Croates, des juifs et des musulmans de « l’occupant germanique ». Comme beaucoup d’adolescents déterminés de la région, Mehmedbasic a été formé par Vladimir Gacinovic, ami de Trotski et tête pensante des principales organisations serbes présentes en Bosnie. Dans l’idéologie improbable et confuse dont elles se réclament, on trouve un peu de romantisme allemand, de nihilisme russe, d’internationalisme et de patriotisme slave, saupoudrés de ce principe révolutionnaire très à la mode dans les Balkans et en Europe centrale depuis le milieu du XIXe siècle et qui a pour nom « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Une réalité à mettre en parallèle avec les affirmations aberrantes de l’historienne canadienne Margaret MacMillan, directrice du pourtant réputé St. Antony’s College d’Oxford : dans Vers la grande guerre (récemment publié aux éditions Autrement), elle ose écrire qu’« il est difficile de ne pas comparer les assassins (de François-Ferdinand) aux groupes extrémistes du fondamentalisme islamique comme al-Qaida un siècle après » ! Encore un effort et on dressera un jour un parallèle entre le roi Pierre Ier de Serbie et Benito Mussolini ou entre Gavrilo Princip et Andreas Baader…
7 L’entêtement de Belgrade et de Vienne a déclenché le processus conduisant à la guerre. Après l’attentat de Sarajevo, le gouvernement autrichien exige qu’une enquête soit menée pour déterminer toutes les responsabilités dans l’assassinat de François-Ferdinand. Personne n’imagine encore que l’événement qui s’est déroulé à Sarajevo soit synonyme d’une marche forcée vers un conflit international. Dans son livre très remarqué Les Somnambules (Flammarion), Christopher Clark assure que tous les pays sont coupables, à la même hauteur, de la glissade de l’Europe vers la guerre dans les semaines qui séparent l’attentat des premiers coups de canon, avant d’insister sur l’importance décisive et dramatique de l’orgueil serbe dans l’affaire. Une affirmation bien rapide. Dès le 29 juin 1914, Belgrade et Vienne multiplient les échanges diplomatiques et envisagent chacun de leur côté – discrètement, pour ne pas heurter leurs opinions respectives chauffées à blanc – les moyens d’une désescalade. Finalement, c’est plutôt l’annonce d’une mobilisation de l’armée russe (par solidarité avec son allié serbe) et l’action du lobby allemand militariste (poussant son allié autrichien vers une expédition punitive) qui accélèrent le mécanisme fatal. Même l’ultimatum adressé par Vienne à Belgrade, et dont le rejet provoquera directement l’assaut autrichien sur la Serbie, fut bien près d’être accepté par Pasic. Un seul article coinçait : celui prévoyant une enquête étrangère sur le territoire serbe pour mesurer l’implication du pays dans l’attentat. C’eût été un renoncement de la Serbie à sa souveraineté nationale. Quel pays l’aurait accepté ?
Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia