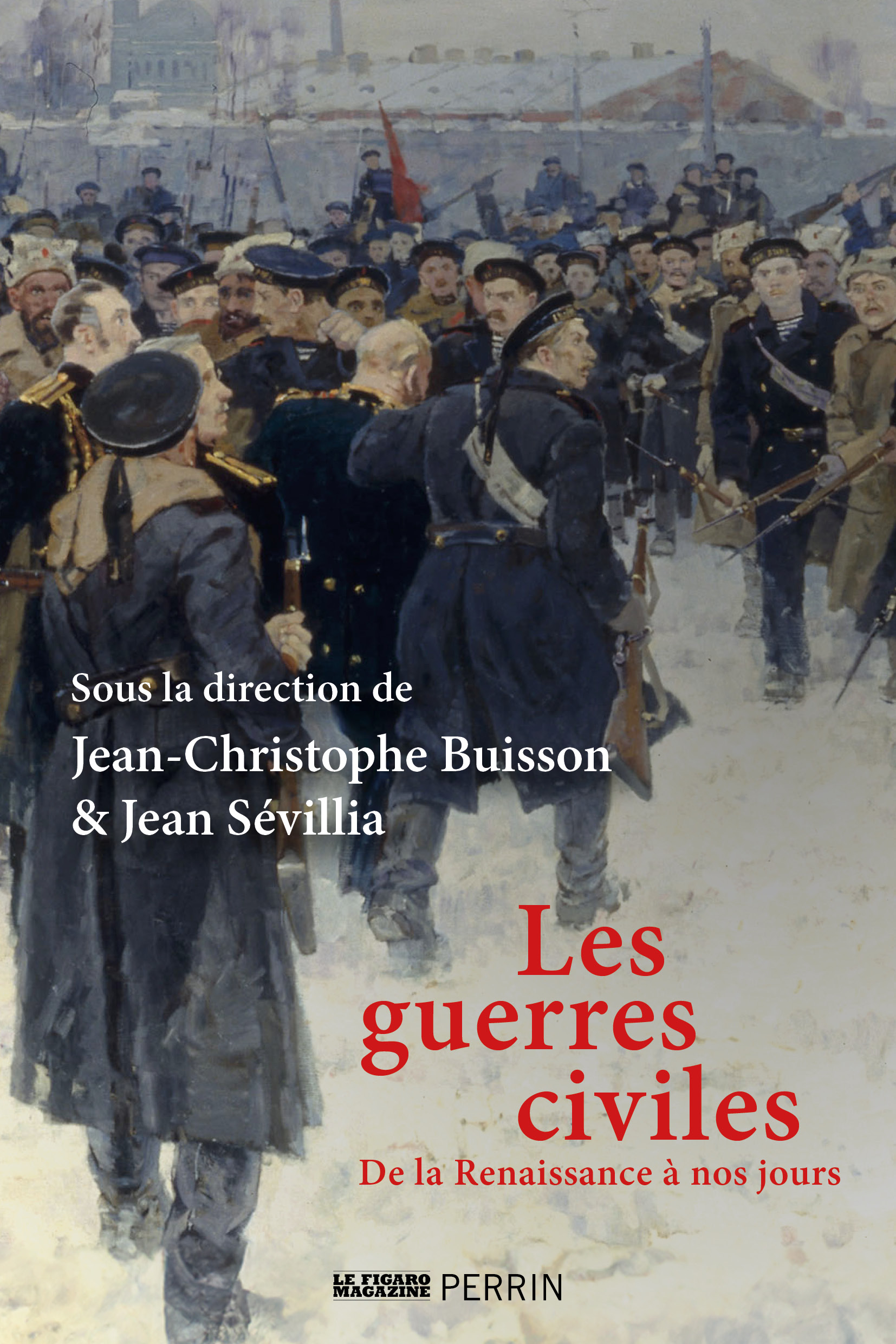Le Figaro Magazine, 9 mai 2025.
On fête le centenaire de la canonisation de sainte Thérèse de Lisieux, le 17 mai 1925. Dans la paisible cité normande, le souvenir de cette carmélite morte à 24 ans, décrétée docteur de l’Eglise en 1997, se trouve partout.
Combien sont-ils, agenouillés dans la pénombre, pendant qu’au dehors, le soleil inonde la Normandie ? Une vingtaine peut-être, mais quand une personne se lève et sort, une autre arrive. Nous sommes dans la chapelle du carmel de Lisieux, au pied de la châsse où, sous un gisant sculpté à l’effigie de sainte Thérèse, sont conservées ses reliques. Dans le silence, les gens prient. Ils ont tous les âges, appartiennent à toutes les couches de la société, et sont souvent venus de loin. Dans le mémorial qui jouxte la chapelle de ce monastère où Thérèse vécut de son entrée en religion à sa mort, visiteurs et pèlerins se pressent. Un groupe de Brésiliens déambule et médite devant vitrines et écrans qui montrent la vie au carmel, la porte de la cellule de sainte Thérèse, le carrelage sur lequel elle a marché, ses écrits, ses objets de piété.
On vient du monde entier pour vénérer cette religieuse morte à 24 ans, béatifiée en 1923 et canonisée en 1925, un quart de siècle après sa disparition. Le 17 mai prochain, Lisieux fêtera l’exact centenaire de cette canonisation avec un programme réparti sur trois journées : procession des reliques, vénération du reliquaire avec lecture de textes de Thérèse, messes, accueil costumé sur les lieux thérésiens, jeu de piste pour les enfants, projection de films, conférences, concert, etc. (1).
Née à Alençon en 1873, Thérèse Martin est la dernière d’une pieuse famille de neuf enfants. Quatre sont morts en bas âge, mais restent quatre autres filles : Marie, Pauline, Léonie et Céline. En 1877, la mère, Zélie Martin, meurt d’un cancer du sein. Premier choc pour Thérèse, qui choisit sa grande sœur Pauline comme seconde maman. Louis Martin, le père, ancien horloger qui vit de ses rentes, s’installe à Lisieux avec ses cinq filles, dans le but de se rapprocher de son beau-frère Isidore Guérin, pharmacien dans cette ville et subrogé tuteur de ses nièces. En 1882, Pauline Martin entre au carmel : deuxième choc affectif pour Thérèse. Deux ans plus tard, sa sœur Marie entre aussi au carmel. En 1887, à 15 ans, Thérèse fait part à son tour à son père de son intention d’entrer au carmel. Louis Martin donne son accord mais l’oncle Guérin refuse puis, se ravisant, acquiesce au projet de sa nièce. Cependant le supérieur du carmel s’y oppose en raison de l’âge de la jeune fille, tandis que l’évêque de Bayeux et Lisieux, sollicité, remet sa décision à plus tard. Peu après, Louis Martin emmène ses filles Céline et Thérèse en pèlerinage à Rome avec le diocèse de Coutances qui a obtenu une audience de Léon XIII. Dans un geste audacieux, la jeune Thérèse s’adresse directement au pape pour lui demander la permission d’entrer au couvent, mais reçoit une réponse qui la déçoit puisque le Saint-Père renvoie la décision aux supérieurs. L’évêque finira par consentir au vœu de Thérèse. Elle entre au carmel comme postulante en 1888, prend l’habit l’année suivante et prononce ses vœux définitifs en 1890, à l’âge de 17 ans, sous le nom de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face.
Louis Martin, atteint pendant ce temps d’une maladie mentale, a dû être interné à Caen. Après des phases de rémission, il mourra en 1894. Au carmel, Thérèse, qui aspire à devenir sainte, s’astreint à des exercices spirituels de plus en plus exigeants, abordés avec joie. Sa sœur Céline, qui est également entrée au carmel, a obtenu d’y apporter son appareil photo : c’est ainsi que le visage de Thérèse nous est si bien connu. Pauline, l’autre sœur, en religion Agnès de Jésus, élue prieure du carmel, demande à Thérèse de rédiger ses souvenirs d’enfance. En 1896, toutefois, les premiers symptômes de la tuberculose apparaissent chez elle. La religieuse qui se sait condamnée, obéissant à ses supérieures, prolonge l’écriture de ses souvenirs jusqu’à sa vie au monastère : « Mère bien-aimée, écrit-elle, vous voyez que je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses ». Elle s’éteint le 30 septembre 1897, à l’âge de 24 ans. « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie », avait-elle murmuré pendant son agonie.
Un an après sa mort était publié à 2000 exemplaires Histoire d’une âme, livre composé à partir de ses écrits racontant une vie cachée qui allait rayonner sur l’univers. L’ouvrage, aujourd’hui, s’est vendu à 500 millions d’exemplaires… Etonnant destin d’une religieuse issue d’une famille non moins étonnante puisque les cinq sœurs Martin sont entrées en religion – quatre au carmel et une dans l’ordre de la Visitation – et que leurs parents, Louis et Zélie, béatifiés en 2008, seront canonisés en 2015. En outre, Léonie, la visitandine (sœur Françoise-Thérèse), fait aussi l’objet d’un procès de béatification, ouvert en 2015.
Lisieux, où s’est déroulé l’essentiel de la vie de sainte Thérèse, accueillerait chaque année un million de visiteurs, ce qui en ferait le deuxième centre de pèlerinage de France après Lourdes. Recteur du sanctuaire depuis 2023, le père Emmanuel Schwab, qui a été curé à Paris, s’avoue incapable de confirmer ce chiffre. Il est toutefois certain d’une chose : la piété ou la fascination envers la petite carmélite ne faiblit pas. Aussi le travail ne manque-t-il pas pour l’équipe de 14 prêtres affectés à plein temps ou à temps partiel au sanctuaire de Lisieux. « Ma mission, explique le père Schwab, est d’accueillir les pèlerins sur les lieux où Thérèse a vécu, et de donner le goût de lire ses textes ».
Nous guidant à travers la ville, le prêtre nous emmène, après la chapelle du carmel, vers la cathédrale, édifice gothique miraculeusement épargné par les bombardements alliés de juin 1944. C’est ici que Thérèse, enfant, a fait sa première confession et qu’elle assistait à la messe, tous les dimanches et souvent en semaine, avec son père et ses sœurs. Nous faisons ensuite un détour pour aller aux Buissonnets, la maison des Martin. Située dans un quartier tranquille, cette demeure bourgeoise, dont une grande partie est restée dans son jus avec ses meubles et objets d’époque, donne idée de ce que fut la vie de cette famille. Lors de notre visite, un prêtre égrenait son chapelet dans la chambre où dormait Thérèse et où elle a dit avoir été guérie par le sourire de la Vierge. Nous nous rendons ensuite à la basilique Sainte-Thérèse qui surplombe la paisible cité normande. L’édification de cet immense vaisseau de pierre de style néo-byzantin, doté d’une superficie de 4 500 m2 et d’un dôme qui culmine à 90 m de hauteur, a été décidée après la canonisation de Thérèse. Les travaux, commencés en 1929, se sont achevés après la guerre, pendant la reconstruction de Lisieux, mais auparavant, en 1937, le cardinal Pacelli, alors secrétaire d’Etat de Pie XI et futur pape Pie XII, avait procédé, au terme du onzième Congrès eucharistique national, à la bénédiction solennelle de la basilique. Celle-ci a été officiellement consacrée en 1954. Le sanctuaire, qui contient 3000 places assises, accueille 600 000 visiteurs par an, qui se recueillent notamment, sur le côté droit de la nef, devant la chapelle où un reliquaire conserve les os du bras droit de sainte Thérèse.
Patronne universelle des missions (depuis 1927), patronne secondaire de la France (depuis 1944) et docteur de l’Église (depuis 1997) la sainte de Lisieux est une figure mondialement célèbre. Néanmoins, estime le père Schwab, « sa spiritualité est mal connue en France : il y a un travail à faire ». Mgr Guy Gaucher, grand connaisseur de la figure et de la spiritualité de sainte Thérèse, disparu en 2014, avait écrit que la sainteté de Thérèse ne reposait pas sur des phénomènes extraordinaires, mais consistait à « faire de manière extraordinaire des choses tout ordinaires ». Le père Schwab confirme : « Thérèse, docteur de l’Eglise, n’enseigne pas, ne fait pas de théorie : elle vit ». La carmélite, sans jamais avoir quitté sa cellule, a mis en œuvre, par sa « petite voie », l’idée que l’homme est fait pour répondre à la miséricorde de Dieu, car Dieu est d’abord un Dieu aimant, prompt au pardon, et non un Dieu vengeur. « Thérèse, poursuit le père Schwab, nous apprend à repérer que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, agit dans nos vies, et que son amour nous précède toujours ». Mais aimer son prochain pour obéir à Dieu, tout comme sauver des âmes par la prière et le sacrifice, est un combat : c’est pour cela, assure Jean de Saint-Cheron dans un magnifique essai, que sainte Thérèse est « une guerrière » (2).
Singulière histoire que celle de cette religieuse inconnue à sa mort, mais dont la renommée ne fera que grandir. Pendant la guerre de 14-18, le carmel de Lisieux reçoit des lettres de milliers de Poilus qui assurent avoir eu la vie sauve grâce à son intercession. En 1925, 500 000 personnes se déplacent à Rome pour la cérémonie de canonisation. Depuis, la liste des miracles n’a fait que s’allonger, miracles reconnus comme tels par l’Eglise ou miracles supposés. Ainsi d’Édith Gassion, née en 1915, abandonnée par sa mère et confiée par son père à sa propre mère, tenancière d’une maison close située à une trentaine de kilomètres de Lisieux. A 6 ans, Edith, atteinte d’une kératite aiguë, devient aveugle. Sa grand-mère décide d’emmener la fillette sur le tombeau de Thérèse, mais en compagnie de ses filles de joie. Sur place, ces dames implorent de tout leur cœur la religieuse montée au ciel vingt-quatre ans auparavant d’intercéder pour la petite Edith. Cette dernière, peu après, à la surprise des médecins, recouvre la vue. Des années plus tard, Edith Gassion prendra le nom d’Edith Piaf, et gardera toute sa vie une immense dévotion pour la sainte de Lisieux, qu’elle invoquait en se signant avant chaque récital : « Thérèse, maintenant, je chante pour toi ».
Sainte Thérèse, dont les reliques ont voyagé dans plus de 70 pays au cours des trente dernières années, avait écrit, outre ses souvenirs, plus de 250 lettres, 62 poésies, 8 pièces de théâtre et 21 prières. Dans tous ces textes, un mot est omniprésent : Amour. Dans son célèbre poème Vivre d’Amour, composé deux ans avant sa mort, elle écrivait : « Mourir d’Amour, voilà mon espérance / Quand je verrai se briser mes liens / Mon Dieu sera ma Grande Récompense / Je ne veux point posséder d’autres biens. ».
A Lisieux, le campanile de la basilique abrite 51 cloches. Le bourdon, qui pèse 9 tonnes de bronze, porte une devise : « Je sonne l’appel des peuples à l’unité dans l’Amour ». Un vœu très actuel.
Jean Sévillia
1) www.therese-de-lisieux.catholique.fr
2) Jean de Saint-Cheron, Eloge d’une guerrière, Thérèse de Lisieux, Grasset, 2023.