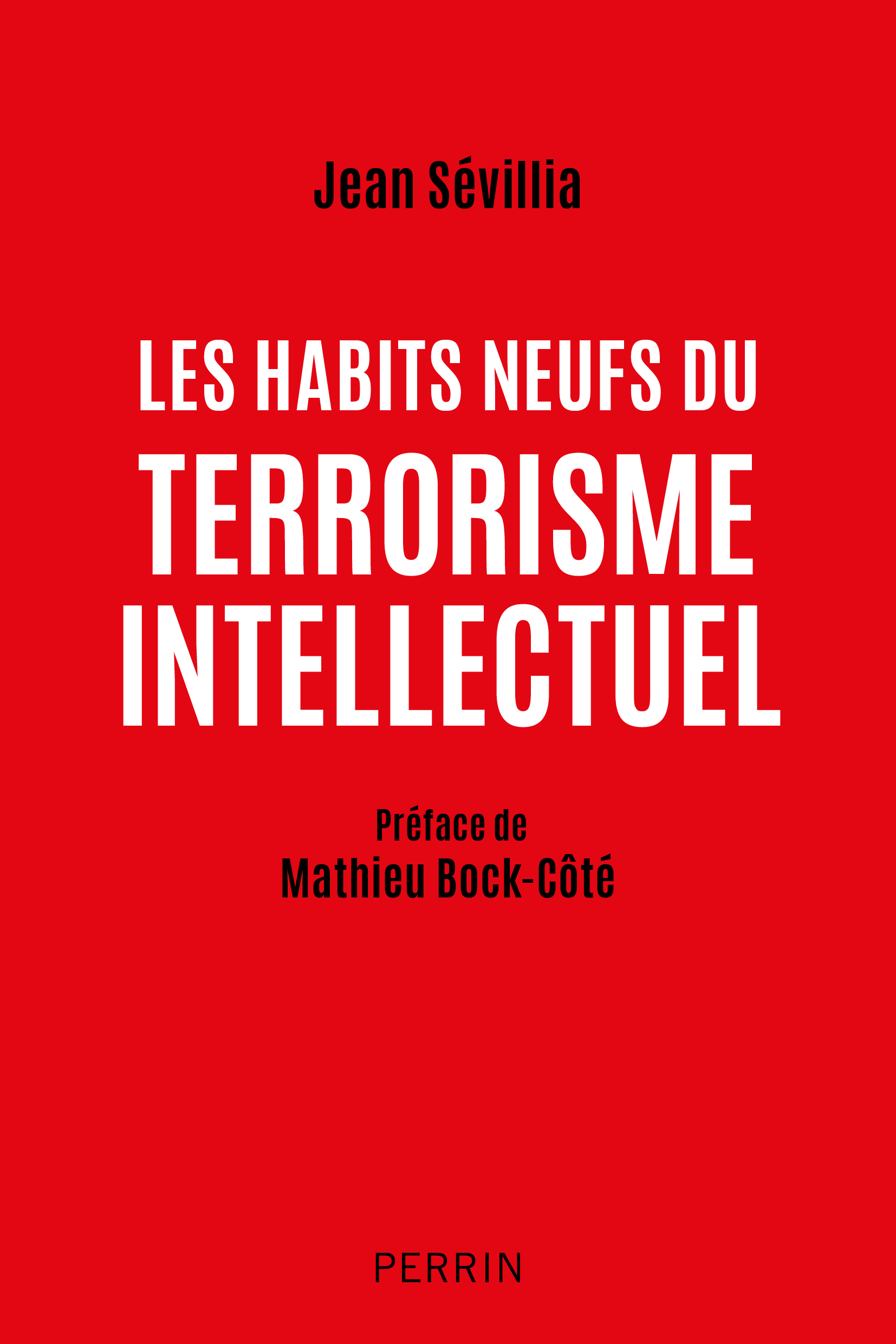Dans un essai novateur, Danilo Castellano souligne combien la modernité doit, pour le meilleur et pour le pire, à la conception luthérienne de la liberté.
Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait à la porte de l’église du château de Wittenberg, en Saxe, les 95 thèses que lui avait été inspirées la campagne en faveur des indulgences que le dominicain Johann Tetzel venait de mener à travers l’Allemagne. Dans ce texte, Luther ne se contentait pas de condamner le commerce des indulgences au profit de la construction de Saint-Pierre de Rome, mais, allant plus loin, s’en prenait aux pratiques du haut clergé romain et à certains points de la doctrine catholique, comme l’existence du purgatoire. Né le 10 novembre 1483, moine du couvent des Ermites de Saint-Augustin d’Erfurt, prêtre depuis dix ans, docteur en théologie, titulaire de la chaire d’Ecriture sainte de l’université de Wittenberg, il s’engageait, à 34 ans, sur un chemin qui allait le conduire non seulement à rompre avec l’Eglise catholique, mais à provoquer, au sein du monde chrétien, une révolution qui se traduirait par la fondation d’une nouvelle Eglise – ou plutôt de nouvelles Eglises –, et dont l’influence philosophique, politique, sociale et culturelle marquerait profondément tout l’Occident, bien au-delà des pays ralliés à la Réforme.
En 2017, le cinq-centième anniversaire de la naissance du protestantisme luthérien est salué d’une avalanche de livres, de colloques, d’émissions et de manifestations, souvent hagiographiques. L’époque n’étant plus aux guerres de religion entre chrétiens, ce dont on se félicitera, les hommages rendus à Luther n’émanent pas seulement de réformés mais aussi de catholiques, et parfois au plus haut niveau, au risque de provoquer une certaine confusion. S’il est vrai que Luther a joué un rôle considérable dans l’histoire chrétienne et dans l’histoire européenne en général, et qu’il a posé des questions appelant des réponses argumentées et non des formules polémiques, il reste que le luthéranisme se livre à une interprétation du christianisme qui est substantiellement différente de celle de l’Eglise romaine. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de juillet 2012 à juin 2017, observait tout récemment, dans une tribune publiée en Italie, le 24 octobre 2017, sur le site de La Nuova Bussola Quotidiana, que Luther n’avait pas pour intention principale de lutter contre les abus relatifs aux indulgences ou contre les péchés de l’Eglise de la Renaissance, abus et mauvaises actions qui ont toujours existé dans l’Eglise du fait des faiblesses de la nature humaine. En 1517, en effet, la cible du théologien qui s’insurgeait contre Rome n’était pas les indulgences considérées en soi, mais prises en tant qu’élément du sacrement de pénitence, lequel, lui, est un élément central de la religion catholique. Le cardinal Müller assurait qu’en rejetant des sacrements comme la pénitence, la confirmation, l’eucharistie (au sens de la doctrine catholique de la transsubstantiation selon laquelle le pain et le vin consacrés au cours de la messe se transforment en la substance du corps et du sang du Christ), l’onction des malades ou l’ordre, Luther « a tourné le dos à tous les principes de la foi catholique, de l’Ecriture Sainte, de la Tradition apostolique et du magistère du pape et des conciles, et de l’épiscopat ». Et l’ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, éditeur de l’œuvre complète de Joseph Ratzinger, d’affirmer que la réconciliation entre chrétiens ne doit pas se faire au détriment de la vérité et de l’Histoire…
Ce n’est pas cette perspective, toutefois, qui guide un petit livre publié en France par un grand intellectuel italien, à l’occasion du 500e anniversaire de la révolte de Luther. Danilo Castellano est doyen émérite de la faculté de droit de l’université d’Udine, où il enseigna la philosophie politique. Membre correspondant étranger de l’Académie royale espagnole des Sciences morales et politique, membre honoraire de l’Académie royale espagnole de jurisprudence et de législation, il a fait paraître plus d’une dizaine d’ouvrages, dont Martin Luther, le chant du coq de la modernité, paru en Italie en 2016, est le premier traduit en français. Dans ces pages, l’auteur, renouvelant l’approche du protestantisme, étudie l’entreprise de Luther non pas sur le strict plan religieux, mais sur le plan de la philosophie politique puisqu’il voit dans le réformateur allemand un « précurseur de l’actuelle civilisation occidentale ».
Après le coup d’éclat de Wittenberg, les thèses du moine rebelle se répandirent rapidement en Allemagne. Le pape Léon X ayant chargé le théologien Johannes Eck et le cardinal-légat Cajetan de débattre avec lui, le dialogue s’interrompit rapidement, car Luther se radicalisait encore plus en élaborant une théologie nouvelle : justification par la foi seule, rejet de la tradition patristique, valeur unique de l’Ecriture comme contenu de la foi, refus des sacrements, négation de la primauté papale et de la hiérarchie ecclésiale. La rupture avec Rome étant devenue inévitable, l’ancien moine fut condamné puis excommunié en 1521. Cité à comparaître devant la Diète de Worms par l’empereur Charles Quint, qui craignait de provoquer un soulèvement s’il le faisait arrêter, il refusa de se rétracter. Mis au ban de l’Empire, Luther trouva refuge à la Wartburg, chez l’électeur de Saxe. C’est là qu’il entama vraiment son œuvre religieuse, publiant ses écrits réformateurs, traduisant la Bible en allemand, abolissant le culte des saints, transformant la liturgie, supprimant le célibat des clercs, sécularisant les biens ecclésiastiques, fondant en définitive une autre Eglise. En 1524, quand éclata la guerre des Paysans, une révolte teintée d’illuminisme, Luther prit parti pour les grands seigneurs, ce qui lui valut le soutien de nombreux princes, heureux de rallier un homme qui défendait l’ordre social tout en combattant Rome, leur laissant miroiter la récupération du patrimoine foncier de l’Eglise.
Charles Quint était resté fidèle au pape, mais cherchait à éviter l’éclatement de ses Etats. En 1529, à Spire, la Diète d’Empire décida que le luthéranisme serait toléré là où il s’était établi, mais qu’on ne le laisserait pas se développer ailleurs. Cinq princes et quatorze villes, acquis aux thèses de Luther, élevèrent alors une protestation – introduisant dans l’Histoire le terme de « protestant ». En 1530, une ultime tentative de conciliation organisée par Charles Quint échoua, les théologiens catholiques repoussant la profession de foi luthérienne rédigée par Melanchthon, passée à la postérité sous le nom de Confession d’Augsbourg. Les princes protestants répliquèrent en fondant un an plus tard une alliance militaire, la ligue de Smalkade, qui entra en guerre contre l’empereur cinq mois après la mort de Luther, survenue le 18 février 1546. En 1547, les armées luthériennes furent vaincues à Mühlberg, mais le mouvement réformé ne fléchit pas, contraignant l’empereur à traiter. En 1555, à Augsbourg, le luthéranisme fut reconnu. Les princes étaient libres de choisir leur religion, mais les fidèles devaient soit embrasser la même confession, soit émigrer, en vertu du principe Cujus regio, ejus religio (« Telle la religion du prince, telle celle du pays »). Les deux tiers de l’Allemagne passèrent ainsi au protestantisme, puis le nord de l’Europe.
De Zwingli à Calvin, la Réforme aura d’autres inspirateurs, et engendrera des Eglises qui divergeront entre elles et même se combattront, tout en s’accordant sur des points fondamentaux : le salut par la foi seule et non par les œuvres, la Bible comme unique source de foi, le rejet de la hiérarchie ecclésiastique, le refus du sacerdoce et du caractère sacrificiel de la messe. Mais le précurseur Luther peut légitimement être regardé comme le père de la Réforme.
Or la Réforme, argumente Danilo Castellano, a finalement infusé ses idées dans toute l’Europe et l’Amérique, même dans les pays à dominante catholique, par une anthropologie dont certaines racines puisent dans la conception luthérienne de la liberté de conscience. Abolissant les médiations entre Dieu et l’homme (la Tradition, l’Eglise et ses sacrements, le pape), Luther a fait de chaque croyant l’interprète de la vérité ou de l’erreur. Du libre examen luthérien à la Raison des Lumières qui fait de l’individu son propre juge du bien et du mal, il existe un lien. De même, la conception réformée de l’Eglise comme assemblée des croyants se transpose sur le plan politique, le peuple devenant, écrit Castellano, « un ensemble d’individus absolument libres de déterminer leur destin sur la base de la seule volonté ». Du luthéranisme au concept de souveraineté populaire des démocraties contemporaines, il existe encore un lien, à la fois philosophique et historique. En ce sens, conclut Danilo Castellano, « la doctrine luthérienne est le système sanguin de toute forme politique de la modernité ». Or ce fut, souligne-t-il, pour le meilleur et pour le pire.
Dans l’ordre moral, faire de la conscience individuelle son propre juge revenait en effet à détruire l’objectivité du bien et du mal. « Si chacun fait ce que lui dicte son cœur, souligne Danilo Castellano, n’importe quelle action est légitime par le seul fait d’avoir été dictée par le vitalisme animal ». Les dérives de la bioéthique occidentale en donnent chaque jour des exemples.
Dans l’ordre religieux, la pensée de Luther déniait à l’Eglise son caractère de corps mystique, fondé par le Christ et animé par l’Esprit-Saint, mais une simple organisation sociale, une assemblée du peuple, « à qui incombent simultanément sacerdoce, prophétie et royauté ». La conséquence, c’est le déplacement de l’absolu vers la volonté du plus grand nombre, avec toutes les dérives possibles : définition problématique de la vérité (doit-elle être mise aux voix ?), manipulation de la majorité par la minorité ou l’inverse, champ libre aux groupes de pression.
Dans l’ordre politique et social, cette absolutisation de la souveraineté du nombre peut aboutir à l’inverse du but recherché, la liberté se transformant, en l’absence de corps intermédiaires et d’autorité transcendante, en instrument de contrainte de tous sur chacun, et le libéralisme pouvant dès lors déboucher, paradoxalement, sur la souveraineté illimitée de l’Etat, l’absolutisme, le totalitarisme : c’est dans les régions luthériennes de l’Allemagne que le nazisme fera, de fait, en 1933, ses meilleurs scores électoraux. Le livre de Danilo Castellano se révèle, par là, comme novateur et décapant.
Jean Sévillia
Danilo Castellano
Martin Luther. Le chant du coq de la modernité
Editions de l’Homme nouveau, 236 pages, 12 €.