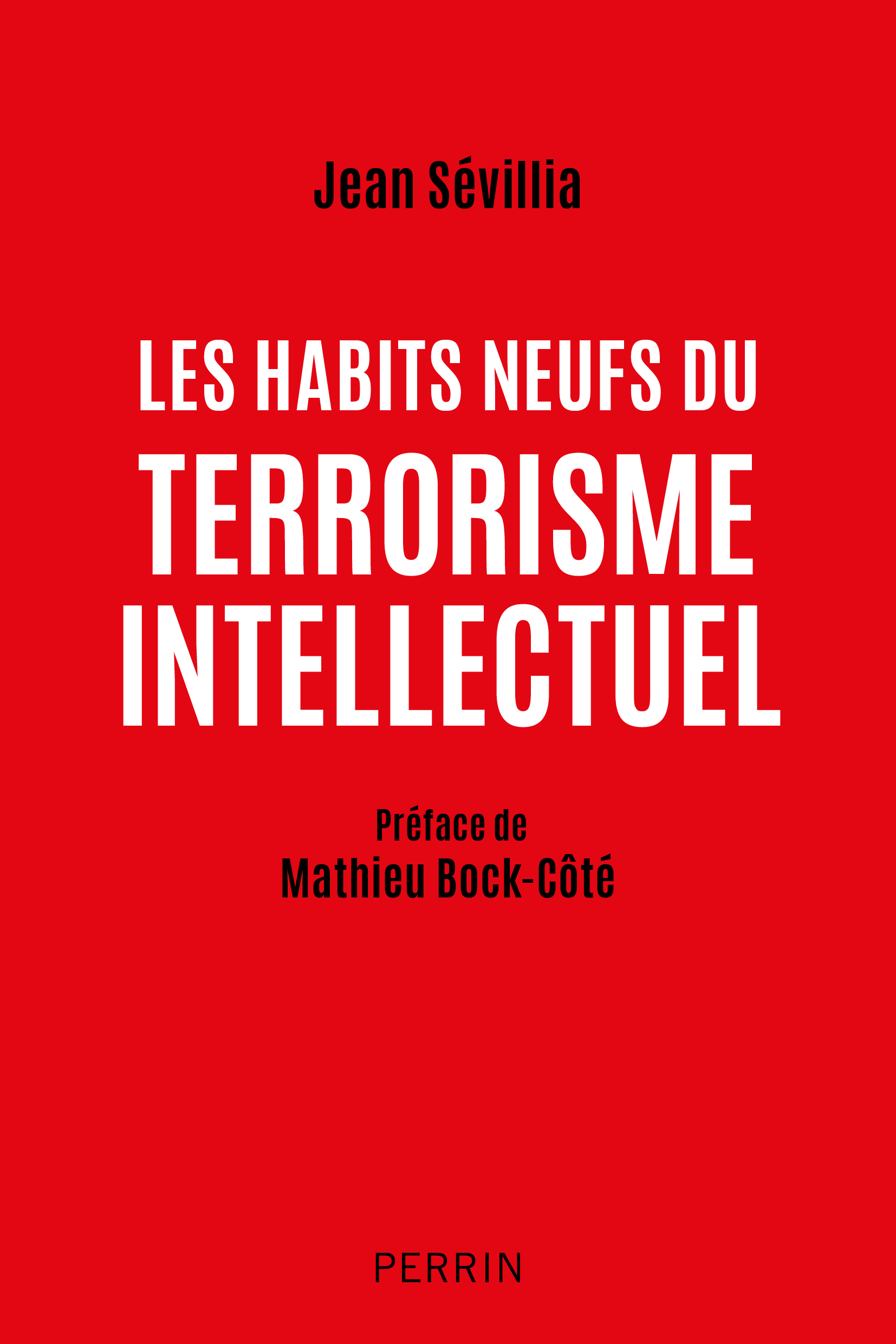A rebours d’une idée reçue, la disparition de l’Autriche-Hongrie n’était pas écrite avant 1914. C’est bien la Grande Guerre qui, en laminant les fidélités historiques qui liaient entre entre eux ses peuples, a entraîné la mort de l’empire.
Le 11 novembre 1918, l’empereur Charles Ier d’Autriche, reclus dans le palais de Schönbrunn qui n’est plus gardé que par une poignée de sentinelles et quarante élèves-officiers venus spontanément assurer sa protection, signe à contrecœur cette déclaration : « Je renonce à la part qui me revient dans la conduite des affaires de l’Etat. Je relève en même temps mon gouvernement autrichien de ses fonctions ». Formellement, il ne s’agit pas d’une abdication : jusqu’à sa mort en exil, en 1922, le jeune souverain ne cessera de se considérer comme empereur. Reste que cette renonciation marque la rupture d’une chaîne nouée en 1278, lorsque Rodolphe de Habsbourg, un petit seigneur de la Suisse alémanique, était devenu le maître de l’Autriche.
Les descendants de celui-ci, à force d’habiles alliances matrimoniales, avaient bâti un empire sur lequel, à l’époque de Charles-Quint, le soleil ne se couchait jamais. De 1438 jusqu’aux guerres napoléoniennes, les souverains de la maison d’Autriche avaient été empereurs du Saint Empire romain germanique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ayant été chassés d’Allemagne par l’ascension de la Prusse et d’Italie par le Risorgimento, ils s’étaient repliés sur leur héritage danubien. Depuis 1867, le compromis austro-hongrois avait permis la stabilisation de la Double Monarchie. Et voilà que, à l’automne 1918, cet ensemble politique aux racines sept fois séculaires venait de s’effondrer en un peu plus de quinze jours…
Que s’était-il passé ? L’Autriche-Hongrie était-elle vouée à disparaître parce que, Etat multinational, elle détonait à l’ère du nationalisme ? Etait-elle condamnée parce que, monarchie catholique, elle incarnait des principes dépassés ? Etait-elle tombée d’elle-même ou avait-elle succombé aux assauts de ses adversaires ?
Au début des années 1910, François-Joseph, qui règne depuis 1848, est le souverain de 52 millions de sujets qui représentent une douzaine de nationalités et parlent autant de langues. Empereur en Autriche et roi en Hongrie, très attaché aux traditions de sa maison et à l’étiquette de la Cour, le « dernier monarque de la vieille école », comme il se définira lui-même devant Theodore Roosevelt, n’est pourtant pas un despote. Conformément à la Constitution de 1867, l’empire d’Autriche possède son gouvernement, ainsi que son Parlement dont la chambre basse, élue au suffrage universel, est formée de députés appartenant à tous les partis, des sociaux-démocrates aux chrétiens-sociaux. L’Autriche est un Etat de droit qui garantit à ses citoyens toutes les libertés modernes, et jouit d’une législation sociale plus avancée, sur certains points, que la France ou l’Angleterre. Quatrième puissance économique européenne, elle bénéficie, sous l’impulsion d’une bourgeoisie nouvelle qu’on trouve à Vienne, Prague ou Trieste, d’une croissance proche de celle de l’Allemagne. Le royaume de Hongrie possède de même son propre gouvernement et son Parlement, celui-ci élu au suffrage censitaire. Mais l’effort de modernisation de la société ne touche guère que Budapest, ville industrieuse qui contraste avec le reste du pays, à dominante rurale, où la noblesse haute (les magnats) ou moyenne (la gentry) conserve l’essentiel du pouvoir.
L’empereur-roi et trois ministères communs (Affaires étrangères, Défense et Finances) forment le trait d’union de cet édifice austro-hongrois dont Vienne est de facto le centre politique. La Cour, avec ses règles strictement codifiées, ses uniformes, ses dignités et ses titulatures, peut donner l’impression d’un univers immobile. Mais ce n’est que la surface des choses. Sous le long règne de François-Joseph, la ville s’est transformée en métropole moderne. Dans ce foyer culturel œuvrent des architectes, des artistes, des écrivains et des médecins dont le nom, de Gustav Klimt à Stefan Zweig et de Gustav Mahler à Sigmund Freud, entreront dans la postérité.
Si disparate par sa population et la variété de ses institutions et statuts nationaux, cet empire repose sur de réelles forces de cohésion. Sur des territoires dont la majorité des habitants est catholique, l’Eglise est un des piliers sur lesquels s’appuie la dynastie. L’armée commune austro-hongroise exerce la même fonction. Le service militaire y est obligatoire, permettant un réel brassage social tandis que les officiers, que François-Joseph appelle « mes patriotes à moi », lui sont personnellement liés par leur serment de fidélité à l’empereur. Le troisième pilier de la dynastie est formé par les fonctionnaires : la bureaucratie autrichienne, si caricaturale (et caricaturée) soit-elle, fournit à l’Etat une pépinière d’hommes honnêtes et compétents, attachés à leur mission.
A côté de ces lignes de force, l’Autriche-Hongrie pâtit de facteurs de faiblesse. Le premier, conjoncturel, tient à son relatif isolement international. En 1879, en conséquence de sa défaite devant la Prusse lors de la guerre de 1866, François-Joseph a été contraint de conclure une alliance militaire avec l’Allemagne. Cet accord, avec le traité des Trois empereurs de 1881 (Allemagne-Autriche-Russie) et la Triplice de 1882 (Allemagne-Autriche-Italie), était un des éléments du système de Bismarck visant à isoler la France. Le chancelier allemand s’étant retiré en 1890, son système s’est écroulé, mais l’accord franco-russe de 1893, l’Entente cordiale entre la France et l’Angleterre (1904), le rapprochement anglo-russe (1907) et le désengagement progressif de l’Italie de la Triplice n’ont fait que laisser l’Autriche en tête à tête avec l’Allemagne. Situation d’autant plus paradoxale que, si les relations de l’Autriche et de la Russie sont tendues (en 1908, l’annexion de la Bosnie-Herzégovine a provoqué une crise majeure entre les deux pays), Vienne ne possède aucun motif de conflit avec la France ou l’Angleterre.
Le second point de faiblesse de l’Autriche-Hongrie, structurel, est la question des nationalités.
En un temps où le nationalisme se répand en Europe, maintenir douze peuples sous la même couronne constitue une gageure. Depuis le XIXe siècle, des mesures progressives ont certes reconnu des droits particuliers aux groupes nationaux de l’Autriche-Hongrie. Des efforts ont été accomplis, des compromis trouvés pour certaines minorités. Globalement, si la situation des Tchèques et des Polonais est favorable en Autriche, en Hongrie, le système électoral maintient la suprématie des Magyars : alors que ces derniers ne représentent que la moitié de la population du royaume, ils détiennent 407 des 413 sièges du Parlement de Budapest, provoquant le mécontentement – et des revendications croissantes – des Croates, des Slovaques et des Roumains.
Parce que l’architecture de la Double Monarchie repose sur des équilibres subtils, François-Joseph, par prudence, est partisan de ne toucher à rien. Son neveu François-Ferdinand, héritier du trône depuis 1896, est au contraire convaincu que le temps travaille contre l’empire des Habsbourg. Aspirant à mettre en œuvre de profondes réformes dans l’organisation politique de l’Autriche-Hongrie, l’archiduc échafaude des plans qui vont du remplacement du dualisme austro-hongrois par un trialisme fondé sur l’instauration d’un royaume slave du sud, voire à la fédéralisation de l’ensemble de la Double Monarchie sur une base ethnique et géographique. François-Ferdinand, au minimum, veut introduire le suffrage universel en Hongrie, seul moyen de briser le monopole des magnats au Parlement de Budapest.
Il ne faut cependant pas surestimer les tensions nationales au sein de l’Autriche-Hongrie. Outre que la question, avant 1914, agite plus les hommes politiques et les journalistes que la population, et que nombre de problèmes trouvent pacifiquement leur solution dans le cadre des institutions, ceux qui émettent des revendications nationales, en règle générale, ne remettent nullement en cause l’appartenance de leur peuple à la monarchie des Habsbourg. L’enracinement de la dynastie est si ancien, le prestige personnel de François-Joseph si grand que c’est l’arbitrage de l’empereur, au contraire, qui est souvent requis pour régler des différends de ce type.
Le ciment le plus puissant de l’Autriche-Hongrie, c’est donc le loyalisme dynastique, sentiment dont un Français d’aujourd’hui doit faire un effort d’imagination pour mesurer la force. Même les sociaux-démocrates autrichiens, en théorie républicains, respectent l’empereur. En 1918, Tomas Masaryk et Edvard Beneš seront les fondateurs de la Tchécoslovaquie, constituée sur les décombres de la Double Monarchie. Quelques années plus tôt, que disaient-ils ? Au Reichsrat, où il siège comme député, Masaryk lance cet acte de foi en 1913 : « C’est parce que je ne veux pas me laisser aller à des rêves sur l’effondrement de l’Autriche, c’est parce que je sais que l’Autriche, avec ses qualités et ses défauts, est destinée à vivre, que je prends aujourd’hui au sérieux les projets de réforme ». Vers la même époque, Beneš tient des propos identiques : « L’on parle fréquemment d’un éclatement de l’Autriche-Hongrie. Pour moi, je n’y crois pas. Les liens historiques et économiques qui enchaînent les peuples autrichiens sont beaucoup trop forts pour que l’on puisse provoquer cet éclatement ».
Contrairement à une idée reçue, l’inéluctabilité de la fin de la Double Monarchie est par conséquent un thème qui ne s’exprime nulle part, en Autriche-Hongrie, avant 1914. Si inquiétude il y a, elle porte plus sur la capacité de François-Ferdinand à succéder à son oncle, mais encore ces doutes ne s’affichent-ils pas ouvertement. On ne saura jamais ce qu’aurait produit le règne de cet archiduc, assassiné par un révolutionnaire serbe, à Sarajevo, le 28 juin 1914. La crise internationale provoquée par l’attentat, du fait du jeu des alliances, enclenchera non pas une guerre punitive courte contre la Serbie – aventure à laquelle François-Joseph, en dépit de son scepticisme sur l’option militaire, avait consenti afin de sauver l’honneur de sa Maison – mais une conflagration mondiale qui plongera l’Europe dans l’abîme.
Lors du déclenchement du conflit, le patriotisme dynastique fonctionne à plein : les peuples des Habsbourg partent au combat contre les Serbes et les Russes avec la conviction de mener une guerre juste, destinée à défendre la Monarchie contre l’agression étrangère. Dès les trois premières semaines des hostilités, cependant, le bilan est effroyable : l’armée impériale perd le tiers de ses effectifs et doit évacuer la Galicie (la partie de la Pologne qui appartient à l’Autriche depuis le XVIIIe siècle). Après une stabilisation du front, fin 1914, l’année suivante vaut aux Austro-Hongrois un désastre en Serbie et une série de revers sur le front nord, mais une contre-offensive austro-allemande fait reculer les Russes, rétablissant la balance. En mai 1915, l’entrée en guerre de l’Italie au côté de l’Entente signifie l’ouverture d’un nouveau front pour l’Autriche. A l’automne de la même année, l’aide de la Bulgarie, entrée à son tour dans le conflit dans le camp des Puissances centrales, permet aux Autrichiens d’occuper Belgrade et la majeure partie de la Serbie. Au printemps 1916, en revanche, la foudroyante offensive russe conduite par Broussilov bouscule les Centraux, tandis que la Roumanie entre à son tour dans la guerre, au cours de l’été, du côté de l’Entente.
A l’automne 1916, à l’issue de deux ans de guerre, nulle issue militaire n’apparaît. A l’ouest, à l’est comme au sud, les forces des belligérants s’équilibrent. Pour l’Autriche, toutefois la situation est de plus en plus périlleuse. La situation alimentaire, pour la population civile, est dramatique. Elle l’est également pour l’armée impériale dont les pertes ne peuvent être remplacées, et pour qui le matériel et les munitions font défaut. Au fil des batailles, le dispositif stratégique austro-allemand s’est de plus en plus imbriqué, et les Allemands se sont arrogé le commandement général des opérations, vassalisant l’armée autrichienne. Une subordination que Hindenburg et Ludendorff, qui prennent le haut commandement allemand en août 1916, érigent en principe.
A la mort de François-Joseph, le 30 novembre 1916, son petit-neveu l’archiduc Charles, devenu l’héritier du trône lors de la disparition de François-Ferdinand, devient l’empereur Charles Ier en Autriche et le roi Charles IV en Hongrie. Il a 29 ans et n’a eu que deux ans pour se préparer à cette charge. Officier sur le front depuis 1914, et ayant mené pour l’empereur des missions diplomatiques qui l’ont conduit à rencontrer à plusieurs reprises les dirigeants allemands, il est parfaitement informé de la situation de son pays. Aussi se donne-t-il pour objectif immédiat de sortir l’Autriche de la guerre et de réformer son empire, car il a compris que ce conflit qui dure met en péril l’équilibre sociopolitique sur lequel reposait la monarchie des Habsbourg. Le drame de Charles Ier, ainsi que l’a souligné l’historien britannique Gordon Brook-Shepherd, est qu’il aurait besoin de réaliser ses réformes pour imposer sa volonté de paix, et besoin de la paix pour réussir ses réformes. Equation impossible, qui le mènera à l’échec.
Et pourtant quels efforts ce souverain n’a-t-il pas entrepris ! Apportant la jeunesse et une simplicité tranchant avec le formalisme de François-Joseph, soutenu par sa jeune femme, l’impératrice Zita, l’empereur Charles confère un souffle nouveau à la vieille monarchie habsbourgeoise. Alors que son oncle ne sortait plus de ses palais, le souverain effectuera, en deux ans de règne, 56 voyages à travers son empire, dont la moitié pour visiter ses troupes sur le front, donnant pour consigne d’épargner au maximum le sang des hommes. Mais ses négociations secrètes avec les Alliés, conduites dans les premiers mois de 1917 par l’intermédiaire de ses beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, officiers dans l’armée belge, se heurtent à l’opposition des Italiens, à l’incrédulité des Français et à l’intérêt limité des Anglais.
« Notre force militaire touche à sa fin », avertit l’empereur d’Autriche, en mai 1917, en s’adressant à Guillaume II. Hindenburg et Ludendorff, cependant, ne veulent croire qu’à la victoire finale. Au printemps 1918, Clemenceau, le chef du gouvernement français, révèle les négociations Sixte qui ont eu lieu l’année précédente. Charles Ier, dès lors, passe pour un traitre aux yeux des Allemands et des Autrichiens les plus bellicistes. Il est alors contraint d’accepter un humiliant protocole militaire qui place son armée, pourtant victorieuse encore contre les Italiens, à Caporetto, en novembre 1917, sous la dépendance totale du commandement allemand.
Cet assujettissement de l’Autriche par l’Allemagne est mis en avant par la propagande séparatiste menée par des émigrés tchèques, slovaques, croates ou slovènes qui, au début de la guerre, se sont établis en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Avec la complicité de réseaux qui étaient idéologiquement hostiles à l’Autriche parce que celle-ci aurait été, selon le mot de Clemenceau, une « monarchie papiste », ces émigrés présentent l’empire des Habsbourg comme une « prison des peuples ». A leur instigation, un comité yougoslave est formé à Londres en mai 1915, une armée tchécoslovaque en France en décembre 1917. Ce sont toutefois des initiatives symboliques. « Nous avions fort à faire pour convaincre les Alliés de la nécessité de détruire l’Autriche », écrira Masaryk dans ses Mémoires. En janvier 1918, le dixième des Quatorze points du Président Wilson ne fait qu’évoquer l’autonomie des peuples d’Autriche-Hongrie. En juillet, à Pittsburgh, Masaryk conclut un accord entre représentants tchèques et slovaques en vue de la constitution d’un Etat commun, et en août, un Conseil national tchèque est reconnu comme cobelligérant par les Alliés.
Ces derniers n’ont néanmoins signé aucun texte officiel déclarant vouloir détruire l’Autriche-Hongrie : cette destruction va s’opérer avec l’approbation complice des Alliés, mais presque d’elle-même. A partir de l’été 1918, les tentatives désespérées du jeune empereur d’établir un contact avec ses adversaires n’obtiennent aucune réponse. En septembre, le corps expéditionnaire de Franchet d’Esperey avance victorieusement dans les Balkans. Le 25 de ce même mois, la Bulgarie dépose les armes, découvrant le flanc sud-est de la Monarchie. Le 16 octobre, Charles Ier joue son va-tout en publiant un manifeste appelant l’Autriche (mais non la Hongrie, qui a bloqué le projet) à se transformer en un Etat fédéral où chaque groupe national, sur son territoire, formera sa communauté politique. Le souverain est persuadé que le mécanisme des autonomies nationales qui s’est déclenché ne peut plus être arrêté – en quoi il voit juste – et pense que les peuples danubiens sont voués, par l’histoire et la géographie, à vivre dans un cadre dont il lui appartient d’être le commun dénominateur. Sur ce dernier point, il se trompe, car il n’a pas mesuré combien les mentalités ont changé.
Le 21 octobre 1918, les députés de l’Autriche proprement dite se constituent en Assemblée nationale provisoire. Au cours des derniers mois, l’armée impériale, malgré quelques défections, a continué à se battre. Le vieux ciment dynastique tenait bon, maintenant des régiments tchèques, serbes ou italiens du Tyrol, le ventre vide et les uniformes en lambeaux, sous l’étendard des Habsbourg. Mais le 26 octobre, sur le front d’Italie, un régiment hongrois refuse de monter en ligne. Cette désobéissance donne le signal d’une débandade qui touche toute l’armée impériale et permet aux Alliés de percer le dispositif autrichien. Le 27 octobre, l’empereur Charles doit demander un armistice qui sera signé le 3 novembre. Le 28 octobre, le Conseil national tchèque prend le pouvoir à Prague et, annexant la Slovaquie, proclame l’indépendance. Le 29, les Slovènes, les Croates et les Serbes de la Monarchie annoncent leur rattachement à la future Yougoslavie. Le 30, la révolution éclate en Hongrie. Le 11 novembre, jour où les Allemands signent l’armistice à l’Ouest, Charles renonce à exercer le pouvoir…
Avant 1914, à part quelques radicaux slaves, nul n’envisageait la fin de l’Autriche-Hongrie, même en France ou en Angleterre. Mais l’interminable conflit, avec son cortège de mort et de famine, a fini par laminer les fidélités historiques qui attachaient les peuples des Habsbourg à la dynastie et les liaient entre eux. Chez les Alliés, la haine croissante contre l’Allemagne s’est reportée contre l’Autriche, perçue comme la subordonnée de Berlin. Et la propagande des émigrés slaves a fini par porter ses fruits auprès des dirigeants français, britanniques et américains. C’est bien la guerre de 1914-1918 qui a tué l’Autriche-Hongrie, dont la disparition n’était pas écrite.
Jean Sévillia