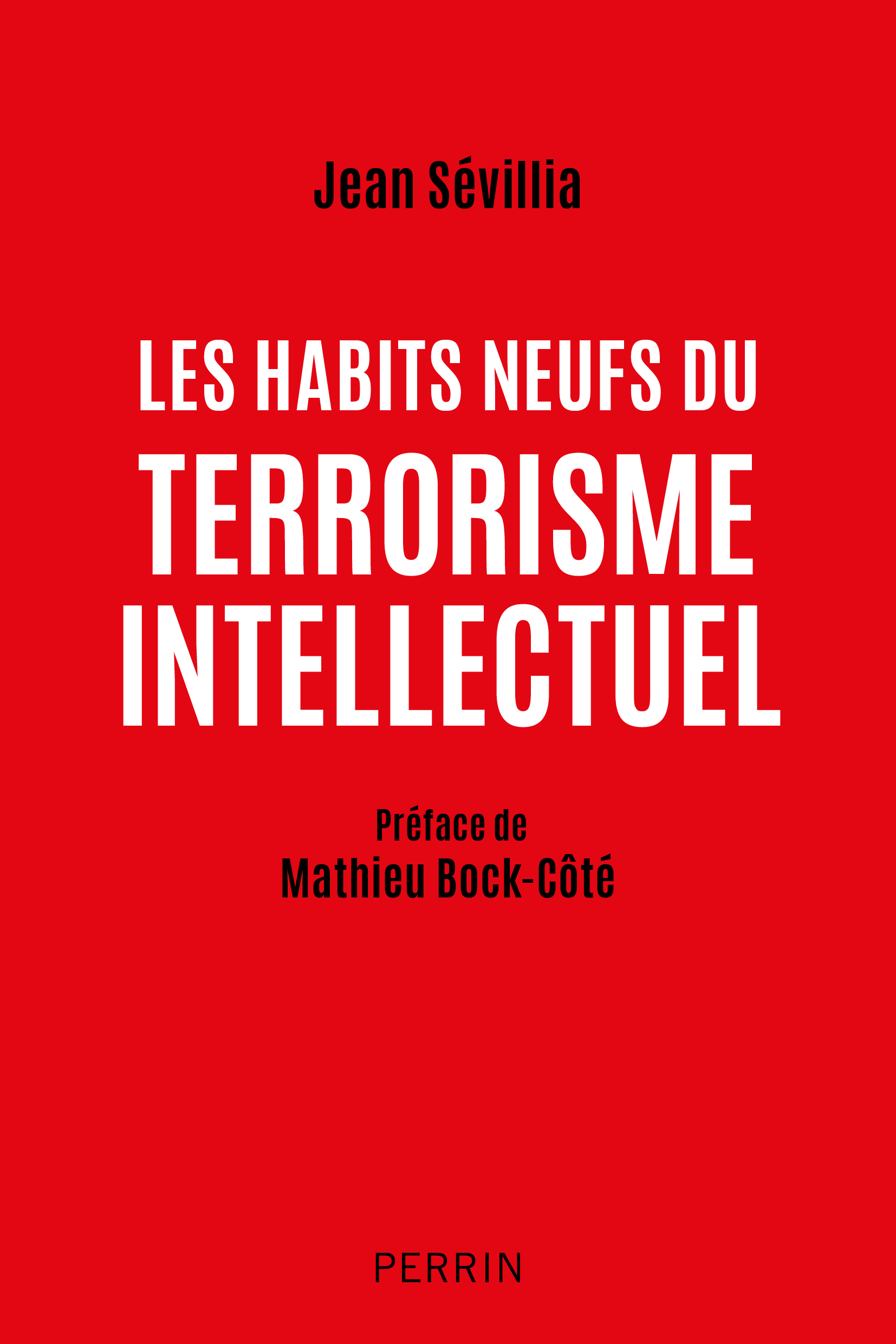A Vienne, dans les magasins pour touristes, François-Joseph et l’impératrice Elisabeth tournent ensemble sur les présentoirs de cartes postales, pendant que leur effigie figure sur des boîtes de chocolats, des puzzles, des porte-clés, des tee-shirts et des statuettes, sans oublier les boules de verre avec de la fausse neige. Si le kitsch Habsbourg fait marcher le commerce, il y a, Dieu merci, plus sérieux pour célébrer le centième anniversaire de la mort de François-Joseph, disparu en 1916, au mitan de la Première Guerre mondiale. Dans la capitale autrichienne, les librairies proposent des piles de biographies, d’albums et de magazines historiques qui lui sont consacrés, tandis que se tiennent quatre expositions, une cinquième étant proposée dans le château de Niederweiden, à 50 kilomètres à l’est de la ville (lire notre carnet de voyage, p. 79). Impossible, en ce moment, de se rendre à Vienne et d’ignorer que 2016 est une année François-Joseph. Mais, à part ses favoris immaculés et le surnom de son épouse (Sissi), qu’est-ce que le visiteur connaît de lui ? Et mesure-t-on bien tout ce que le visage actuel de Vienne doit à cet empereur ?
Né en 1830, François-Joseph est le petit-fils de François Ier, l’adversaire malheureux de Napoléon. C’est en 1848 qu’il accède au trône, à la faveur de l’abdication de son oncle Ferdinand Ier, chassé par la révolution. Par la force des armes, le jeune souverain rétablit la puissance autrichienne en Lombardie et en Hongrie, où l’insurrection est matée avec l’appui des Russes. Cette première partie du règne impose un régime autoritaire, opposé aux aspirations libérales ou nationales. A Solferino, en 1859, François-Joseph perd la guerre contre Napoléon III, et doit céder la Lombardie au royaume de Piémont. Une déroute qui le contraint, à l’intérieur, à l’ouverture vers le fédéralisme. En Allemagne, l’empereur doit composer avec la prépondérance de Berlin, rivalité qui débouche sur un conflit clos par la défaite autrichienne devant les troupes prussiennes, à Sadowa, en 1866. Un nouveau revers qui pousse François-Joseph à un nouveau changement manifesté par des concessions aux Magyars. Entichée de la Hongrie, l’impératrice Elisabeth contribue à cette politique. En 1867, le compromis austro-hongrois place l’empire d’Autriche et le royaume de Hongrie sur un pied d’égalité, l’ empereur et roi gouvernant la double monarchie avec trois ministres communs.
Suivront quarante années de paix : l’apogée du règne. Un temps néanmoins traversé de tensions intérieures et de drames familiaux : l’exécution du frère de François-Joseph, Maximilien, au Mexique (1867) ; le suicide de son fils unique Rodolphe à Mayerling (1889) ; l’assassinat de l’impératrice Elisabeth par un anarchiste italien à Genève (1898). Et, pour finir, l’assassinat de son neveu François-Ferdinand par un révolutionnaire serbe, à Sarajevo, en 1914. Cet attentat obligera l’Autriche à réclamer réparation à la Serbie, déclenchant, par le jeu des alliances, la Première Guerre mondiale. Lorsqu’il meurt, en 1916 – laissant la couronne à son petit-neveu, Charles Ier, qui régnera jusqu’en 1918 – François-Joseph est âgé de 86 ans. Il a été empereur pendant soixante-huit ans et a vu 150 autres souverains régner en Europe, puis disparaître.
François-Joseph incarne un pan de l’histoire de l’Europe, de l’histoire de l’Autriche et de l’histoire de Vienne. Son nom est un mythe, un mythe historique, culturel, littéraire et cinématographique. Ce mythe existait du vivant du souverain dont le portrait ornait chaque bâtiment officiel, chaque maison, chaque auberge. Après l’effondrement de l’empire, l’Autriche, paradoxalement, était un pays neuf. Non seulement en raison de la forme républicaine de l’Etat, mais parce que le territoire délimité par les frontières de 1919 n’avait jamais existé comme un pays indépendant, l’Autriche étant jusqu’alors le berceau de l’empire d’Autriche auquel elle avait donné son nom. Aussi ceux des Autrichiens qui doutaient de la solidité de leur nouveau pays et de sa capacité à résister au voisin allemand, surtout après 1933, se raccrochaient-ils au mythe François-Joseph. Sans être lié nécessairement à une nostalgie monarchique, le souvenir du vieux souverain ramenait l’image rassurante d’une Autriche forte, prospère et sûre, contrastant avec les menaces du moment. Chez Franz Werfel, Robert Musil, Joseph Roth ou Stefan Zweig, la littérature autrichienne d’alors abonde en livres ressuscitant « le monde d’hier ».
Après la Seconde Guerre mondiale, le mythe est réactivé car il permet d’évacuer l’épisode trouble vécu par l’Autriche sous la botte nazie. Au cinéma, la célébrissime trilogie du réalisateur autrichien Ernst Marischka – Sissi (1955), Sissi impératrice (1956) et Sissi face à son destin (1957) – met en scène l’impératrice sous les traits de la jeune Romy Schneider, François-Joseph étant joué par le séduisant Karlheinz Böhm. Ces films ont fixé dans le public, jusqu’à nos jours, une image historiquement fausse du couple impérial. Ils ont cependant contribué à la popularité mondiale du mythe François-Joseph et Sissi, et auront suscité, dans les années 1950 et 1960, l’envie d’aller découvrir les palais viennois et les lacs alpins, avantage non négligeable pour un pays qui, ayant recouvré sa souveraineté en 1955, ne demandait qu’à s’ouvrir au tourisme.
Il ne faut pas croire, pour autant, que François-Joseph a toujours été l’objet de panégyriques. Dès 1919, Ernest von Koerber, qui avait été chef du gouvernement autrichien sous la monarchie, considérait que cet empereur avait nui deux fois au pays, au début par sa jeunesse, à la fin par son trop grand âge. De nos jours, l’absolutisme des débuts du règne ou l’évaluation de la responsabilité de l’empereur dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale suscite des débats. Karl Vocelka, auteur d’une biographie de François-Joseph parue l’an dernier et commissaire de l’exposition qui se tient actuellement à Schönbrunn, déplore ainsi longuement la répression de la révolution hongroise de 1848 ou le fait que de nombreux problèmes nationaux et sociaux soient restés sans réponse avant 1914. L’historien reconnaît toutefois les acquis économiques et culturels de cette époque, tout en hésitant à les attribuer à l’action personnelle du souverain.
L’historien tchèque Palacky, dès 1848, disait que si l’Autriche n’existait pas, il faudrait l’inventer. On peut trouver mille défauts à François-Joseph, mais sa vertu principale, le service qu’il a rendu aux peuples danubiens et par-là à l’Europe entière, c’est d’avoir su durer – or durer, en politique, est un art – et d’avoir su réunir sous ses deux couronnes une douzaine de peuples qui parlaient autant de langues et pratiquaient toutes les religions. Au siècle des nationalités, la mosaïque ethnique et culturelle du bassin danubien aurait pu être le théâtre d’atroces guerres intestines. Cette catastrophe a été évitée à l’Europe centrale grâce à l’Autriche-Hongrie, foyer de civilisation.
La cour de François-Joseph, avec son étiquette, ses uniformes et ses titulatures, pouvait laisser l’impression d’un univers figé. Ce n’était que la surface des choses. En réalité, à cette époque, l’Autriche s’était transformée en une puissance moderne, un Etat de droit où la Constitution de 1867 garantissait les droits du citoyen, où le suffrage universel attendrait 1907, mais où la législation sociale, dès la seconde moitié du XIXe siècle, était sur de nombreux points (assurance-maladie, congés payés) plus avancée qu’en France ou en Angleterre. L’Autriche-Hongrie, dans ces années-là, était devenue une force industrielle, la quatrième d’Europe après l’Angleterre, l’Allemagne et la France. Et c’est sous le long règne de François-Joseph que la capitale autrichienne avait revêtu ce visage qui lui vaut de nos jours d’attirer les visiteurs du monde entier.
En 1857, une ordonnance impériale commande la destruction de la vieille enceinte qui, en 1529 et en 1683, avait repoussé les Ottomans mais qui, désormais inutile, étouffe la ville comme un corset. François-Joseph impose cette décision aux militaires, qui craignent que cette mesure ne profite aux révolutionnaires. Dans son esprit, il s’agit de faire de Vienne la capitale d’un vaste empire dynamique, ce qui suppose un plan de rénovation urbaine à l’instar de celui lancé par le baron Haussmann à Paris. Les meilleurs architectes sont mobilisés – l’Autrichien Heinrich von Ferstel, l’Allemand Gottfried Semper, le Danois Theophil Hansen – et chargés d’organiser l’espace situé à l’emplacement des anciennes murailles. Le choix a été fait d’entourer la vieille ville par un boulevard circulaire de 5,3 kilomètres de longueur. Sur cette artère de prestige, la Ringstrasse, en abrégé le Ring, s’édifieront des bâtiments publics, des institutions culturelles, des hôtels de luxe, des immeubles de bureaux et d’habitation. Inauguré en 1865, le Ring restera en chantier pendant plus de vingt ans.
Entre 1860 et 1890 sont ainsi bâtis la Votivkirche (l’église du Vœu, commencée avant la démolition des remparts et construite en action de grâce pour la tentative d’assassinat à laquelle François-Joseph a échappé en 1853), l’Opéra, la chambre de commerce, la Maison des artistes, le musée des Arts appliqués, la salle de concert du Musikverein, la Bourse, le musée d’Histoire naturelle, le musée d’Histoire de l’art (Kunsthistorisches Museum), l’Académie des beaux-arts, le nouvel hôtel de ville, le Parlement, le Burgtheater, l’aile nouvelle du palais de la Hofburg et l’université. Le goût étant à l’historicisme, le Parlement a été conçu dans le style grec, l’hôtel de ville dans le style néogothique et l’Université dans le style néo-Renaissance. Ces monuments, en 2016, conservent à Vienne son air de capitale impériale. Si plusieurs d’entre eux, bombardés en 1944-1945, ont été reconstruits à l’identique, ils remplissent la même fonction depuis l’origine.
Sur le Ring s’étaient également édifiés des immeubles habités par des aristocrates, mais plus souvent par des familles bourgeoises dont l’ascension accompagnait les progrès économiques de l’Autriche. Les Juifs étaient nombreux dans ce milieu, encouragés par l’abolition, en 1867, des ultimes interdits qui les frappaient. Rothschild, Epstein, Ephrussi ou Todesco se faisaient bâtir des palais dont l’architecture, la décoration des façades et la richesse des intérieurs proclamaient la réussite.
Forte de cet essor, Vienne organisait en 1873 une Exposition universelle ambitieuse qui venait après celles de Londres et Paris. De 430 000 habitants en 1857, la population passait à 820 000 personnes en 1890, et atteindra les 2 millions en 1910. Autrichiens, Italiens, Polonais, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Juifs de l’Est, tous les peuples de l’empire étaient représentés à Vienne. La ville était la cinquième métropole occidentale, derrière Londres, New York, Paris et Berlin.
Vienne fin de siècle ? Rien de plus trompeur que cette formule. Contrairement à une idée reçue, nul sentiment de décadence, ou de fin du monde, n’étreignait cette société où personne ne pressentait la fin de la monarchie. C’est encore sous le règne de François-Joseph que s’épanouirait, laboratoire de la modernité, la Vienne du Jugendstil et de la Sécession, avec des architectes comme Otto Wagner et Adolf Loos, des peintres comme Gustav Klimt, Egon Schiele et Oscar Kokoschka, des musiciens comme Gustav Mahler, Arnold Schönberg et Alban Berg, et des médecins lauréats du prix Nobel ou pionniers de la psychanalyse, tel un certain docteur Sigmund Freud, loyal sujet de l’empereur.
Aujourd’hui, dans la capitale autrichienne, une aile du vieux palais impérial de la Hofburg abrite la présidence de la République. Alexander Van der Bellen, l’écologiste élu chef de l’Etat le 22 mai dernier, à l’issue d’un scrutin qui a fait parler dans le monde entier, travaille non loin du bureau de François-Joseph. Les services de la présidence ont attendu 1999 pour commander à la manufacture de porcelaine d’Augarten, à Vienne, un service de 200 pièces aux armes de la République : jusqu’alors, les dîners officiels étaient servis dans la vaisselle portant la couronne des Habsbourg, vaisselle restée sur place en 1918…
Dans la crypte des Capucins, la nécropole des Habsbourg, la tombe de François-Joseph est toujours fleurie. Dans les rues du centre-ville, nombre de magasins, du bottier Rudolf Scheer au café-pâtisserie Demel, conservent sur leur devanture l’inscription k.u.k. Hoflieferant : « fournisseur de la cour impériale ». Dans le Burggarten, aux beaux jours, des étudiants révisent leurs cours assis dans l’herbe au pied de la statue de François-Joseph. Dans la grande salle du Café central, les consommateurs lisent leur journal en buvant leur expresso sous le portrait de François-Joseph et de Sissi. A l’Opéra, les mélomanes se pressent pour assister à des représentations ultracontemporaines dans un temple de la musique inauguré par François-Joseph. Au Parlement, les députés siègent dans un bâtiment dont le sommet de la façade présente un relief sculpté : « François-Joseph accordant la Constitution ». Chaque année, le cabinet américain Mercer publie une liste internationale de 230 villes classées selon la qualité de vie. En 2016, pour la septième année consécutive, c’est Vienne qui a été jugée comme la ville offrant la meilleure qualité de vie au monde. Voilà cent ans que François-Joseph est mort, mais les Autrichiens bénéficient toujours de son héritage.
Jean Sévillia