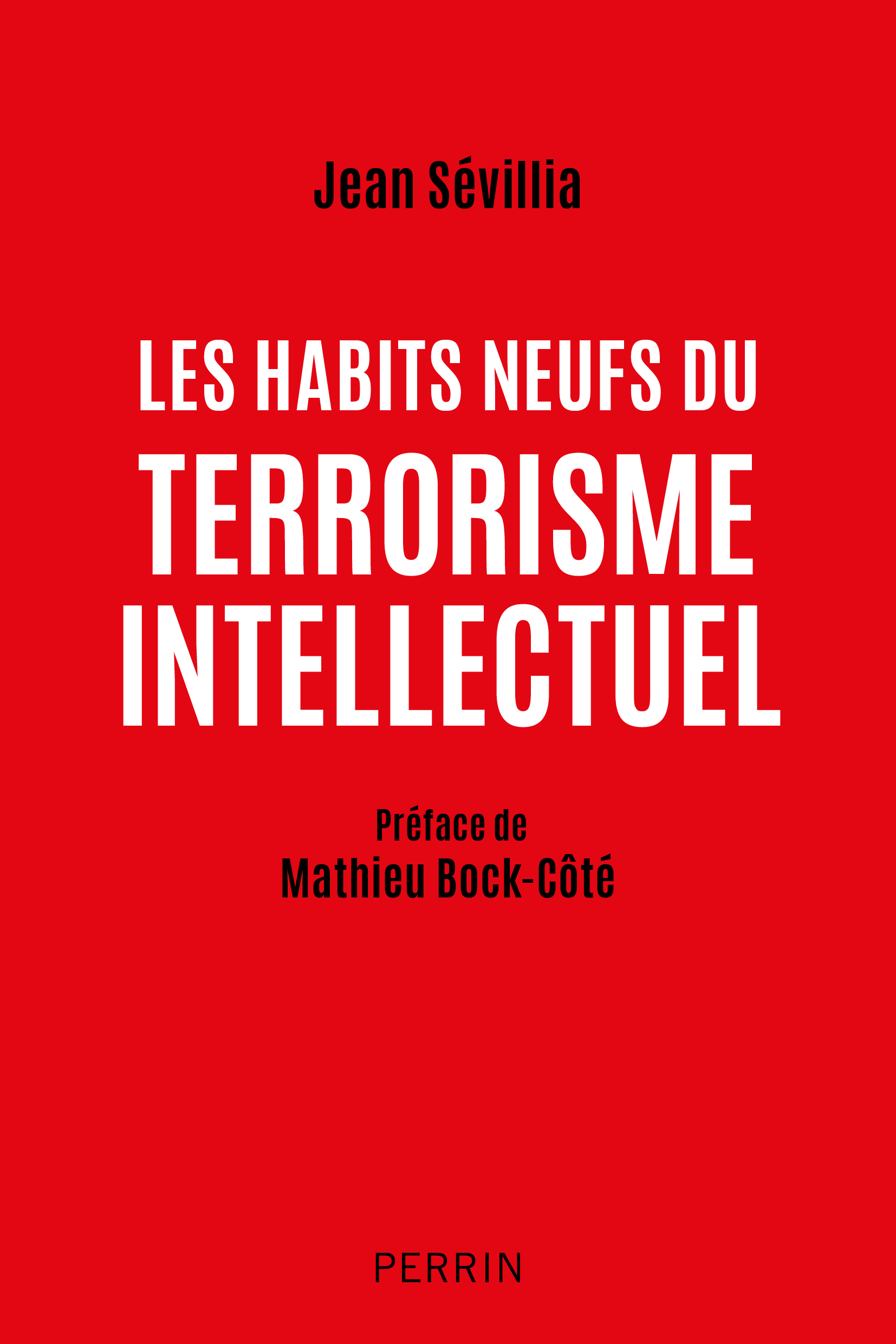Pour les progressistes, l’Eglise catholique semble née avec Vatican II, il y a 50 ans. Pour les intégristes, elle paraît s’être égarée à ce moment-là. Le recul du temps permet de juger la réalité sans passion : ce concile, empreint de tradition et de modernité, est à replacer dans la longue histoire du catholicisme.
Le 11 octobre prochain, à Rome, Benoît XVI présidera une messe solennelle, place Saint-Pierre, afin d’inaugurer l’Année de la foi. A cette cérémonie assisteront 35 pères conciliaires ou experts qui avaient pris part à Vatican II. La date du 11 octobre a été retenue, précisément, car elle correspond au cinquantième anniversaire de l’ouverture de ce concile auquel, jeune théologien, Joseph Ratzinger avait lui-même participé, de 1962 à 1965, en tant que consulteur auprès du cardinal- archevêque de Cologne, Joseph Frings.
Au lendemain de son élection, en 2005, Benoît XVI, dans son premier message pontifical, avait assuré de sa « très ferme volonté de poursuivre la tâche de la mise en oeuvre du concile Vatican II dans une fidèle continuité de la tradition bimillénaire de l’Eglise ». Quelques mois plus tard, lors d’un discours prononcé devant la curie romaine, à l’occasion du quarantième anniversaire de la clôture de Vatican II, le pape était revenu sur la « juste interprétation » du concile. Récusant l’« herméneutique de la discontinuité et de la rupture » (1), selon laquelle Vatican II fut avant tout une coupure avec le passé, interprétation qui, remarquait-il, a eu la sympathie des médias et d’une partie de la théologie moderne, le souverain pontife entendait privilégier « l’herméneutique de la réforme », pour qui l’enseignement de Vatican II doit être compris comme un développement homogène dans la doctrine de l’Eglise. Vatican II, élément de rupture ou élément de continuité ? Un demi-siècle après l’événement, la question fait encore débat.
Le 11 octobre 1962, une procession de plus de 2 400 évêques latins et orientaux et de supérieurs d’ordres et de congrégations du monde entier pénètre, par rangs de quatre, dans la basilique Saint-Pierre. Ils précèdent le pape Jean XXIII qui, juché sur la sedia gestatoria, antique chaise à porteurs, et entouré de gardes suisses et de gardes nobles, traverse l’immense nef où les prélats ont pris place dans des gradins. Le pape s’assied ensuite sous le baldaquin baroque du Bernin, avant que le cardinal Eugène Tisserant, un Français, en tant que doyen du Sacré Collège, célèbre la messe d’ouverture du concile. Faste et pompe du Vatican. Cependant, sans qu’aucun participant le sache, ce qui va se passer au cours des mois et des années suivantes va bouleverser le visage de la religion catholique.
Le précédent concile (Vatican I) avait dû être interrompu, en 1870, en raison de l’invasion de Rome par les troupes du Piémont, dernier acte de l’unité italienne. Pie XI en 1923, Pie XII, en 1948, avaient mené des travaux exploratoires en vue de la réunion d’un concile. Mais c’est Jean XXIII qui, le 25 janvier 1959, trois mois après son accession au pontificat, a annoncé la mise en oeuvre d’un concile oecuménique, le vingt et unième de l’histoire de l’Eglise catholique. Par l’encyclique Ad petri cathedram, le pape a énoncé ses intentions : « Le but principal du concile consistera à promouvoir le développement de la foi catholique, le renouveau moral de la vie chrétienne des fidèles, l’adaptation de la discipline ecclésiastique aux besoins et méthodes de notre temps. »
A travers une série de commissions au sein desquelles sont examinés les thèmes et les textes qui seront soumis aux prélats convoqués au Vatican, les préparatifs durent près de quatre ans. L’allocution d’ouverture de Jean XXIII, prononcée en latin (qui restera la langue officielle du concile), exprime une vision pleine d’espoir, conforme à la philosophie de ce pape bonhomme qui aspire, selon son expression, à un aggiornamento de l’Eglise afin que celle-ci entre en dialogue avec le monde, fraternellement, sans jeter l’anathème. Le contexte n’y est pas pour rien : les années 1960 amorcent la fin du monde bipolaire issu de la guerre froide, de jeunes Etats issus de la décolonisation ont l’avenir pour eux et, en Occident, l’élévation du niveau de vie, la conquête de l’espace et l’extension de nouveaux moyens de communication (comme la télévision) paraissent offrir de nouveaux espaces. « C’est dans ce climat d’optimisme généralisé que s’est ouvert le concile », souligne l’historien Philippe Chenaux (2).
Parmi les pères conciliaires, toutefois, les évêques des pays communistes sont rares, beaucoup étant en prison ou vivant dans la clandestinité : ils attendront en vain un renouvellement de la condamnation du communisme. Les observateurs non catholiques (anglicans, orthodoxes et protestants) ne prennent pas la parole, mais certains jouent un rôle important à l’extérieur des séances officielles, de même que les 200 experts (400 en 1965) qui interviennent dans la rédaction des textes adoptés.
Dès la phase préparatoire du concile, en effet, à côté des délibérations se déroulant au sein des instances habilitées, toutes sortes de voix se font entendre afin d’exposer leurs vues personnelles sur les changements à opérer dans l’Eglise catholique, leurs idées rebondissant dans la presse, dans des conférences ou des colloques organisés à Rome ou dans les grandes villes de la catholicité : c’est ce que Yves Chiron, un chercheur en histoire religieuse, nomme « le péri-concile » (3) et qui influe profondément sur le concile proprement dit. En 1960, un jeune théologien suisse, Hans Küng, publie ainsi Concile et retour à l’unité, ouvrage dans lequel il déplore le culte de la Vierge (le « marianisme », grince-t-il) qui fait obstacle au rapprochement avec les protestants et où il dénonce l’autorité du pape (le « papalisme »), appelant à une réforme de l’Eglise qui devrait, selon lui, s’organiser autour du pouvoir de l’évêque dans son diocèse. « La critique, voire une critique véhémente, peut être un devoir », affirme l’auteur qui, nommé expert au concile, commence une carrière de contestataire anti-romain.
Chaque matin, les pères conciliaires sont réunis en « congrégation générale » où ils discutent et votent les « schémas » préparés en commission. La majorité des deux tiers est requise pour l’adoption d’un texte, qui est ensuite promulgué par le pape. Jean XXIII pensait que quelques semaines suffiraient pour achever le travail. Trois sessions supplémentaires seront en réalité nécessaires, en 1963, 1964 et 1965, tant les questions à régler seront difficiles et souvent controversées, et tant les manoeuvres se multiplieront, chaque tendance cherchant en coulisse à s’assurer de la majorité ou à mettre le pape dans son camp.
Dès la première session se dessine la configuration qui dominera le concile : une majorité réformatrice modérée, une minorité réformatrice radicale, une minorité conservatrice. Français, Allemands, Belges et Hollandais sont en pointe dans la réforme, Italiens, Espagnols et Portugais étant plutôt conservateurs. Les Américains, du Nord ou du Sud, raisonnent, eux, selon des critères différents des Européens, de même que les Africains et les Asiatiques. Antinomies et divergences, néanmoins, ne recouvrent pas systématiquement les clivages attendus, tel prélat à la théologie moderne pouvant par exemple avoir des goûts traditionnels en matière de liturgie.
Cette complexité contribuera à prolonger les discussions. De 1962 à 1965, Paul VI ayant succédé à Jean XXIII en 1963, il faudra 168 congrégations générales, 2 212 interventions orales, 4 361 interventions écrites et 544 votes pour élaborer les 16 textes qui constituent le corpus de Vatican II. On distingue deux constitutions dogmatiques (sur l’Eglise, sur la Révélation), une constitution pastorale (sur « l’Eglise dans le monde de ce temps »), une autre constitution (sur la liturgie), 9 décrets (sur les moyens de communication sociale, les Eglises orientales, l’oecuménisme, l’épiscopat, la vie consacrée, la formation des prêtres, l’apostolat des laïcs, les missions et le sacerdoce) et 3 déclarations (sur l’éducation chrétienne, les rapports avec les religions non chrétiennes, et notamment le judaïsme, et sur la liberté religieuse).
Certains textes, approfondissant la théologie la plus traditionnelle, ont été adoptés à la presque unanimité ; d’autres, impliquant une inflexion doctrinale ou pastorale, ont suscité d’âpres désaccords avant le vote, et parfois après. Relire ces textes, cinquante ans après, c’est y découvrir des accents prophétiques, mais aussi des considérations datées.
L’après-concile tourne à la contestation générale
« Le concile est un acte solennel d’amour pour l’humanité », déclarait Paul VI lors de son discours d’ouverture de la dernière session. Confiant en 1965, le même pape s’affligera en 1972 : « Devant la situation de l’Eglise d’aujourd’hui, nous avons le sentiment que, par quelque fissure, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. » Que s’était-il passé ?
Se greffant sur une tendance antérieure à Vatican II, un mouvement de contestation de l’autorité et de la tradition, représenté par la minorité conciliaire radicale, qui se sentait encouragée par l’esprit et la culture des années 1960-1970, allait transformer l’aprèsconcile en une période confuse, tournant à la remise en cause globale du catholicisme. En France, plus qu’ailleurs en Europe, le phénomène se traduira par une politisation extrême (à gauche) de l’Eglise, dont une grande part des militants, du clergé et de la hiérarchie semblait alors confondre l’Evangile et un appel à la lutte des classes. Rappelons, pour ceux qui en douteraient, qu’une enquête de 1979 montrera que la majorité des évêques de France était alors favorable à une collaboration avec le Parti communiste, 66 % d’entre eux acceptant le marxisme comme instrument d’analyse sociale. Sur l’autre bord, le courant traditionaliste, ultraminoritaire mais actif, faisait alors son apparition.
Chez les fidèles, si certains étaient enthousiastes, beaucoup étaient désemparés, notamment par certaines innovations liturgiques, parfois délirantes, qui étaient d’ailleurs en contradiction formelle avec les normes édictées par le concile. Ces bouleversements, en France toujours, devaient brusquement accélérer le recul de la fréquentation de l’église, tendance qui se manifestait dès les années 1950 : en région parisienne, la pratique dominicale chute de plus de la moitié entre 1962 et 1975. Parmi le clergé, des dizaines de prêtres et de religieux rejoignaient la vie civile, tandis que les vocations commençaient à diminuer.
Les Eglises protestantes, à la même période, subissaient une désaffection analogue, ce qui prouve que Vatican II n’est pas à l’origine de la crise du catholicisme, crise due au processus de sécularisation frappant alors la société européenne et aggravée par la culture du « soupçon » caractérisant ces années-là. Crise amplifiée, malgré tout, par ceux qui, voulant à tout prix voir dans le concile une rupture avec le passé, ont couru derrière les chimères du siècle pour en revenir, le plus souvent, bredouilles.
Il faudra le pontificat reconstructeur de Jean-Paul II pour commencer à comprendre Vatican II non comme l’alpha et l’oméga du catholicisme, mais comme le dernier élément en date d’une longue chaîne bimillénaire. Benoît XVI s’est inscrit dans la même logique en valorisant, dans le concile, ce qui est appelé à durer. Parfaitement lucide sur l’état de l’Eglise, le pape s’attache à ramener celle-ci aux fondamentaux de la foi chrétienne. Le 7 octobre prochain, au Vatican, s’ouvre le synode sur la nouvelle évangélisation. Dans la même semaine, le pape ouvrira donc le synode, l’Année de la foi et le cinquantenaire de Vatican II. Qui a dit que le vieux Joseph Ratzinger était usé ?
Jean Sévillia
(1) L’herméneutique est la science de l’interprétation des textes et des symboles.
(2) Le Temps de Vatican II, de Philippe Chenaux, Desclée de Brouwer, 228 p., 22 €. En librairie le 11 octobre.
(3) Histoire des conciles, d’Yves Chiron, Perrin, 2011.
Le latin et la soutane ont de l’avenir
Commencées en 2011, les négociations entre le Vatican et la Fraternité Saint-Pie X marquent le pas, alors qu’un dénouement semblait en vue au printemps. Benoît XVI souhaite un accord, non par complicité avec les détracteurs de Vatican II, comme cela se répète ici ou là, mais parce qu’il est de sa fonction de pasteur universel de ramener les brebis égarées hors de l’Eglise. Le dossier est entre les mains de Mgr Müller, nouveau préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, réputé peu favorable aux lefebvristes, mais qui appliquera la politique du pape, et de Mgr Fellay, supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, lui aussi désireux de parvenir à une entente avec Rome, mais soucieux également d’éviter l’éclatement de sa fraternité : le calamiteux Mgr Williamson, qui fit scandale par ses propos négationnistes, a sans doute été écarté, mais les autres évêques lefebvristes ont fait savoir qu’ils ne se plieraient pas à un accord avec le Vatican, « temple du modernisme ». Si l’affaire restait dans l’impasse, les intégristes pourraient rejoindre la liste des petites Eglises qui, au cours de l’histoire, se sont définitivement séparées de Rome.
Ces négociations servent de chiffon rouge médiatique contre Benoît XVI. Des médias qui entretiennent volontiers une confusion. La messe selon le rite antérieur à Vatican II, en latin, le prêtre faisant face à l’autel, liturgie dont l’usage a été libéralisé par le pape, en 2007, sous le nom de forme extraordinaire, est célébrée par des centaines de prêtres et parfois des évêques ou des cardinaux qui sont parfaitement en règle dans l’Eglise. Par ailleurs, la messe dans la forme ordinaire, en français, peut également être dite en latin. Ajoutons que, parmi les jeunes prêtres non traditionalistes, beaucoup portent la soutane dans les grandes occasions. Conclusion : tout prêtre en soutane célébrant la messe en latin n’est pas en rupture avec le pape. Au contraire.
J.S.
Les cathos de gauche en panne
Tombé à moins de 7 000 abonnés, exsangue, Témoignage chrétien, hebdomadaire emblématique du catholicisme de gauche, cesse de paraître. Le journal tentera de se relancer, en janvier prochain, sous la forme d’un mensuel. Cause de cet effondrement : le vieillissement du lectorat.
« Les derniers des Mohicans vont-ils mourir en silence ? », s’interrogeait un chrétien de gauche en 2011. La citation se trouve dans un livre qui raconte la saga de ces catholiques et de ces protestants qui, des années 50 aux années 80, dans l’opposition à la guerre d’Algérie ou l’engagement syndical, sur le Larzac ou au cours d’opérations de soutien aux immigrés, ont conjugué christianisme, socialisme et révolution (1). Les auteurs sont pleins de sympathie pour leur sujet, mais ne tentent pas de dissimuler les aveuglements de cette « parenthèse utopique », paradoxalement fermée par le succès électoral de Mitterrand en 1981.
Christine Pedotti, cofondatrice du Comité de la jupe, dont le but est de « lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’Eglise catholique », et co-animatrice de la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones, organisation qui représente elle-même et ses proches ami(e) s, s’acharne, de livre en livre, à vilipender le Vatican, l’Eglise, ses dogmes, sa hiérarchie et sa discipline. Elle réclame aujourd’hui un Vatican III qui serait, bien entendu, dirigé contre l’autorité du pape (2). Selon toute apparence, ces vieilles idées révolutionnaires laissent indifférents les milliers de jeunes qui, aux JMJ, se pressent pour écouter l’homme en blanc leur parler de Dieu.
J.S.
(1) A la gauche du Christ, sous la direction de Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel, Seuil, 620 p., 27 €.
(2) Faut-il faire Vatican III ?, de Christine Pedotti, Tallandier, 214 p., 12 €.