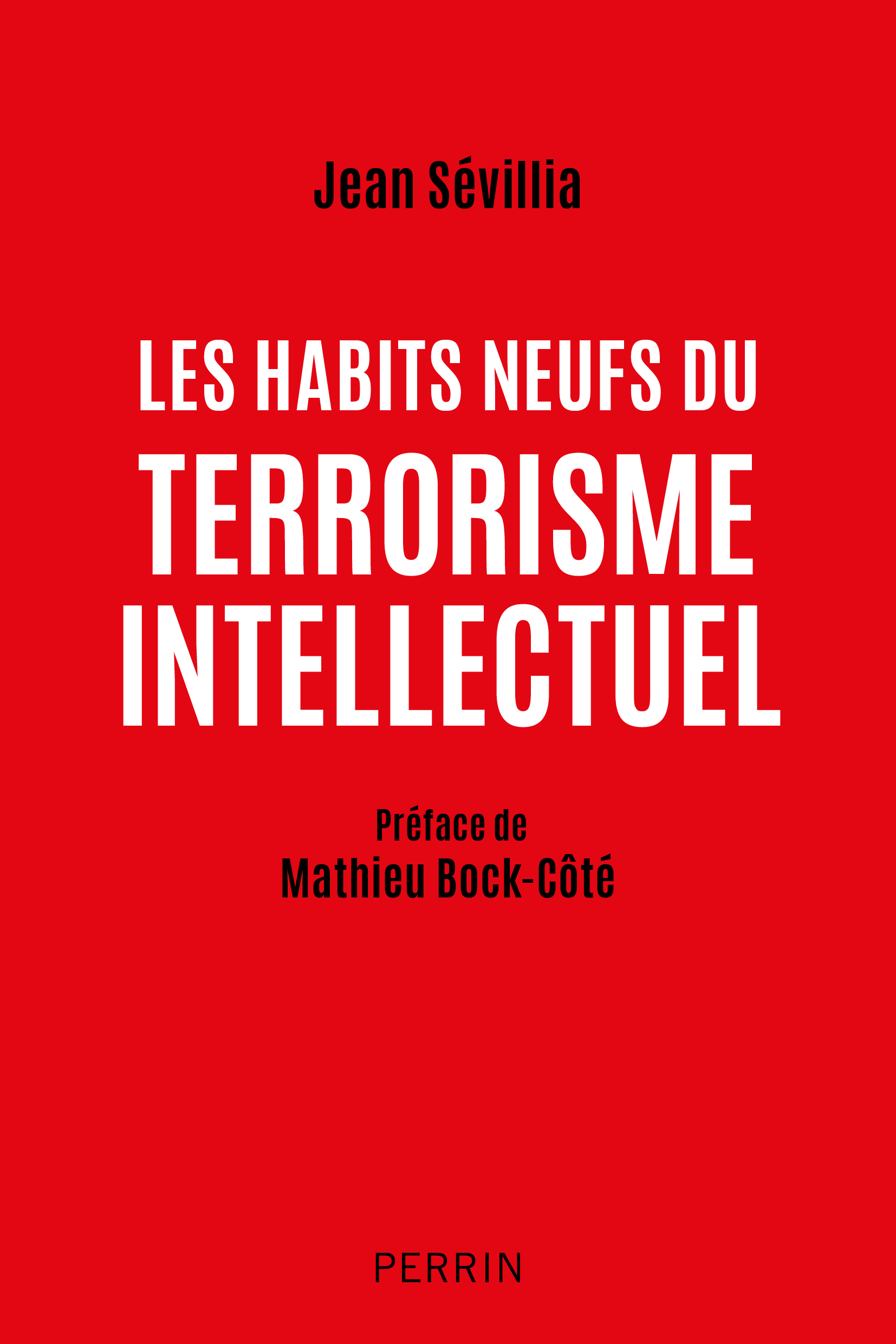Vincent Peillon l’a rappelé à ceux qui l’avaient oublié : célébrée comme le garant de la paix civile, la laïcité fut d’abord une machine de guerre contre l’Eglise.
Le 4 janvier dernier, Vincent Peillon, le ministre de l’Education nationale, adressait à tous les recteurs de France une lettre dans laquelle il appelait à « la plus grande vigilance à l’égard des conditions du débat légitime qui entoure le mariage pour tous (…), notamment dans les établissements privés sous contrat d’association ». Raison de cet avertissement ? Le 12 décembre précédent, Eric de Labarre, le secrétaire général de l’enseignement catholique, avait écrit de son côté aux 8500 chefs d’établissements sous contrat, les incitant à « prendre les initiatives localement les plus adaptées pour permettre à chacun l’exercice d’une liberté éclairée ». La circulaire de Vincent Peillon, évoquant une mise au pas de l’école catholique, déclenchait une émotion d’autant plus vive qu’elle se réclamait d’un principe revendiqué par François Hollande, venu en renfort de son ministre : « La neutralité de l’Etat dans les établissements d’enseignement sous contrat ». Principe qui suscitait cette objection de la part d’un directeur diocésain : « L’enseignement catholique n’est pas neutre par définition. Notre caractère propre et le principe de neutralité s’opposent ».
Morale laïque contre morale catholique ? Ceux qui s’étonnent de l’attitude de Vincent Peillon devraient se souvenir qu’en 2010, il avait consacré un livre à Ferdinand Buisson : Une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson (Seuil). Bien oublié aujourd’hui, ce dernier fut un pivot de la politique scolaire de la IIIe République, au temps de l’anticléricalisme triomphant.
Agrégé de philosophie en 1868, Ferdinand Buisson refuse de prêter serment à Napoléon III et part enseigner en Suisse. Revenu à Paris après la chute du Second Empire, il était entré au ministère de l’Instruction publique. En 1879, Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction publique, le nomme inspecteur général, puis directeur de l’Enseignement primaire, poste qu’il conservera dix-huit ans, sous quatorze ministres successifs, jusqu’à ce qu’il occupe, en 1896, la chaire de pédagogie de la Sorbonne. Conseiller intime de Ferry, Buisson fut le rédacteur des textes fondateurs de l’école républicaine. Député radical-socialiste de 1902 à 1914, il prépara la loi de 1901 sur les congrégations, puis celle de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Autant dire que sa « foi laïque », religion de substitution, n’avait pour but que de faire pièce à l’Eglise catholique.
On l’a en effet oublié aujourd’hui – et la hiérarchie catholique, comme on l’a vu en 2005, au moment du centenaire de la loi de séparation, n’aime pas trop remuer ces souvenirs-là -, mais la laïcité à la française, aujourd’hui présentée comme le garant de la paix civile, a d’abord été une philosophie de combat tournée contre la religion catholique. Elle s’est imposée au terme d’un affrontement politique et juridique d’un quart de siècle entre l’Etat et l’Eglise.
« Le cléricalisme, voilà l’ennemi ». C’est Léon Gambetta, alors leader de l’opposition, qui avait lancé ce mot d’ordre devant la Chambre des députés, en 1877. Le tribun républicain y avait pris pour cible un catholicisme qui, après avoir été choyé par Napoléon III, entretenait alors d’excellents rapports avec les conservateurs au pouvoir, la IIIe République ayant été fondée, paradoxalement, par des monarchistes. En vertu du concordat de 1801, qui avait reconnu la religion catholique comme « la religion de la grande majorité des Français », le clergé recevait un traitement de l’Etat et l’Eglise était florissante. En 1878, dans un pays de 38 millions d’habitants, la France comptait 56 000 prêtres diocésains, 30 000 religieux, 130 000 religieuses. Tout au long du XIXe siècle, les congrégations avaient connu un essor sans précédent, et joué un rôle très important dans des domaines comme l’enseignement, la santé et l’action sociale.
En 1879, à la suite de la démission de Mac-Mahon, le régime connaît un tournant : c’est la gauche républicaine, pour qui l’anticléricalisme est un ciment, qui prend le pouvoir. Elle ne le lâchera plus jusqu’en 1914. Dans cette République des républicains, les catholiques sont exclus du gouvernement.
La première phase de l’offensive anticléricale consiste en la séparation de l’Eglise et de l’école. En 1879, Jules Ferry dépose un projet de loi interdisant d’enseignement les membres d’une congrégation non autorisée. Seules cinq congrégations masculines avaient en effet été reconnues, en 1804 – trois congrégations missionnaires dont Napoléon avait besoin à l’étranger (Lazaristes, Missions étrangères, Pères du Saint-Esprit)), les Sulpiciens, qui formaient les séminaristes, et les Frères des écoles chrétiennes –, les congrégations féminines se consacrant à l’enseignement et à l’assistance publique étant, de leur côté, libéralement autorisées au fur et à mesure de leur formation tout au long du siècle – on en comptera jusqu’à 900 en 1879. Les autres, comme les Jésuites, ne bénéficiaient depuis que d’une tolérance de fait.
C’est elles que vise le projet de loi. Adopté comme prévu par la Chambre, il est rejeté par le Sénat. Le gouvernement passe alors en force, en 1880, en prononçant la dissolution des Jésuites, et en donnant trois mois aux autres congrégations pour présenter une demande d’autorisation. Autorisations qui sont ensuite refusées, ce qui entraîne la dissolution des congrégations demanderesses : 261 couvents sont fermés, 5600 religieux expulsés.
En 1881, la loi instaure la gratuité de l’enseignement primaire. Mesure qui, sous son aspect social, vise à rendre les écoles congréganistes moins attractives. En 1882, l’école devient à la fois obligatoire et laïque : l’enseignement religieux et les symboles chrétiens y sont prohibés. En 1886, une loi complémentaire laïcise le personnel enseignant des écoles primaires publiques : 3000 frères des écoles chrétiennes et 15 000 religieuses, instituteurs dans des établissements publics, sont interdits d’enseignement. Ces lois scolaires, les lois Ferry et Goblet, deviennent des « lois intangibles », fondement de l’école républicaine. Organisant la résistance dans la longue durée, les catholiques lancent alors la construction d’un réseau d’écoles libres, celui qui est toujours en place aujourd’hui.
La deuxième phase de l’offensive laïque vise les congrégations, contemplatives, enseignantes ou hospitalières. En 1899, le président du Conseil, Pierre Waldeck-Rousseau, présente un projet de loi sur les associations qui comporte un régime d’exception pour les congrégations. Ce projet deviendra la célèbre loi du 1er juillet 1901 sur les associations, loi libérale pour les associations ordinaires, mais dont le titre III contraint les congrégations à demander leur autorisation dans un délai de trois mois et interdit d’enseignement, même dans les écoles libres cette fois, les membres d’une congrégation non autorisée. En 1902, devenu chef du gouvernement, Emile Combes fait appliquer cette loi de manière stricte : 3000 écoles catholiques doivent fermer. En 1903, les demandes d’autorisation des congrégations sont examinées par la Chambre, mais toutes sont refusées. Religieux et religieuses se trouvent face à des choix dramatiques. Rester en communauté, fidèles à leur vocation, en s’exilant à l’étranger et en abandonnant des couvents pluri-centenaires ? Ou se disperser en quittant l’habit pour tenter de maintenir clandestinement une vie religieuse ? Une dernière loi, en 1904, étend l’interdiction d’enseigner aux congrégations jusqu’alors autorisées. Le résultat est que le pays se vide de ses moines et de ses bonnes sœurs : entre 1901 et 1904, de 30 000 à 60 000 religieux et religieuses français doivent s’exiler, tandis que 17 000 de leurs maisons – écoles, dispensaires, maisons de charité – ferment leurs portes.
Dernière phase de l’assaut anticlérical, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, vieille revendication de la gauche républicaine qui veut mettre fin au Concordat de 1801 et rompre les relations diplomatiques de la France et du Saint-Siège. Le ministère Combes étant tombé, en 1905, à la suite du scandale des fiches (quand fut découvert que les officiers catholiques étaient fichés et leur avancement bloqué), le projet aboutit sous le gouvernement de Maurice Rouvier. Aux termes de ce texte promulgué le 9 décembre 1905, et qui concerne aussi le protestantisme et le judaïsme, la République française ne reconnaît ni ne salarie plus aucun culte.
Condamnée par le pape Pie X, cette loi ne pourra pas être appliquée en pratique, faute de constitution par les catholiques des associations cultuelles auxquelles devait être confiée la gestion des biens de l’Eglise dont la puissance publique (Etat et communes) était propriétaire depuis la Révolution. Il faudra ce blocage et la crise des Inventaires (dans chaque église, le mobilier et les objets du culte, devenus, eux aussi, propriété publique, devaient être inventoriés, mesure qui donnera lieu à des incidents violents avec les fidèles) pour que la République se résolve à des compromis juridiques : en 1907, le clergé est ainsi reconnu comme un « occupant sans titre » dans les lieux de culte catholiques. D’autres compromis entre l’Eglise et l’Etat seront trouvés entre-deux-guerres (en 1924, Pie XI autorise la constitution d’associations diocésaines, reconnues par le droit français, pour gérer les biens ecclésiastiques), et encore après 1945, dans un autre contexte sociopolitique.
Après cette longue période d’apaisement, c’est l’irruption de l’islam dans la société française, dans les années 1980, qui refera de la laïcité un sujet polémique. L’Eglise catholique, pendant tout ce temps, s’était déshabituée des attaques des représentants de l’Etat. La rhétorique de Vincent Peillon, ou celle de Cécile Duflot, pose la question de savoir si, historiquement parlant, nous changeons de nouveau d’époque.
Jean Sévillia