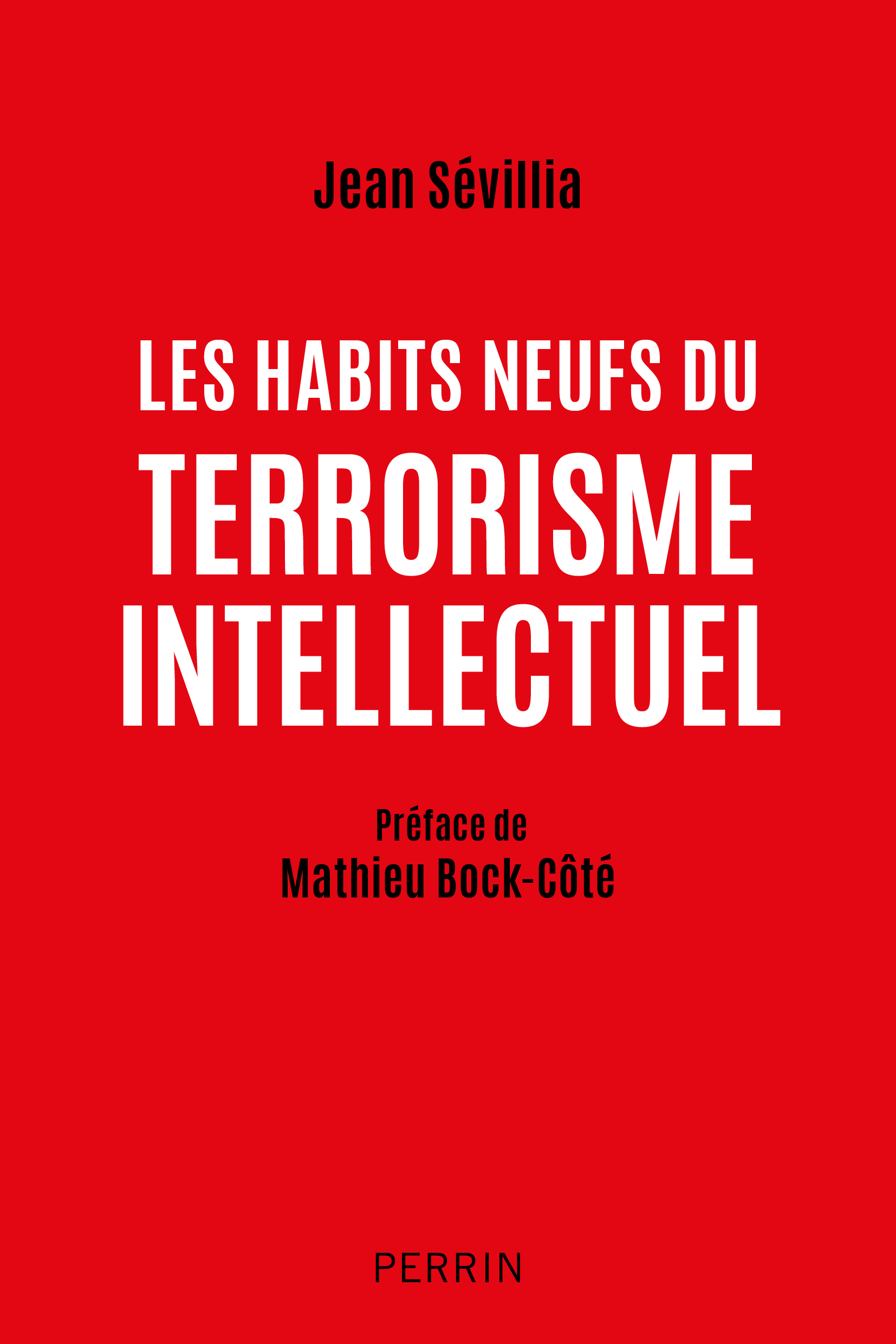En 1871, la Commune de Paris a représenté 72 jours d’anarchie, au cours desquels un pouvoir insurrectionnel a régné par la terreur sur la capitale.
Le 18 mars dernier, en pleine campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon réunissait ses troupes place de la Bastille. « Nous sommes à la bonne date, clamait-il, commencement de la grande et glorieuse Commune de Paris. Nous répondons à notre tour à l’appel de Jules Vallès : «Place au peuple, place à la Commune.» » Pérennité, à gauche, d’un mythe historique : en 1871, les communards se seraient dressés pour défendre la République contre les Prussiens et la droite réactionnaire. Le problème, c’est que cette version ne correspond pas à la réalité des faits.
La Commune de Paris a sans doute été réprimée avec brutalité, mais ce soulèvement contre un Parlement librement élu par les Français n’en représente pas moins soixante-douze jours d’anarchie, au cours desquels un pouvoir insurrectionnel a régné par la terreur. Aujourd’hui encore, les publications qui osent décrire cette cruelle vérité sont rares. C’est pourquoi le livre documenté écrit par François Broche, qui est journaliste et historien, et par Sylvain Pivot, un haut fonctionnaire disparu en 2010, mérite d’être salué *.
Le 4 septembre 1870, après la capitulation de Napoléon III à Sedan, la République est proclamée à Paris. Le gouvernement de la Défense nationale poursuit la guerre, mais les revers s’accumulent : les armées nouvellement constituées sont vaincues par les Allemands, tandis que Paris est assiégé, et réduit à la famine. Humiliation suprême de cette « Année terrible » : le 18 janvier 1871, l’empire d’Allemagne est proclamé au château de Versailles. Le 26 janvier suivant, un cessez-le-feu est signé. Le 8 février, le suffrage universel envoie à l’Assemblée nationale réunie à Bordeaux une majorité de députés royalistes, et favorables à la paix. Dans la capitale, au contraire, bien que la seule expédition menée contre les Prussiens ait échoué à Buzenval, une forte minorité républicaine prône la guerre jusqu’au bout.
L’Assemblée étant divisée entre légitimistes et orléanistes, la question des institutions est ajournée, et Adolphe Thiers est nommé chef provisoire du pouvoir exécutif. Opposant sous la Restauration, président du Conseil sous la monarchie de Juillet, libéral sous le second Empire, celui-ci, secrètement républicain, déteste le bellicisme irresponsable. Il hâte donc les négociations avec l’occupant : le 26 février, les préliminaires de paix sont conclus à Versailles (le traité définitif sera signé le 10 mai à Francfort). Mais si l’Assemblée ratifie les conditions convenues (perte de l’Alsace et de la Moselle, lourde indemnité de guerre), 107 voix de gauche, dont les députés de Paris, ont voté contre.
Le 1er mars, selon l’exigence de Bismarck, les Allemands défilent sur les Champs-Elysées. Dès lors, la tension monte d’un cran dans la capitale où les gardes nationaux s’organisent en Fédération républicaine de la garde nationale – d’où le nom de fédérés qu’ils garderont. Thiers s’installe au Quai d’Orsay mais, flairant le danger, demande à l’Assemblée, qui a quitté Bordeaux, de siéger à Versailles.
Le drapeau rouge sur l’Hôtel de Ville
Le 18 mars, quand les soldats du gouvernement gagnent Montmartre pour récupérer les canons de la garde nationale, ils sont confrontés à l’hostilité de la foule. Des officiers sont faits prisonniers et, quelques heures plus tard, lynchés dans leur cellule : le premier sang a coulé. A minuit, les bâtiments officiels étant contrôlés par les gardes nationaux, le drapeau rouge flotte sur l’Hôtel de Ville, pendant que les troupes loyales escortent Thiers et ses ministres jusqu’à Versailles.
Le 26 mars, les fédérés organisent des élections municipales où, 53 % des Parisiens n’ayant pas pris part au vote, la gauche remporte une victoire facile. Mais dans l’assemblée municipale qui s’érige en Commune de Paris, les éléments modérés sont vite marginalisés. Le calendrier de 1793 rétabli, des clubs révolutionnaires sont fondés, les journaux hostiles à la Commune interdits, et les écoles catholiques fermées. Afin de traquer les traîtres, un Comité de salut public est même ressuscité. La majorité de la population, terrorisée, se terre chez elle.
Les insurgés ne possèdent pas de chefs militaires dignes de ce nom : leurs affrontements avec les soldats de Mac-Mahon, chargé par Thiers de reprendre Paris, tournent à la déroute. Le 21 mai, l’armée pénètre dans la capitale par la porte de Saint-Cloud. Le centre et l’est de la ville se hérissent cependant de barricades. Elles sont prises une à une, mais les assaillants ne font pas de quartier.
Le 23 mai, les communards incendient les Tuileries, le ministère des Finances, la Cour des comptes et le Conseil d’Etat. Le lendemain, l’Hôtel de Ville, le Palais-Royal et le Palais de justice. Les extrémistes fusillent des dizaines d’otages, dont Mgr Darboy, l’archevêque de Paris. Le 28 mai, la dernière barricade tombe. Les survivants des ultimes combats sont alignés contre l’enceinte du Père-Lachaise, emplacement devenu le légendaire mur des Fédérés.
Les gouvernementaux ont eu un millier de morts. Au cours de la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai, entre 10 000 et 30 000 communards ont été tués, et 39 000 arrêtés. Beaucoup seront relâchés ou bénéficieront d’un non-lieu, mais 11 000 accusés seront condamnés à une peine de prison, 4 500 à la déportation en Nouvelle-Calédonie, et une centaine à la peine capitale.
« La Commune, observent François Broche et Sylvain Pivot, dépourvue d’idées neuves, de valeurs fondatrices et de dirigeants d’envergure, ne fut jamais en mesure de précipiter l’enfantement d’un monde nouveau. » Une insurrection pour rien ? Thiers, en rétablissant l’ordre, a rassuré les conservateurs. Le résultat de la Commune aura donc été, paradoxalement, de préparer l’avènement de la IIIe République.
Jean Sévillia
* La Commune démystifiée, de François Broche et Sylvain Pivot, France-Empire.