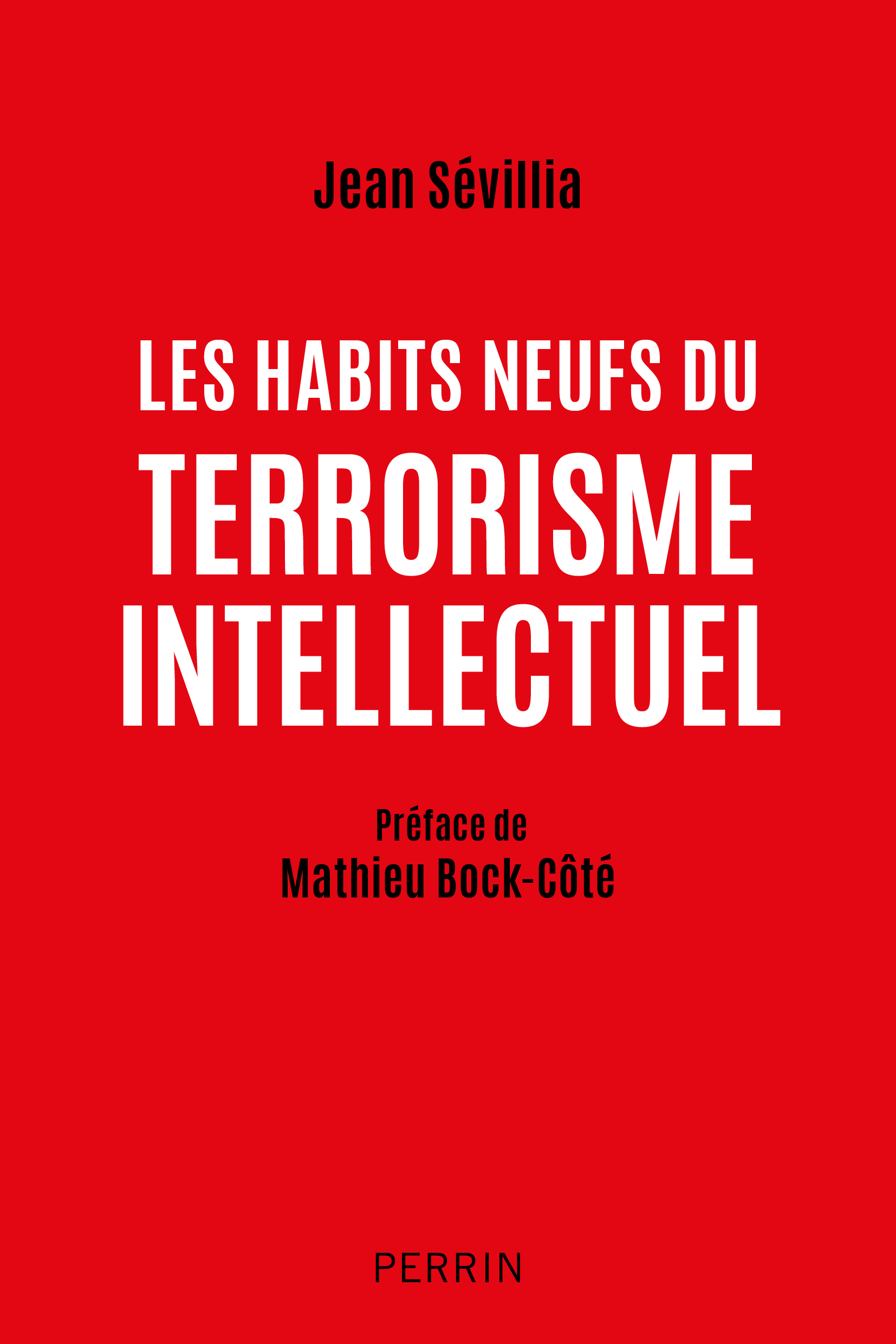Avant de se retrouver associé à Hitler et d’être entraîné dans la guerre, Mussolini fut immensément populaire dans son pays. Les archives exhumées par un chercheur britannique témoignent de l’attachement de nombreux Italiens au Duce.
Fascisme : pris dans son sens strict, qui désigne le régime de Mussolini, ou dans son acception large, celle imposée dès les années 1930 par la propagande de gauche et qui englobe le nazisme et tous les courants autoritaires anticommunistes, le mot est frappé d’une charge répulsive, charge rétrospectivement aggravée par les crimes hitlériens. Dans le cas de l’Italie, la célèbre photo qui montre le Duce et sa maîtresse Clara Petacci pendus par les pieds après avoir été sommairement exécutés, à Milan, en 1945, accrédite l’idée selon laquelle l’Etat mussolinien était une dictature haïe, dont le peuple avait été trop heureux d’être libéré par la Résistance et les Alliés.
Contrevenant à ce cliché, le grand historien italien du fascisme, Renzo De Felice, avait fait scandale, dans les années 1960, en soutenant, dans sa monumentale biographie de Mussolini, œuvre restée inachevée, que le régime mussolinien n’était pas assimilable au national-socialisme et qu’il avait bénéficié, à partir de 1936, d’un consensus dans l’opinion italienne. En 1999, Pierre Milza, historien français spécialiste de l’Italie, avait lui aussi bousculé la vulgate dominante en affirmant, dans une biographie du fondateur du fascisme, que ce régime n’était pas exactement un Etat totalitaire dans la mesure où certaines formes d’opposition y avaient longtemps été possibles. Et voici qu’aujourd’hui, un chercheur britannique, Christopher Duggan, professeur d’histoire italienne à l’université de Reading, en Angleterre, publie un fort volume qui est le fruit d’années de recherche dans les archives publiques ou privées et qui confirme le jugement émis par Renzo De Felice : le Duce a été immensément populaire, quand bien même sa politique, ses ministres ou les caciques de son parti pouvaient être critiqués.
Duggan tire cet enseignement du dépouillement de milliers de lettres, de journaux intimes et de mémoires écrits par des Italiens ordinaires entre 1920 et 1945. Le secrétariat particulier de Mussolini, par exemple, recevait en moyenne, dans les années 1930, 1500 lettres par jour, envoyées parfois dans le but de présenter une sollicitation, mais souvent aussi pour féliciter le Duce, le remercier ou l’encourager. L’historien britannique, connaissant son métier, ne manque pas de se livrer à la critique des sources en s’interrogeant sur la représentativité de ces documents qui n’ont jamais été exploités par les chercheurs. Tout en faisant la part de l’intérêt chez ceux qui cherchaient à obtenir une faveur du dictateur, Duggan souligne que « la spontanéité et la chaleur de la majorité de ces lettres, et le fait que souvent elles ne sont pas signées, montrent que des forces psychologiques et culturelles plus complexes étaient à l’œuvre, liées à des questions telles que l’espoir, le besoin d’être rassuré, l’identité ou la confiance. » Outre ces précautions méthodologiques concernant les écrits sur lesquels il a travaillé, l’auteur insiste sur l’importance de la chronologie, puisque la popularité du Duce a varié dans le temps.
En 1919, Benito Mussolini, ancien militant socialiste, partisan de l’entrée en guerre de l’Italie dès 1914, engagé et blessé sur le front, fonde les Faisceaux italiens de combat, un mouvement dont la quasi-totalité des adhérents sont des anciens combattants et qui mêle des thèmes nationalistes et des thèmes socialistes. Dans un contexte de récession économique, de grèves et de violences, les fascistes recourent à la force afin de rétablir l’ordre, répondant aux méthodes tout aussi violentes des communistes qui récusent également le modèle démocratique. Le succès est au rendez-vous : au printemps 1922, le parti fasciste compte 720 000 membres. Au mois d’octobre de la même année, après la Marche sur Rome, le roi Victor-Emmanuel III confie la formation du gouvernement à Mussolini.
Dans un premier temps, ce dernier respecte les formes du régime parlementaire, puis il instaure sa dictature, en 1925, à la suite de la crise provoquée par l’enlèvement et l’assassinat du député socialiste Matteotti. Le Duce est à la fois chef du parti fasciste et chef du gouvernement, cumulant le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisqu’une loi de janvier 1926 lui permet de légiférer par décrets lois sans contrôle parlementaire. Peu après, tous les anciens partis sont dissous et les opposants déchus de leur mandat parlementaire. A partir de 1928, les élections se font sur une liste de noms préparée par le Grand Conseil fasciste, et le Parlement perd toute signification politique.
En dotant l’Italie d’une législation sociale qui lui faisait défaut, en assurant la reprise économique, en résorbant le chômage par une politique de grands travaux, en assainissant des zones marécageuses pour les consacrer à l’agriculture, en lançant un réseau d’autoroutes et d’ambitieux plans d’urbanisme, en concluant la paix entre l’Italie avec la papauté par les accords du Latran, le régime emporte l’adhésion massive de pans entiers de la population, comme le prouve la moisson rapportée par Christopher Duggan. L’intense propagande d’Etat, qui proclame que « Mussolini a toujours raison », développe une mystique qui fait son effet : des millions d’Italiens se persuadent que le Duce va redonner au pays la grandeur de la Rome antique.
Un premier tournant, traditionnellement repéré par les historiens, est confirmé par l’enquête du chercheur anglais. Ce tournant correspond à l’invasion de l’Ethiopie, en 1935-1936, aventure condamnée par la SDN et qui provoque un programme de sanctions économiques appliqué par la Grande-Bretagne et la France. Si la guerre en Afrique a rencontré l’assentiment enthousiaste de la population italienne, dont la fierté a été fouettée par la réprobation internationale qui s’est abattue sur Rome, le régime, isolé sur la scène européenne, est conduit à se rapprocher de l’Allemagne, alors que Mussolini, initialement, méprisait Hitler et ne craignait pas de protéger l’indépendance de l’Autriche contre les ambitions annexionnistes du IIIe Reich. Avec l’axe Rome-Berlin, constitué en novembre 1936, le Duce devient un allié d’Hitler, un second, et bientôt un satellite.
Ce changement de perspective n’est pas du goût des Italiens, angoissés par la montée vers la guerre à partir de 1938. Les lois anti-juives, adoptées pour complaire à Hitler, ne sont pas plus approuvées. Entré dans le second conflit mondial aux côtés du Reich, l’Etat fasciste s’écroulera avec lui, après que Mussolini, mis en minorité au sein du Grand Conseil fasciste, en 1943, aura été destitué par le roi.
« Il est indéniable que le parti fut impopulaire, écrit Christopher Duggan : la colère suscitée par la cupidité des chefs a donné lieu à de nombreux témoignages et elle était patente dans les villes où les potentats furent la cible d’attaques après la chute de Mussolini. » Pour autant, cette méfiance envers le fascisme comme système n’affectait pas, jusqu’en 1942 au moins, la personne de son chef. « Quant au culte du Duce, poursuit Duggan, il est certain qu’il n’y a pas de lien direct entre la déception vis-à-vis du régime et le retrait de son soutien ou de sa confiance au chef. Au contraire, plus les gens souffraient, plus ils avaient tendance à se tourner vers Mussolini pour retrouver espoir. »
En conclusion, l’historien britannique se penche donc sur la dimension « religieuse » du fascisme. Alors qu’une grande part de l’historiographie non-italienne, refusant toujours les leçons de Renzo De Felice, se plaît à mettre en lumière les stratégies d’évitement des Italiens vis-à-vis des obligations posées par le régime – discrets contournements de la loi, participation purement formelle aux manifestations officielles, dans le seul but d’éviter les ennuis –, Duggan, brossant un portrait de l’Italie fasciste vue de l’intérieur, révèle une autre réalité. Il montre que des hommes et des femmes de tous âges et de tous milieux ont été fascinés jusqu’au bout par Mussolini, qu’ils voyaient précisément comme l’antithèse de l’Italien moyen, estimant qu’il se sacrifiait pour corriger leurs défauts. Cette certitude s’avérera une illusion tragique, puisque l’Italie fasciste s’effondrera dans les larmes et le sang. Mais ce n’est pas une raison pour réécrire l’histoire : le fait est là, des millions de ses compatriotes ont sincèrement cru en Mussolini.
Jean Sévillia
Christopher Duggan, Ils y ont cru. Une histoire intime de l’Italie de Mussolini, Flammarion, 488 pages, 28 €.